-

On connait Roberto Saviano depuis que la Camorra lui a fait une publicité inattendue en le condamnant à mort. Jusqu’alors il n’était qu’un jeune journaliste parmi tant d’autres. Mais en 2006, il publie un ouvrage Gomorra qui traite des menues combines de la Camorra. Le livre va rencontrer un énorme succès, un succès mondial, des millions d’exemplaires seront vendus. Il sera adapté à la scène et à l’écran toujours avec un grand succès. Le film de Matteo Garrone est d’ailleurs excellent. Cet ouvrage traitait dans le détail des menues combines de la Camorra, du traitement des déchets dangereux à l’immobilier, en passant par la haute-couture.
Des ouvrages sur la mafia, il y en a eu beaucoup, souvent même des ouvrages courageux dénonçant la criminalité hors du commun de cette entreprise, ses collusions avec les pouvoirs politiques. Mais aucun n’a eu ce retentissement. La principale raison de son succès est que Saviano est un véritable écrivain, c’est-à-dire qu’il ne se contente pas seulement de dénoncer et de présenter des faits. Il démythifie la mafia, il la touche dans ce qu’elle a de plus profond, et pour cela il utilise un style froid et précis, démontant les ressorts de sa malfaisance dans une soif d’argent et de pouvoir illimitée.
Roberto Saviano a un projet précis, et il sait comment le mener. Au fond il comprend que si la mafia a pu prospérer pendant aussi longtemps, c’est aussi parce qu’elle était la productrice de mythes particulièrement efficaces. Le succès énorme et durable du Parrain, le film de Coppola, le démontre à l’envie. L’héroïsme est du côté de la mafia. Et peu importe si pour cela il faut transgresser les lois et la morale ordinaire. Cette mise en œuvre de figures épiques est un soutien à la fois idéologique et culturel à la mafia. Certes la mafia ne se combat pas seulement en mettant en œuvre de nouvelles figures héroïques, il faut des lois et des hommes déterminés. Mais le combat contre elle trouve sa justification dans la résistance à la peur, dans l’opposition d’une morale collective à la lâcheté individuelle des mafieux de tout acabit. C’est pour cela qu’un des puissants piliers de la lutte contre la mafia – mais on pourrait dire la même chose de la lutte contre la corruption du régime sarkozyste – est de démystifier le pouvoir de l’argent, car non seulement l’argent corrompt les consciences, mais il devient un but en soi qui nous éloigne de la vérité. Ce n’est pas sans raison que Saviano signale combien la mondialisation des échanges, les mécanismes de l’Union européenne, mais aussi toutes les formes de déréglementation sont favorables à l’extension de la criminalité organisée. Une partie de son projet signifie que pour combattre la mafia et plus généralement les pouvoirs de l’argent, il faut travailler à leur dévalorisation sur le plan culturel : il faut que ces formes de pouvoir ne provoquent plus le désir. Le moyen est de produire de nouveaux mythes, de nouvelles formes héroïques – ce qui par parenthèse était aussi le projet de Guy Debord. Et que ce soit contraint ou forcé, Saviano y est arrivé à travers sa propre personne.
Cette façon d’écrire et de penser, est détaillée dans La beauté de l’enfer qui est un recueil d’articles. Roberto Saviano ne s’embarrasse pas de nuance : à l’évidence il y a le bien et le mal. Ces deux camps sont nettement définis. Lutter contre la mafia c’est lutter contre le mal. Tant pis, si on est le plus faible, mais la seule manière de vivre c’est de résister. C’est dans cet ouvrage qu’il élabore un parallèle discret entre la boxe et l’écriture. Pour lui la seule écriture qui compte est celle du combat. Même si on prend des coups, on doit avoir le courage de résister et de dénoncer. On peut dire que la vie de Saviano est exemplaire en ce sens. Mais il n’est pas le seul et lui-même fait le lien entre sa propre existence sous protection policière et les déboires de Taslima Nasreen ou ceux de Salman Rushdie. Roberto Saviano se range lui-même dans ce camp, non pas pour en tirer gloire, mais surtout pour montrer qu’il n’est pas seul à se battre et qu’il est possible de vivre sans baisser les bras.
C’est une littérature engagée que revendique Saviano. Mais qu’est-ce que ça veut dire engagé ? Seulement que Saviano a le désir d’écrire le roman des vaincus. C’est le point de vue des perdants qui l’intéresse, pas celui des gagnants, qu’ils soient de la mafia ou d’autres milieux affairistes. Car ce point de vue est l’affirmation du refus d’un monde hiérarchique et frelaté où les hommes se mesurent les uns aux autres.
Mais l’engagement est évidemment une prise de risque : « car la vie n’est qu’un bien perdu quand on ne la pas vécue comme on aurait voulu » disait le poète Eminescu. Quiconque n’est pas menacé de mort fait une littérature inutile, la fin de son ouvrage La beauté et l’enfer, reprend les articles que Saviano a écrit sur cette forme de résistance par le livre et par les mots. On notera au passage qu’il accorde une plus grand efficacité à la forme romanesque, qu’à l’essai ou au reportage. C’est donc aussi une forme de réhabilitation de la littérature car c’est en construisant des phrases, en jouant avec les mots, qu’on réhabilite le sens, qu’on fait apparaître ce qui n’est pas directement sensible. Comme on s’en rend compte, Saviano n’est pas du genre à épiloguer sur la mort de la littérature, ni sur la nécessité de faire évoluer les formes stylistiques vers leur décomposition pour créer de la nouveauté. Il y a une sorte d’éternité dans la forme littéraire car elle est au service de ce combat pour l’émancipation.
Il serait erroné cependant de croire pour autant que Saviano n’a pas de style. C’est un homme cultivé qui a beaucoup lu et qui a fait des études de philosophie solides. Au passage il nous parle de ses influences, Camus, Primo Levi, etc. Toujours des hommes qui ont résisté, qui ont témoigné, qui se sont mis au service de la vérité. Sous l’apparence d’un style froid et documentaire, il y a aussi une sorte d’humour noir qui traverse son œuvre.
Bref, au-delà de l’aspect scandaleux de la trajectoire de Roberto Saviano, vous pouvez être assuré que c’est un vrai écrivain dont on parlera encore longtemps, à moins qu’il ne se fasse tuer par la Camorra avant.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Film de Jean-Stéphane Bron, 2010

C’est un film dont l’originalité de la forme l’apparente assez finalement à Roger et moi de Michael Moore qui date de 1989 et qui avait déjà fait sensation à l’époque. Il s’agit de construire à partir d’éléments concrets des retombées de la crise économique une mise en accusation du système économique libéral. Dans les deux cas, on assiste à des expulsions massives de pauvres gens de leur maison, sans trop savoir ce qu’ils vont devenir. Dans Roger et moi, c’était la crise de l’industrie automobile qui créait du chômage, privant d’emploi des milliers de personnes qui ne pouvaient plus rembourser leur crédit. Ici, c’est tout simplement la crise des subprimes qui crée la misère et le chômage.
Il y a une continuité évidente entre les deux films qu’on peut à juste titre regarder comme deux étapes de la décomposition du système économique américain. Entre les deux films une vingtaine d’années se sont passées, les Etats-Unis ont poursuivi et presqu’achevé le mouvement de désindustrialisation, et les Américains sont devenus principalement un peuple de consommateurs. Cette course à la consommation a été rendue possible principalement par l’extension du crédit à toutes les classes de la population. Mais lorsque la croissance est apparue insuffisante pour rembourser les emprunts, le système s’est effondré.
Le centre de profitabilité du capitalisme est passé en quelques décennies de l’industrie aux services, et particulièrement aux services financiers, la banque et l’assurance. Il faut distinguer deux choses différentes dans cette grande crise qui ne fait que commencer : d’une part la remise en question d’un modèle de croissance, et d’autre part l’ingéniosité des banquiers américains qui ont inventé un système qui leur permet toujours de faire des profits énormes. En effet, depuis le milieu des années soixante-dix, ou le début des années quatre-vingts, la plupart des indicateurs de bien être montrent que même si le PIB par tête continue d’augmenter aux Etats-Unis et dans les pays développés, ces mêmes indicateurs montrent que le bien-être diminue, dès lors qu’on intègre des paramètres non-monétaires dans leur mesure. Ce qui veut dire clairement que depuis les années soixante-dix, le modèle capitaliste, de plus en plus dérégulé, est incapable de satisfaire à l’amélioration de la qualité de la vie.
Le mouvement semble s’être accéléré à partir de la déréglementation du système bancaire à l’échelle planétaire, puisque c’est en effet vers le début des années quatre-vingts que la déréglementation des marchés financiers, c’est-à-dire concrètement de la possibilité des banques de créer de la monnaie de crédit autant qu’elles le voulaient, a permis d’appuyer la croissance sur un endettement de plus en plus colossal. L’absence d’augmentation des salaires joue bien entendu un rôle déterminant dans cet endettement croissant.
Le résultat de cette dérégulation est que les pauvres deviennent plus pauvres qu’auparavant et que les riches sont plus riches encore. Ce qui est remis en question de façon radicale est l’idée que les pauvres peuvent accroître leur niveau de bien être, en achetant leur maison, en consommant à crédit. Le réveil fut brutal.
A mon sens le système des subprimes est seulement l’aspect le plus visible de cette crise. C’est celui qui démontre qu’il n’y a que l’épaisseur d’une feuille de cigarette entre l’économie légale et l’économie criminelle. Le témoignage d’un démarcheur de crédits est absolument saisissant : c’est un ancien dealer qui par tous les moyens va persuader de pauvres gens qu’ils peuvent s’endetter au-delà du raisonnable, sans dommage pour eux dans l’avenir.
Le film proprement dit est assez complexe pour montrer toute l’ambiguïté du système : les victimes de cette crise des subprimes qui vont perdre leur maison, n’ont pas vraiment compris ce qu’il leur arrivait. Pour parler comme les économistes, il y a là une asymétrie d’information. C’est-à-dire que d’un côté on a des démarcheurs de crédit dont le but à court terme est d’abord d’encaisser des primes pour les prêts qu’ils placent, et de l’autre des pauvres gens qui ne se rendent pas compte que la valeur de leur bien immobilier ne pourra pas toujours augmenter pour rattraper la valeur de leur emprunt. Peu de témoins ou de membres du jury sont capables de produire une critique globale du système et de comprendre ce qu’est effectivement le droit de propriété.
Le passage le plus émouvant est le témoignage du policier chargé de faire respecter la loi et donc d’expulser massivement ceux qui n’ont plus les moyens de payer. Cette contradiction entre la loi qui vise à faire respecter le droit de propriété et la simple gestion de cas humains, est tout à fait douloureuse. Mais le témoignage d’Osinski qui a produit un logiciel destiné à gérer la titrisation des crédits est également un grand moment d’ambigüité, certes, il reconnait l’inhumanité du système, mais en même temps, il s’affirme lui aussi comme un capitaliste, supposant qu’il n’y a rien au-dessus de l’intérêt individuel et la recherche du profit par tous les moyens.
Aux Etats-Unis, l’opinion publique est scandalisé par l’arrogance des banquiers, et la vitesse à laquelle ils ont pu se refaire une santé, grâce à l’intervention de l’Etat qui a injecté des sommes colossales dans les banques en faillites. Mais en même temps, cette opinion publique croit encore aux vertus de la libre entreprise et à la nécessité de déréguler encore un peu plus les marchés.
Le second acte de cette tragi-comédie va se jouer rapidement dès lors qu’il va apparaître que les plans de relance successifs et coûteux n’ont pas ranimé une croissance moribonde et n’ont aboutis qu’à renforcer le pouvoir des banquiers. L’attaque permanente des banquiers, qui ont été renfloués par les Etats, contre l’endettement de ces mêmes Etats, va rapidement conduire à la déflation et à une montée massive du chômage. Lorsque les dettes publiques de la Grèce, de l’Espagne, puis demain de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis auront été déclassées, l’envol des taux d’intérêt, conjugué aux plans d’austérité va engendre une misère tellement énorme que le système va exploser.
L’occasion d’un apaisement des marchés a été manquée à la fin de l’année 2008 quand il était possible encore de renationaliser le système bancaire : le prétexte était facile à saisir, il suffisait de demander des contreparties sous la forme de titres de propriété aux banques en faillite. Au lieu de quoi, la timidité des gouvernements des pays développés les a amené à renouveler leur confiance à un système qui avait failli. La question principale est de savoir si la monnaie doit être produite et contrôlée par les Etats nationaux, ou si au contraire on doit permettre aux banquiers de créer autant de liquidités qu’ils le veulent. Les prix Nobel d’économie Stiglitz et Krugman considèrent que c’est là la responsabilité majeure et historique de l’administration Obama.
Mais pour ne pas être trop dur avec les dirigeants des pays développés, on peut dire aussi que les hommes politiques, en dehors des magouilles habituelles pour détourner des fonds, ne font que ce que l’état de leur opinion leur permet. Et justement, c’est là que le film de Bron est précieux, il montre que les principales victimes de ce système dévoyé ne sont pas capables d’imaginer un autre monde, un monde plus solidaire où la solidarité pourrait remplacer comme valeur culturelle la volonté d’enrichissement.
Le dernier point est de savoir quel impact peut avoir un tel film, notamment dans sa forme. En effet en utilisant une forme narrative qui ressemble à un documentaire, tout en étant une fiction puisque le procès est un « faux » procès, on prend le risque de ne toucher qu’un tout petit nombre de spectateurs. N’est-il pas plus pertinent de revenir à des formes fictionnelles plus traditionnelles, aptes à toucher le plus grand nombre, comme la Warner Bros avait réussi à le faire dans les années qui suivirent la Grand dépression ? Autrement dit, il est peut-être temps de produire des formes nouvelles de « héros » qui prennent en charge le discours subversif capable de reformuler des codes culturels nouveaux.
 votre commentaire
votre commentaire
-
La Mafia, toujours la Mafia
La mafia a donné naissance à un grand nombre d’ouvrages et de films. Parfois ce sont des œuvres plutôt romantiques comme la saga du Parrain, mais parfois ce sont aussi des ouvrages plus sérieux, voire des ouvrages documentaires. A l’évidence la Mafia fascine. Les raisons de cette fascination sont tellement nombreuses quelles permettent de rassembler un public toujours plus large. Les thèmes récurrents de la saga des mafias sont, dans le désordre, sa capacité à construire à partir de la violence un contrepouvoir au monopole de la violence qui se trouve entre les mains de l’Etat, la destinée personnelle de maffieux, petits ou grands, qui ainsi peuvent sortir aussi bien de la misère que de l’anonymat. Mais depuis les années quatre-vingt-dix, il y a la présence mise à nue des capacités mafieuses à comploter d’une manière quasiment terroriste en corrompant les élites politiques et la magistrature. Il y a également dans les formes mafieuses de l’organisation de la vie sociale et économique, la continuation du capitalisme par d’autres moyens.
Bref, l’histoire de la Mafia ou des mafias, recèle une grande quantité de sujets de roman policiers ou noir. C’est presque le passage obligé de tous les écrivains qui œuvrent dans ce secteur. Même un écrivain comme Frédéric Dard, n’ayant guère de goût pour la documentation, traitera par la bande de cette question dans Le dragon de Cracovie, son ultime ouvrage en grand format.

Avant d’être une série de films remarquables, Le Parrain est un ouvrage de très grande qualité de Mario Puzo. Cet ouvrage qui eut en son temps un énorme succès est souvent sous-estimé par la critique. Non seulement il est très documenté pour ce qui concerne la mafia américano-sicilienne, mais il est très bien construit et très bien écrit. Puzo n’a jamais réussi à mieux faire. C’est très certainement l’œuvre de fiction sur la Mafia qui réussit le mieux le pari de mêler les destinées personnelles de la famille Corleone à une description minutieuse de ce qu’a été la Mafia. Si on fait abstraction du romantisme sous-jacent à cette œuvre, on se rend compte que son fonctionnement est décrit sans complaisance, que ce soit en ce qui concerne la cruauté de cette institution, ou que ce soit dans ses capacités à corrompre la société dans laquelle elle se meut.

Récemment, Gomorra, le livre pour lequel la tête de Roberto Saviano a été mise à prix a apporté un éclairage nouveau sur le sujet. C’est l’histoire de la Camorra à l’heure de la mondialisation. Cette mondialisation qui prospère dans l’affaiblissement croissant de l’Etat, mêle allègrement les vieilles méthodes du capitalisme sauvage au développement d’un pouvoir presque sans limite dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Cet ouvrage a donné naissance également à un film de Matteo Garrone qui, cette fois sans romantisme, décrit le quotidien sordide de la Camorra. Le plus remarquable dans Gomorra est sans doute la mise en perspective des relations économiques entre la Camorra et les capitalistes chinois. Cet ouvrage capital confirme que le développement de la mafia s’appuie sur un retrait de l’Etat et généralement sur l’ouverture commerciale des sociétés. La mondialisation est une aubaine pour la mafia.
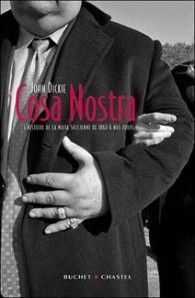
De nouveaux éclairages ont été également apportés par des ouvrages mettant l’accent sur les relations entre les mafias et le personnel politique. J’en retiendrais trois ici. Le premier est celui de John Dickie, intitulé Cosa Nostra, il retrace l’histoire de la mafia sicilienne, de ses origines paysannes vers le milieu du XIXème siècle jusqu’à l’arrestation de Provenzano. Bien qu’il ne comporte guère de révélations, il montre clairement comment Cosa Nostra s’adapte à toutes les transformations du capitalisme, et comment, dès ses origines, elle s’insère dans une logique internationale : autrement dit, elle prospère dans le cadre d’une économie ouverte sur l’extérieur. En effet, vers le milieu du XIXème siècle, la Sicile sort de son engourdissement grâce à le production d’agrumes destinés à l’exportation, et c’est sur ce marché important que la mafia sicilienne va asseoir sa puissance et accumuler ses premiers millions. Le passage le plus intéressant du livre est d’ailleurs celui où il décrit la collusion entre la Mafia, l’Eglise et les grands propriétaires terriens pour enrayer les tendances à la socialisation des terres qui se manifestaient à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Il s’appuie sur le fameux rapport Sangiorgi dont il donne des passages assez longs plutôt passionnants qui montre que le problème de Cosa Nostra était bien connu depuis la fin du XIXème siècle. La seconde phase de développement de Cosa Nostra a pour origine son implication directe avec les Américains dans la reconstruction d’une modernisation de l’Italie. Cette collaboration s’explique par la vision que les Etats-Unis se faisaient de la Guerre froide. Et on ne s’étonnera pas que des mafieux comme Toto Riina ou son alter ego Bernardo Provenzano aient commencé à faire leurs preuves d’abord dans l’assassinat de délégués syndicalistes proches du parti communiste. La troisième phase d’expansion de la mafia sicilienne s’inscrit dans la montée en puissance de l’Union européenne, ce qui a affaibli l’Etat tout en augmentant les opportunités de détournement de fonds publics à partir des subventions distribuées par l’Union européenne : il y a quelques années circulait un chiffre ahurissant, 15% des fonds de la PAC atterrissaient dans les poches de Cosa Nostra. Ce chiffre émanait directement des services de la Commission européenne.
 Toto Riina est derrière les barreaux depuis 1993 et son ami Provenzano l'a suivi en 2006
Toto Riina est derrière les barreaux depuis 1993 et son ami Provenzano l'a suivi en 2006 Naturellement, la Mafia choisit comme courroie de transmission la Démocratie chrétienne. La contrepartie de cette funeste alliance fut la mise en coupe réglée d’une large partie de l’économie sicilienne et par suite le renforcement du pouvoir de Cosa Nostra.
L’ouvrage de Nicola Tranfiglia, Pourquoi la mafia a gagné, qui traite de la question jusqu’aux années 2007-2008, s’attache presqu’exclusivement aux relations entre la classe politique et la Mafia. Il s’intéresse moins aux formes de la violence que véhicule cette institution sanglante. Sa thèse est que s’il est aussi difficile que cela de s’attaquer à la Mafia, cela provient essentiellement du fait que l’Italie n’a jamais réussi à créer un Etat moderne, unifié et démocratique, autrement dit l’Etat n’a jamais eu les moyens de contrebalancer le pouvoir de la Mafia. C’est un ouvrage passionnant à tous égards. Il apporte des éclairages importants sur la collusion des partis de gouvernement – ce n’est pas un hasard si le Parti communiste italien s’est trouvé la plupart du temps en pointe dans le combat antimafia. Il montre clairement l’implication de la loge P2, cette loge maçonnique à laquelle appartenaient aussi bien Berlusconi que Gelli ou encore des membres de la haute hiérarchie du Vatican. Il termine d’ailleurs sur une note pessimiste pour l’avenir puisqu’il dénonce le détricotage législatif entrepris par Berlusconi et la mise en question des juges par l’opinion publique qui suit d’une façon assez inquiétante cette contre-révolution judiciaire appuyée par les médias corrompus.

La mafia italienne de Claude Ducouloux-Favard, avocate et universitaire, n’est pas très loin des thèses de Tranfaglia qu’elle cite d’ailleurs abondamment. Son point de vue est complémentaire du livre précédent. Principalement consacré à la mafia sicilienne, elle insiste sur les nécessaires modifications du droit qui ont permis les succès contre Cosa Nostra et qui ont abouties au « maxi procès » qui permis de traduire en justice 475 mafieux et d’en condamner une grande partie à de lourdes peines. L’ouvrage décrit également le fonctionnement concret et hiérarchisé de Cosa Nostra d’une manière très vivante en s’appuyant sur de nombreux témoignages de repentis. Elle tente également de présenter la mafia sicilienne comme une entreprise capitaliste – avec un chiffre d’affaire de 90 millions d’euros, c’est la première entreprise du pays – et de cerner les secteurs où elle produit ses bénéfices les plus importants. Comme Tranfiglia, Ducouloux-Favard craint que le calme relatif qu’on peut observer en Sicile depuis l’arrestation de Riina et Provenzano, ne soit que très relatif ou même la conséquence d’une reconquête de ses territoires par la Mafia.

La conclusion de tout cela est que si vous ne vous occupez pas de la Mafia, elle, elle s’occupe de vous. On peut voir à partir du 4 juillet 2010 à la télévision une série italienne Corleone, en italien Il capo dei capi, qui raconte la vie de Toto Riina. La série est plutôt bien faite. Certains ont trouvé qu’elle donnait une image trop noble de Toto Riina. Ce n’est pas vrai, bien au contraire elle montre le caractère paranoïaque de Riina et les compromissions de la classe politique, mais la critique venait d’un proche de Berlusconi. Elle insiste aussi sur une dimension importante du fonctionnement de la mafia : si tu ne trahis pas, tu seras trahi à ton tour, les « hommes d’honneur » n’ayant guère de principes à cet égard. On dit également que Toto Riina a apprécié cette série, la trouvant très proche de la réalité. Ce réalisme est souvent renforcé d’ailleurs à l’aide de bandes vidéo d’époque.

Bibliographie
Frédéric Dard, Le dragon de Cracovie, Fleuve noir, 1998.
John Dickie, Cosa Nostra, Buchet-Chastel, 2007.
Claude Ducouloux-Favard, La mafia sicilienne, des vergers d’agrumes aux marchés globalisés, Arnaud Franel, 2008.
Mario Puzzo, Le Parrain, Robert Laffont, 1969.
Roberto Saviano, Gomorra, dans l'empire de la camorra, Gallimard, 2007.
Nicola Tranfiglia, Pourquoi la mafia a gagné, Tallandier, 2010.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Enfin chez tous les bons libraires !

C'est ma première grande saga, avec des personnages nombreux et variés. L'histoire se passe à Marseille dont le géographie et les décors parlent, et il commence au début des années quatre-vingt et se poursuit sur plusieurs décennies. S'inspirant de faits réels, bien que tous les personnages soient fictifs, j'essaie de décrire avec un souci d'authenticité le plus grand possible, le fonctionnement parfois curieux de la pègre marseillaise.
Comment gravit-on les échelons de cette curieuse carrière ? Quelles sont les compétences à acquérir pour devenir une "pointure" du Milieu ? Tout ça et encore plus.
Tony est la pièce centrale du roman. C'est autour de lui que tout gravite. Coincé entre ses ambitions de réussite et ses rèves de grandeur, il mène difficielemtn sa barque entre tous ces écueils. Mais ne coryez pas qu'il soit sans coeur, c'est même l'invers. bien sûr, il est obligé de commettre des actes violents, c'est cependant seulement pour les affaires.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires

