-

Le titre est légèrement trompeur. Il eut été plus judicieux de parler du grand banditisme en Israël. En effet, l’ouvrage de Serge Dumont traite de gangs plus ou moins importants qui existent évidemment dans une guerre permanente mais qui ne paraissent pas vraiment structurés en dehors du clan, de la famille. Pour qui connait un peu ce pays, c’est une enquête passionnante, non pas parce qu’elle traiterait des formes exotiques du grand banditisme, mais parce qu’en examinant la formation et le développement de ces gangs, il en dévoile les mécanismes. La mafia israélienne a cependant quelques particularités. D’abord elle extrêmement violente et emploie souvent des méthodes assez archaïques. On n’hésite pas à poser des bombes un peu partout pour éliminer les ennemis, au risque bien entendu de blesser ou de tuer des parfaits innocents. Cette violence s’explique à la fois par le fait qu’Israël est un pays en guerre depuis presque cinquante ans, la violence est constitutive de la création d’Israël et de son maintien en vie. On comprend très bien qu’il est assez facile de se procurer des armes, et d’y apprendre le maniement des explosifs.

Itzik Abergil a été extradé vers les Etats-Unis pour de nombreux méfaits, dont des assassinats
Les domaines de prédilection de la mafia israélienne sont assez traditionnels. Il y a d’abord l’extorsion et le prêt usuraire : les sommes en jeu interpellent, tant on comprend mal comment on peut en arriver à payer des intérêts de 200% sur une année. L’ouvrage de Dumont montre à quel point la société est gangrénée par le banditisme en mettant l’accent sur la mince frontière qu’il y a entre activités légales et illégales. Bien entendu, la corruption est un élément important du dispositif. Elle se trouve un peu partout, dans la police comme dans l’armée ou le rabbinat le plus orthodoxe.

Charles Abutbul le patriarche d’une famille décimée par la guerre des gangs
Si les Israéliens qui forment cette nébuleuse du grand banditisme sont issus de toutes les origines géographiques, comme la population d’Israël, ce sont cependant les Juifs d’origine sépharade et plus particulièrement du Maroc qui sont les plus nombreux et les plus actifs. Evidemment ce sont aussi les plus pauvres et ceux qui ont été dans les débuts d’Israël les plus méprisés. C’est du moins ce qu’on peut comprendre dans la formation du grand banditisme dans les années cinquante, soixante, soixante-dix. Comme un peu partout dans le monde, la criminalité se développe d’abord dans les couches les plus pauvres et les moins éduquées de la population. Mais il semble qu’au fil du temps cette liaison directe entre misère et banditisme se soit effilochée, au fur et à mesure qu’Israël comme de nombreux pays développés a mis en avant la nécessité d’accumuler du capital en grande quantité.
Dans un tel contexte, il est assez difficile à comprendre comment la police et la justice obtiennent des résultats finalement assez importants, même si souvent les juges sont menacés. Les prisons ne sont pas particulièrement douces en Israël et les plus durs des mafieux sont souvent consignés à l’isolement.

La police enquête en 2013 sur un attentat mafieux à Ashkelon
Les activités des mafieux israéliens sont diverses et variées, mais il semble qu’ils aient eu la particularité au niveau mondial de mettre en place un vaste trafic d’ecstasy, ce qui leur a valu de se faire chasser aussi par la DEA américaine. Mais même si de nombreuses activités mafieuses israéliennes ont des ramifications un peu partout dans le monde, il ne semble pas que cela ait pris les mêmes proportions que la mafia sicilienne. Il y a cependant des proximités : comme les Siciliens et les Corses, les Israéliens peuvent compter sur de nombreux relais en Europe, en Amérique et bien sûr dans les pays de l’Est. C’est typique des peuples qui ont du se disperser pour des raisons diverses et variées.
Le jeu est également un des véhicules pour la prospérité des mafieux israéliens. Le jeu sous toutes ses formes, les casinos clandestins, les paris sur les matches de football, ou encore les paris sur des sites Internet.
Dumont ne cherche pas à faire la genèse de ces entreprises criminelles, même s’il en rappelle les origines, il reste dans l’actualité. C’est aujourd’hui que cela se passe et en Israël.
Bref c’est un excellent ouvrage, fort bien documenté. On pourra reprocher de très nombreuses coquilles qui parfois dénaturent le sens. Serge Dumont est connu de longue date pour ses articles sur la mafia israélienne, ce qui l’a amené à se faire traiter d’antisémite par des internautes d’origine juive qui voudraient bien sans doute qu’Israël soit un Etat parfait. Le livre ne l’est pas bien sûr, et comme il y a de mauvais politiciens, il y a aussi des grands bandits sans scrupules en Israël comme ailleurs.
Deux petites remarques finales. En Israël il existe comme un peu partout une littérature policière, Yaïr Lapid, Dror Mishani ou Batya Gour. Mais elle ne met jamais en scène cette mafia, pourtant il y aurait de quoi faire. Au fil des pages on rencontre un personnage secondaire Ben Simon qui ressemble à un personnage que j’ai créé dans Le roman de Tony. Cela m’a fait un drôle d’effet d’apprendre que cette création romanesque avait son miroir dans la réalité
 votre commentaire
votre commentaire
-
Il s’agit d’un ouvrage de Donald Westlake, signé Richard Stark, The hunter. Paru en 1962, il s’agissait du premier épisode des aventures de Parker. Ce roman a fait l’objet de deux adaptations au cinéma, l’une, Le point de non-retour, en 1967 sous la direction de John Boorman, et l’autre Payback, en 1999 sous celle de Brian Helgeland. Le personnage de Parker est un assez étonnant, il n’a pas de prénom, change parfois de visage. Mais surtout tout en développant une sorte de morale anarchiste du banditisme, il représente le professionnel. C’est un voleur de haut niveau qui sait s’entourer de complices. La série des Parker a plu, essentiellement parce qu’au mythe du bandit au grand cœur et libre, s’ajoute cette mécanique de précision des braquages en série et des règlements de compte. Parker a été porté plusieurs fois à l’écran, rarement avec bonheur. La dernière mouture est Parker de Taylor Hackford, avec dans le rôle-titre l’inepte Jason Statham. Il a pris même l’allure d’un noir (Jim Brown) à la carrure athlétique, sans que cela améliore notablement la qualité cinématographique.
Le point de non retour, Point Blank, John Boorman, 1967

L’histoire est une histoire de trahison. Un ami de Walker l’entraîne dans un hold-up, mais au lieu de partager le butin, il va le descendre, grâce à Lynne la propre femme de Walker. Le laissant pour mort dans la prison désaffectée d’Alcatraz, il va donner cet argent qu’il doit à l’organisation afin de retrouver sa place. Mais Walker est seulement blessé. Il va se rétablir et dès lors il n’aura de cesse que de retrouver son ennemi Mal Reese, de le tuer et de récupérer son argent. Mais accéder à Mal n’est pas chose facile, il est protégé, habitant une tour qui apparaît presqu’imprenable. Après avoir retrouvé sa femme qui a été abandonnée et qui se drogue, il va trouver de l’aide en la personne de Chris qui accepte de l’aider. Il tue Reese, mais n’ayant pas pu récupérer son argent, il s’attaque à l’organisation avec méthode. La direction de ce syndicat du crime ne comprend pas cette obstination pour si peu d’argent finalement. Après avoir essayé de le tuer, Walker va servir d’arme à une fraction de l’organisation qui veut prendre le pouvoir.

Walker s’évade blessé de la prison désaffectée d’Alcatraz
L’histoire est suffisamment complexe pour que le spectateur retienne son souffle de bout en bout. Mais en vérité, même si le scénario est excellent, c’est plutôt la mise en scène et le portrait psychologique de Walker qui fait de ce film un chef d’œuvre. Située à San Francisco, le film montre une Amérique froide et désincarnée, dominée par les objets, où les êtres humains sont complètement aliénés, y compris Walker. La violence mécanique de Walker, mais celle aussi de l’organisation, est la conséquence de cette déshumanisation.

La détermination de Walker est impressionnante
Contrairement aux apparences, et malgré le grand nombre de scènes de grande violence, ce n’est pas un film d’action. C’est un film noir. Les sentiments se détruisent comme les objets et ne sont plus que des armes dont Walker essaie de se protéger. Walker donne l’impression de savoir ce qu’il fait, parce qu’il se tient à ses principes et qu’il poursuit sa vengeance jusqu’au bout, mécaniquement. Il est aussi le grain de sable qui vient enrayer cette machine froide, un modèle d’entreprise capitaliste, où seul l’argent compte : l’argent doit tourner, et Walker justement l’empêche de se valoriser par sa conduite iconoclaste.

Walker tire sur un lit vide
Les scènes d’action sont tout à fait remarquables. Et à l’époque, cette violence brute était assez nouvelle, dérangeante même pour les spectateurs. Mais l’utilisation des décors, grâce notamment à l’écran large, étonne également. C’est un univers aseptisé de béton et de verre, où la transparence sert à l’inverse à masquer les turpitudes des uns et des autres. Tout est carré et propre, seulement quelques petits voyous de bas étage baigne encore dans la fange.
C’est également un film typique des années soixante, époque où on commence à s’inquiéter de cette manière de produire de la solitude en enfermant les humains dans la consommation des objets. Lynne est seule, abandonnée par celui pour lequel elle a trahi. Elle se suicidera. Walker est seul, par définition. Il ne peut s’attacher, même s’il en a l’envie à Chris. Les membres de l’organisation ne sont pas mieux lotis, se méfiant de leurs collègues pour anticiper les coups tordus qu’ils pourraient mettre en place.

Un marchand de voitures d’occasion fournira la première piste
Les scènes fortes abondent dans ce film qui, à mon sens est aussi le meilleur film de Boorman. La bagarre dans le night-club où la violence éclate en pleine lumière sur des jeux de couleurs fournies par des projecteurs. La façon également dont Walker pénètre dans l’hôtel où loge Reese et la mort de celui-ci défénestré. Je ne vais pas tout énumérer, mais je pense aussi à ces longs plans où on voit Walker arpenter des couloirs aussi longs que vident et qui ne semblent mener nulle part. la manière dont Walker échappe au tueur d’élite dans le lit presque vide d’un canal qui alimente la ville de Los Angeles en eau, le même canal qui sera aussi utilisé par Roman Polanski dans Chinatown.Boorman utilise ce qui va devenir courant par la suite des ralentis, comme lorsque Walker pénètre dans la maison où Lynne habite.

Grâce à Chris, Walker va pouvoir accéder à l’appartement de celui qui l’a trahi

L’organisation envoie un tueur d’élite pour se débarrasser de Walker
L’interprétation est également remarquable. Lee Marvin se sert du monolithisme qu’il a déjà éprouvé dans A bout portant de Don Siegel, pour donner encore plus de poids à sa détermination. Angie Dickinson oppose un peu d’humanité, un rien délabré, mais cela ne suffira pas ni pour la sauver, ni pour sauver Walker. Mais les autres rôles sont tout aussi excellents, que ce soit Lloyd Bochner, un habitué des rôles de crapules, ou John Vernon qui incarne Reese.

Walker regarder filer au fil de l’eau un paquet qui aurait dû contenir son argent
Ce film rencontra à juste titre un grand succès, et marqua un nouveau point d’inflexion du film noir qui avait déjà commencé à prendre l’habitude de mettre en scène des tueurs froids, comme dans A bout portant, ou dans Blast of silence d’Allen Barron en 1961.

Walker se méfie de l’organisation et préfère l’ombre à la lumière
Payback, Brian Helgeland, 1999

Il était difficile après la réussite de John Boorman de se lancer dans une nouvelle adaptation de l’ouvrage de Richard Stark. Le pari de Brian Helgeland est effectivement raté sur toute la ligne. Si l’insipide Mel Gibson est responsable pour une partie de ce fiasco, c’est aussi l’idée même de transformer le scénario en un simple véhicule pour des actions toutes plus ou moins ridicules, qui plombe définitivement le film.
La trame du film reste la même. Ici Parker s’appelle Porter, allez savoir pourquoi. Mais il est tout autant trahi par sa femme et son copain qui lui pique le pognon pour réintégrer l’organisation. On a simplifié l’histoire puisqu’il n’y aura plus cette lutte interne à la bureaucratie mafieuse. Et donc l’affaire se passant cette fois à Chicago, Porter et Val – son faux copain – vont braquer des mafieux chinois. Laissé pour mort, Porter s’en tire et va se venger. Il va retrouver sa femme qui meurt d’une overdose, elle est tout autant abandonnée que dans Point Blank. Mais cette fois il va être accompagné dans sa quête de deux flics ripoux de chez ripoux, un noir et un blanc pour bien équilibrer l’affaire. Il va lui aussi tuer son ancien copain, et mettre en péril l’organisation.
Raconter ainsi on dirait presque la même histoire que Point blank. Mais l’esprit est pourtant très différent. Le film d’Helgeland en vérité se place du côté d’une morale bourgeoise plutôt bornée. On comprend tout de suite que Lynne est morte parce qu’elle a été punie pour avoir trahie son mari. Porter va d’ailleurs faire arrêter les flics ripoux, il se range finalement du côté de la loi. Et cerise sur le gâteau, il va partir avec Rosie, une ancienne call girl, et si elle renoncera au putanat, lui jure qu’il ne volera jamais plus.

Porter se fait raccommoder
Sur de telles bases, il est presqu’impossible de réussir à faire un bon film. D’autant que l’effort d’Helgeland porte plus sur les scènes d’action spectaculaires que sur les caractères proprement dits. Les explosions sont nombreuses, et Porter ressemble dans sa manière de déjouer tous les pièges plutôt à Fantômas. Les scènes de sadisme lorgnent vers le Grand Guignol. Les cruels Chinois menacent de couper les couilles de Porter qui du reste ne proteste pas, Bronson sous l’œil effaré de Fairfax casse les pieds de Porter qui ne semble guère plus souffrir que ça.

Stegman va aider Porter à retrouver Resnik
C’est un film à gros budget, on parlait à l’époque de 30 millions de dollars. Et pourtant, la manière de filmer est étriquée, Helgeland manifestant une incapacité tenace à se saisir de l’espace très particulier de Chicago, les plans sont trop resserrés pour que le film respire. Les scènes de sadisme sexuel avec Lucy Liu sont complaisantes et ridicules, elles sont là pour émoustiller le spectateur.

Resnik va demander de l’aide à Carter
La distribution est cossue. Outre Mel Gibson, la plupart des seconds rôles sont tenus par des grosses pointures. William Devane est Carter, c’est le seul qui a l’air de croire au film et c’est de loin le meilleur. James Coburn qui joue Fairfax à l’air de s’ennuyer, acteur sur le déclin à cette époque, il est venu pour prendre son cachet. Il paraît d’ailleurs très fatigué. Kris Kristofferson joue Bronson, en grimaçant, en cabotinant à mort, surjouant les pères désespéré par l’enlèvement de son petit con de fils. Les femmes sont ternes et sans intérêt, sauf Lucy Liu qui joue le rôle de la cruelle chinoise qui aime tant torturer les mecs avec qui elle baise.

Les Chinois tentent de tuer Porter
Le film a eu tout de même du succès, comme quoi le spectateur n’est pas très exigeant. Mais au final c’est juste du cinéma de l’effet sans consistance et sans intérêt. Un dernier mot, bien que ce soit un film noir, Point Blank utilise les couleurs flamboyantes de Los Angeles. Le ciel bleu, le pull jaune d'Angie Dickinson. Au contraire Hegeland a une palette de gris, de bleus très sombres et de noirs qui n'apportent finalement rien de plus.

Porter va tuer Resnik

Les tueurs de Carter se font décimer

Fairfax ne comprend pas la logique de Porter

Porter va être torturé
Les aventures de Parker au cinéma
1967 : Le Point de non-retour (Point Blank) de John Boorman, Adapté de The hunter, avec Lee Marvin dans le rôle de Parker
1967 : Mise à sac d'Alain Cavalier En coupe réglée (The Score). Michel Constantin reprend le rôle de Parker sous le nom de Georges
1968 : Le crime, c'est notre business (The Split) de Gordon Flemyng. Basé sur Le Septième homme, c’est Jim Brown, un acteur noir, qui reprend le rôle de Parker sous le nom de McClain.
1973 : Échec à l'organisation (The Outfit) de John Flynn. Basé sur le roman La Clique, Robert Duvall est Parker.
1983 : Slayground (en) de Terry Bradford. Basé sur le roman du même nom,Peter Coyote interprète le rôle de Parker sous le nom de Stone.
1999 : Payback de Brian Helgeland. Également adapté de Comme une fleur (The Hunter), Mel Gibson incarne Parker.
2013 : Parker de Taylor Hackford. Jason Statham incarne Parker.
 votre commentaire
votre commentaire
-

Paul Schrader est surtout connu comme le scénariste de Martin Scorsese, c’est lui a écrit Taxi Driver, mais aussi La dernière tentation du Christ ou encore Raging bull. il a écrit aussi pour Sidney Pollack, Yakusa, ou pour Brian de Palma, Obsession. Moins connu en tant que réalisateur, il en a pas moins réalisé 17 longs métrages, dont American gigolo, La féline, Mishima ou encore Hardcore et City Hall. Il est le représentant d’un cinéma désenchanté, typique de la fin des années soixante-dix. La révolution sociale n’est plus à l’ordre du jour, et le système économique s’en va vers sa décomposition dans l’indifférence générale des individus qui ne luttent plus que pour leur survie.

Les conditions de travail dans l’industrie automobile sont pénibles
Trois amis, ouvriers de l’industrie automobile de Detroit – avant la déconfiture de cette ville, Zeke, Jerry et Smokey, sont aux prises avec des conditions de travail difficiles, une direction hargneuse et tâtillone mais aussi avec les problèmes récurents de fin de mois. Deux noirs, un blanc, un rien branleurs, ils contestent aussi la bureaucratie syndicale corrompue. Coincés de tous les côtés, ils vont finalement décider de cambrioler le syndicat, pensant trouver une forte somme d’argent. Mais ce n’est pas le cas, le casse ne leur rapporte que 600 dollars. Cependant, comme ils opnt embarqué aussi un cahier dans lequel le syndicat note les prêts illégaux qu’il accorde, ils vont dcider de le faire chanter. Ils y ont d’autant moins de scrupules, que le syndicat déclare qu’on lui a dérobé 20 000 dollars pour arnaquer la compagnie d’assurance. Mais les choses vont plutôt mal se passer. Smokey sera assassiné, Zeke se trouvera récupéré par le syndicat qui lui propose un boulot peinard de délégué syndical, et Jerry va, par crainte d’être assassiné, se jeter dans les bras du FBI pour balancer les combines du syndicat.

Zeke conteste les orientations et les pratiques du syndicat
Le film a beaucoup plu à sa sortie, on y a vu aussi bien la critique de la condition ouvrière dans une industrie automobile américaine qui paraissait pourtant à l’avant-garde des conditions de travail, mais encore la dénonciation d’une bureaucratie syndicale encroûtée et affairiste. Ce n’est bien sûr pas le premier film sur la condition ouvrière, ni sur l’industrie automobile, mais c’est surtout un film sans illusion, qui ne cherche pas à magnifier cette vie sans espérance, ou à mettre en avant des postures héroïques. Le caractère sombre provient d’abord du renvoie dos à dos de toutes les formes d’institutions, que ce soit l’entreprise où le harcèlement est constant, que ce soit le syndicat qui semble peu intéressé par le sort des ouvriers ou encore du FBI dont les buts sont obscurs. Mais bien sûr le film renvoie aussi à la passivité et au manque de conscience de classe de la classe ouvrière. Il n’y a pas une image très positive à en tirer.
Dans ce contexte, le casse et ses conséquences dramatiques n’est qu’un élément sur une pente fatale qui entraîne les trois ouvriers vers leur destruction physique aussi bien que morale.

Zeke, Jerry et Smokey ont fait la fête
Le film balance entre la comédie amère, les scènes cocasses abondent, et le drame. Sa réussite provient certainement d’avoir su conserver la tension entre ces deux pôles. Des scènes très drôles il y en a, que ce soit Zeke qui apostrophe le syndicat, ou encore les trois amis qui s’en vont faire la fête, sniffer de la coke et baiser. Mais les scènes dramatiques sont tout aussi forte, notamment la mort de Smokey, ou la peur qui s’empare peu à peu de Jerry.

Smokey sera assassiné
Si beaucoup privilégient Paul Schrader scénariste, il ne faut pas oublier que c’est également un réalisateur très doué, qui ne filme pas n’importe comment ou platement. Ici, bien sûr, il va user d’un style très proche du documentaire, piéger la saleté et le délabrement de la ville, la pauvreté des logements, la misère des consommations. L’image ne sera donc pas tellement policée, léchée, au contraire, elle a un côté brut. L’intérieur de l’usine est filmé de cette même manière, privilégiant finalement les objets par rapport aux individus, dénonçant ainsi la déshumanisation latente du capitalisme moderne. Volontairement les scènes d’action qui sont finalement plus nombreuses qu’on pourrait le croire, sont escamotées, parce que justement l’action est juste la conséquence de la matérialité de l’existence et non pas l’inverse.

Jerry et Zeke finiront par se battre
Les acteurs sont plutôt bons. Harvey Keitel, habitué de ce genre de rôles, Yaphet Kotto, et dans une moindre mesure Richard Pryor qui en fait tout de même un peu trop dans le genre grimacier. On sait que le tournage du film a été difficile notamment à cause de l’opposition entre Harvey Keitel et Richard Pryor. Ça ne se voit pas trop à l’écran, probablement parce que dans le déroulement de l’action, les relations entre Zeke et Jerry se dégradent fortement.
On retiendra quelques scènes étonnantes, par exemple celle d’un ouvrier, très gros, qui se bagarre avec la machine à distribuer les boissons et qui sera mis à pied pour avoir détruit le matériel. La fiesta chez Smokey avec de la coke et des filles plus que complaisantes.
 votre commentaire
votre commentaire
-
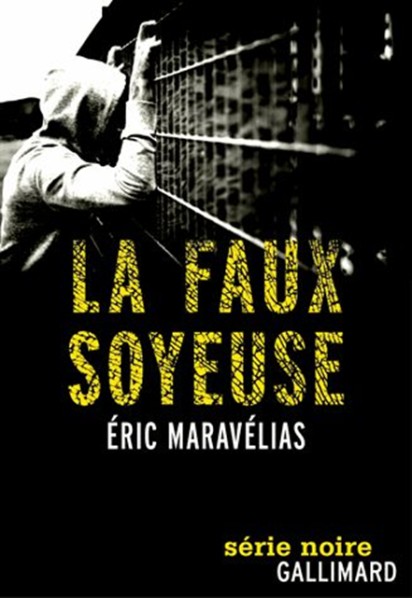
Ça fait quelques mois que cet ouvrage est sorti. Ce texte a d’abord tourné sur Internet apparemment avant que, retravaillé, finalement la Série noire s’en empare. Il est vrai que ces derniers temps les publications de la Série ne présente guère d’intérêt. Mais ici c’est différent. C’est un livre très fort, avec un vrai style. Bref une réussite. C’est bien rare que des romans noirs récents m’enthousiasme. Mais ça arrive de temps en temps. Et c’est le cas ici.
Pour être noir, c’est noir. C’est l’histoire d’une déchéance plutôt longue qui dure des années. Une descente aux enfers dans le milieu des toxicos. Mais derrière cela il y a aussi une vengeance qui va se dérouler sous nos yeux. Deux temps donc, un passé plus ou moins lointain et un présent saignant comme la conséquence fatale. Rien n’est épargné au lecteur, et les détails bien crasseux donnent une authenticité à cette histoire qui se passe dans la banlieue sud de Paris Cachan, Sceaux, Bourg la Reine, à la croisée de deux mondes : la norme et la marge.
Tout cela a été dit ici et là. Eric Maravélias a aussi déclaré que ses influences devaient être recherchées du côté d’Edward Bunker et James Lee Burke. C’est plus juste pour Bunker que pour Burke il me semble, mais la parenté me paraît encore pourtant plus évidente avec un autre roman de la Série noire, roman aujourd’hui un peu oublié, La scène de Clarence L. Cooper, roman écrit en 1960 et publié en France en 1962 qui se passait dans le milieu du jazz de ces années-là. Clarence Cooper était aussi un toxico, et il est mort probablement d’une overdose à quarante quatre ans.
Pour le dire plus simplement des récits de camés, il y en a finalement pas mal. Et donc contrairement à ce qu’on pourrait penser à priori, l’intérêt premier de l’ouvrage de Maravélias n’est pas qu’il ait été lui-même drogué et qu’il ait connu de l’intérieur ce milieu, quoique cela ajoute un sentiment de vérité que peu de romans atteignent facilement. Ce qui me paraît plus intéressant, c’est le style. Cette importance du style se retrouve à deux niveaux, une utilisation très juste d’un vocabulaire particulier à la banlieue et aux drogués, notamment dans les dialogues, et aussi une capacité à mettre en scène des sentiments plus ou moins confus qui se trouvent au-delà des normes communes, en rupture avec les codes sociaux dominants. Malgré la dureté des situations, il y a une vraie tendresse, aussi bien chez Marévélias pour ses personnages, que chez ces rebuts de l’humanité qui se décomposent sous nos yeux. Et puis il y a ce rendu de la fatigue, de l’épuisement, qui prend aux tripes. Le cerveau est rongé, autant que les sens, le corps s’efface et s’effrite dans la violence et l’ennui du quotidien.
C’est donc un excellent roman, rare dans la production polardière actuelle. Certes on peut reprocher ici et là quelques petites choses, des répitions de vocabulaire, ou encore le bref passage bien inutile à la fin d’un rappel sur les racines du mal de vivre de Frank qui plongeraient finalement dans l’enfance.
 votre commentaire
votre commentaire
-
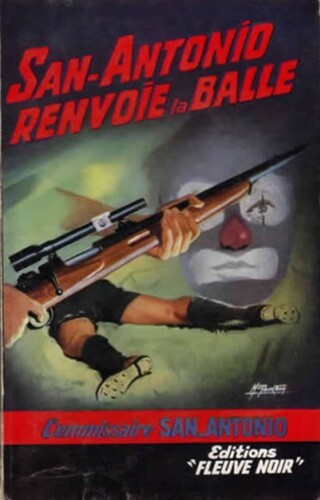
Frédéric Dard a connu un peu des vaches maigres lors de son arrivée à Paris, ce qui l’a amené à multiplier les possibilités de gagner de l’argent en écrivant des pièces de théâtres, des scénarios et des dialogues pour le cinéma et encore des petites blagues pour la revue qu’il animait quasimen tout seul, Cent blagues. Je n’oublie pas non plus les nouvelles souvent remarquables qu’il produisait aussi. Cette prolixité se retrouvait dans les nombreux pseudonymes qu’il utilisait ici et là pour gagner enore un peu plus d’argent. En effet, même si les romans policiers se vendaient bien, ils étaient publiés dans des collections peu ônéreuses et donc ne rapportaient que peu d’argent à leur auteur. Il fallait donc pour qu’un écrivain de polar puisse vivre de sa plume qu’il écrive très vite et beaucoup. Pendant longtemps Frédéric Dard écrivait au moins un roman par mois. Il y avait évidemment du bon et du moins bon. Frédéric Dard gardait l’usage de son véritable patronyme pour écouler ce qu’il pensait être le meilleur de sa production. Sous le nom de Frédéric Dard il écrivit toute une série de romans noirs de très haute qualité. A la fin des années cinquante d’ailleurs ces romans dont beaucoup arrivaient à être adaptés à l’écran, avaient au moins autant de succès que San-Antonio.

En effet pour ce dernier le succès ne vint pas d’un coup. Les tirages n’ont augmenté que progressivement, et même si elles ont toujours bien marché, les aventures du commissaire et de ses acolytes n’explosèrent que dans les années soixante. Pour compléter ce que disait déjà Thierry Gauthier au colloque de Dijon cette année, San-Antonio fut un auteur des années soixante. En effet c’est dans cette période que son style va s’affermir, et que prenant conscience de son propre succès, il va admettre enfin que San-Antonio c’est aussi autre chose que de la littérature commerciale. Mais plus encore ces ouvrages marquent une sorte de transition entre la France rurale et pauvre de l’avant guerre et la France dynamique et moderne qui s’en va dans les années soixante vers la société de consommation.
San-Antonio renvoie la balle est un de ces jalons sur le chemin de la gloire. C’est une histoire policière. Durant un match de football de l’équipe de France, l’arbitre est assassiné de deux balles en plein cœur. Mais également un autre spectateur meurt d’un coup de pistolet. San-Antonio qui assiste au match accompagné de Bérurier, va prendre les choses en mains et résoudre l’énigme. Comme l’arbitre vient des pays de l’Est on pense à une histoire d’espionnage et on a tord. En vérité il s’agit des séquelles de la Seconde Guerre mondiale.
Entre temps on aura eu droit à l’ambiance d’un match de football et à la visite d’un cirque. Deux loisirs très populaires auxquels Frédéric Dard donne un aspect très français. Car ce qui va dominer c’est cette volonté du commissaire San-Antonio de se présenter comme un représentant de la fierté et de la grandeur de la France. Les remarques désagréables sur les étrangers, et particulièrement les Anglais, abondent.
Quant au style, il présente ici une avancée significative dans la mise en scène de Bérurier et de ses turpitudes. Les absurdités abondent, et le manque de dignité de Bérurier atteint des extravagances jusqu’ici inusitées. Les jeux de mots sont abondants, mais pas très recherchés. En tous les cas, ce qui domine, c’est la qualité de l’intrigue, on l’oublie trop souvent, la plupart des San-Antonio recèlent une intrigue suffisamment élaborée.
C’est le 40ème San-Antonio publié au Fleuve noir, et c’est déjà le quatrième de l’année 1960. Il y en aura un cinquième. Cette même année-là, il aura eu le temps d’écrire aussi deux Frédéric Dard, Les mariolles et Puisque les oiseaux meurent.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires



