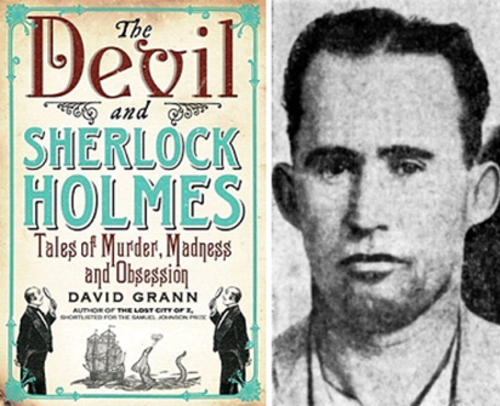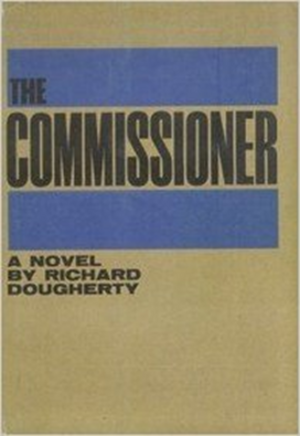-
Le film est basé sur l’histoire vraie de Forrest Tucker, un braqueur de banques aux évasions multiples qui finira sa vie en prison. Pour cela David Lowery adaptera une des histoires racontées par David Grann dans son recueil, The devil and Sherlock Holmes. Cependant par souci de simplification, il ne va pas raconter toutes les anecdotes d’une vie riche en rebondissements divers et variés, mais se concentrer plutôt une petite partie de l’existence de Tucker, celle qui est datée dans le film de 1981, et qui s’articule autour d’une relation amoureuse avec Jewell qu’il finir pas épousée. D’après les spécialistes de la question, le film est assez fidèle à ce qu’a été la vie de Tucker, sauf que l’histoire qu’il raconte se passe un peu plus tôt, dans les années soixante-dix, époque où les braqueurs de banque étaient encore considérés aux Etats-Unis comme des héros, certes un peu négatifs, mais des héros tout de même. Cependant on va voir que la référence aux années quatre-vingts est finalement un bon choix puisque cette époque crépusculaire vit en quelque sorte la fin de la saga des braqueurs de banque, comme chez nous d’ailleurs. Comme souvent dans ce genre de film, on va avoir deux histoires imbriquées, celle des aventures de Tucker, ses rêves et ses amours, et celle du policier John Hunt qui va le poursuivre. Ce dernier thème implique que le policier et le truand se respectent suffisamment pour que la poursuite soit intéressante, on retrouve ça sous forme de drame très noir en 1995 dans Heat par exemple le très bon film de Michael Mann, ou en 2002 dans Catch Me If You Can, de Steven Spielberg, sous forme de comédie un peu gnangnan. Récemment aussi on avait eu un film un peu du même genre : Stand ups guys de Fischer Stevens en 2013, bien qu’il soit traité du point de vue de l’amitié virile d’un trio de vieux brigands plutôt que du côté de la solitude d’un vieil homme en train de s’effacer. Dans le film de David Lowery cette question de l’amitié virile se révélera plutôt secondaire, voire presqu’inexistante, quoique le héros représente toutefois une certaine éthique, ne serait-ce que celle du travail bien fait. On est donc dans du classique si on peut dire.
Forrest Tucker est en quelque sorte le leader d’un trio de gangsters vieillissants. Ils braquent pénardement les banques pour des sommes souvent assez dérisoires, ce qui les obligent évidemment à travailler très souvent. C’est Tucker qui opère, avec Waller en couverture à l’intérieur de la banque, et Teddy Green qui a l’extérieur attend au volant de la voiture pour prendre la fuite. Tucker bien qu’armé travaille en douceur, sans élever la voix, presqu’en demandant gentiment qu’on lui remplisse son sac, il est toutefois muni d’un sonotone qui en fait est un scanner qui lui permet d’anticiper les déplacements de la police en se branchant sur leur fréquence. En revenant d’un hold-up tranquille, il va rencontrer Jewell, une veuve qui s’ennuie dans la vie et à laquelle il va s’attacher. Tandis que le policier John Hunt tente de remonter la piste de Tucker, celui-ci met en place un gros coup qui devrait lui permettre entre autres choses de racheter les hypothèques du ranch de Jewell. Le coup va réussir, les bandits laisseront l’argent, préférant une petite fortune en or, bien que Teddy soit blessé, mais des cassettes de vidéo-surveillance vont laisser entrevoir un portrait de Tucker. Les choses vont évoluer rapidement quand la propre fille de Tucker va écrire à John Hunt pour dénoncer son propre père. Cependant celui-ci va garder les informations pour lui parce qu’il a été dessaisi de l’affaire au profit du FBI. Il rencontrera d’ailleurs par hasard Tucker dans les toilettes d’une cafeteria. Celui-ci va cependant tomber parce que quelqu’un d’autre a parlé, on ne saura pas qui. Il va donc aller en prison où John Hunt viendra lui rendre une petite visite amicale. C’est là que Jewell va découvrir qui il était vraiment, mais elle va l’aider et va l’attendre a sa sortie de prison, espérant qu’il va enfin s’assagir, après tout il est vieux maintenant, il peut prendre du bon temps. Mais au bout de quelque temps, cette vie paisible et bourgeoise ne lui conviendra plus, il retournera braquer des banques, quatre dans la même journée et se fera prendre. Il ira finir sa vie en prison.
Forrest Tucker rencontre Jewell en revenant d’une attaque de banque
Ce film très nostalgique c’est d’abord la nostalgie d’un certain cinéma, ce cinéma populaire qui a fait la gloire de Robert Redford. Par exemple Butch Cassidy and Sundance Kid, film au succès planétaire qui donne une aura romantique à des entreprises criminelles. Un des premiers rôles qui avait fait connaitre Robert Redford c’était celui de Charlie Reeves dans l’excellent The chase d’Arthur Penn dont la vedette était Marlon Brando. Le film de David Lowery reprendra d’ailleurs quelques images de ce film pour figurer une des multiples évasions de Forrest Tucker. C’est donc tout à fait un film dans la tradition des rôles que Redford a interprété au cours de sa très longue carrière. Le scénario a été un peu gauchi, tirant sur le politiquement correct. John Hunt est marié à une afro-américaine, et Teddy Green est noir, ce qui n’était pas le cas du véritable Teddy Green. Mais glissons sur ses petits accommodements à la mode que pour ma part je ne trouve pas utiles et revenons à la thématique du film : ce sont des vieux qui commettent des actes criminels pas seulement pour l’argent, mais surtout pour ce refus de se laisser mourir en croupissant dans une vie normale. C’est un phénomène qui commence à prendre de l’importance dans les sociétés occidentales vieillissantes, les vieux refusent de disparaître et se prolongent au-delà du nécessaire. Ce film devrait être la dernière interprétation de Robert Redford qui a dépassé 82 ans et fait figure de vétéran à Hollywood. C’est comme un adieu à lui-même et à ce qu’il a été.
Forrest Tucker travaille en souplesse, avec son sonotone pour surveiller la police
Tucker est en vérité un solitaire qui finalement n’attend qu’une chose de la vie qu’on l’attrape enfin. Il sera trahi évidemment par les siens, et en premier lieu par sa propre fille qui lui manifeste une aigreur terrible parce qu’il ne s’est jamais occupé d’elle. Jewell ne le trahira pas, mais c’est déjà une vieille femme qui n’attend plus grand-chose de la vie. Le policier John Hunt est là en observateur, incapable de conclure quoi que ce soit sur ce qu’il doit faire, ce ne sera pas lui qui arrêtera ce voleur apparemment insaisissable. Le film est donc le portrait d’un homme complètement perdu dans l’Amérique qu’il ne comprend pas. Et sans doute aussi que Robert Redford n’a pas très bien compris ce qui était arrivé au cinéma américain qui est devenu dans l’ensemble si médiocre. C’est peut-être là que git finalement le principal intérêt de ce film. D’ailleurs Lowery bâclera ce qui aurait pu être le clou du film l’exécution du gros coup. A moins que celle-ci ait disparu au montage. Le film ne durant qu’à peine plus d’une heure et demi, ce qui est un peu léger aujourd’hui.
Le trio de vieux gangsters met en place un coup énorme
Si la problématique n’est pas très clairement définie, la réalisation n’est pas très remarquable non plus. Curieusement alors que sa durée est relativement brève, le film parait très long pour le spectateur. C’est très mal équilibré. Le début est intéressant, à voir claudiquer Robert Redford manifestement pas dans une forme physique éblouissante, mais la romance entre Jewell et Tucker est interminable. Il y a une utilisation un peu lourde des symboles, ces fenêtres qui s’ouvrent sur nulle part et qui indique une soif de liberté, même chose avec les chevaux qui, comme dans Asphalt Jungle, sont la promesse d’un ailleurs qui n’existera jamais. L’image est sombre et terne, bien qu’elle filme complaisamment les marques de la vieillesse des principaux acteurs. Les attaques répétées de Tucker aux guichets des banques sont filmées sans grâce, avec des plans rapprochés, camp, contrechamp, qui finalement cassent l’émotion qu’il peut y avoir lorsqu’un employé de banque est menacé d’un révolver. La profondeur de champ est assez peu utilisée, sauf au moment de la préparation du grand casse de la banque, et de même les courses de voiture sont peu travaillées. Certes tout le monde ne peut pas être un spécialiste des films d’actions, mais des voleurs ce niveau-là sont aussi des gens qui ont forcément des émotions très fortes et qui marchent à l’adrénaline, là, la tension reste absente. Lowery opère trop souvent par ellipses dans les moments clés ce qui non seulement ralenti le rythme, mais finit par dédramatiser la situation. On ne verra pas non plus Tucker en train de commettre l’une de ses évasions spectaculaires, c’est à peine si elles sont suggérées. Le parti pris est celui de la mise en scène de la vieillesse, mais alors pourquoi choisir un braqueur de banque et refuser tout ce qui peut ressembler à des scènes d’action ? Pourquoi ne pas prendre un vieil instituteur ? Le côté bancal de l’affaire vient aussi qu’on ne connaitra rien de la vie sentimentale passée de Tucker, alors même que sa fille le vend à la police. Quelles sont ses motivations réelles ? Ni film noir, ni comédie policière, The old man and the gun finit par ne plus ressembler à rien.
C’est la propre fille de Tucker qui va mettre la police sur ses pas
L’interprétation c’est d’abord Robert Redford qui effectivement fait un adieu assez pathétique à sa jeunesse et à son physique de séducteur. C’était en effet pour une grande partie grâce à son physique de séducteur qu’il avait connu le succès, le choix de ses films faisant le reste par la suite. Il n’a jamais été un acteur très nuancé, plutôt monolithique, il excellait dans les rôles de quasi-mutiques. Certains ont voulu voir dans cette ultime prestation un de ses meilleurs rôles. C’est bien exagéré, malgré tout Robert Redford aura fait quelques très beaux films, notamment sous la direction de Sydney Pollack. Mais le film se base sur cette capacité de Redford à mettre en scène sans complexe les misères du naufrage de la vieillesse. Il ne masque pas cette déchéance physique qui tôt ou tard atteint tout un chacun, même les icônes d’Hollywood. On l’a dit, il marche difficilement, comme un très vieil homme, mais son visage est maintenant parcheminé, fripé sous une touffe de cheveux pas encore tout à fait blancs. Il joue un homme de 60 ans, mais il fait bien plus que les soixante-dix. Au début cela renforce le côté pathétique du film, mais ensuite, ça frise un peu l’indécence. Ça rappelle un peu le film de Jeff Kanew, Tough guys, film policier qui réunissait Kirk Douglas et Burt Lancaster en 1986, pour un improbable retour encore une fois sur deux anciens voyous tentant un coup ultime, chapeau compris. Sauf que c’était là une comédie sans prétention à disserter, alors qu’ici ce devrait être un drame teinté de mélancolie. Dans le rôle du policier il y a le toujours très bon Cassey Affleck, acteur fétiche de Lowery, il est parfait dans le rôle de celui qui compte les points en réunissant les fils de l’énigme. On se demande pourquoi on ne le voit pas plus souvent. Sissy Spacek, vieille gloire d’Hollywood, couronnée star pour ses prestations dans Badlands de Terence Mallick et surtout dans Carrie de De Palma, est ici la vieille Jewell qui tombe amoureuse de ce vieux voyou de Tucker. C’est une très bonne actrice, très représentative de cet Hollywood de gauche qui tente de dépasser le simple entertainment pour aller vers le film à message. Elle est très bien. On retrouvera tout au long de ce film des tas de visages vieillis et presque disparus comme Danny Glover dans le rôle de Terry, ou de Tom Waits dans celui de Waller. Keith Carradine fera aussi une petite apparition. Ils ont tous une belle présence.
John Hunt croise par hasard Tucker
L’ensemble laisse donc un goût très partagé, et sans doute cela ne laissera-t-il guère de traces dans les mémoires si ce n’est pour dire, c’était la dernière apparition de Robert Redford en tant qu’acteur. Si le film a bénéficié généralement de très bonnes critiques, le public a traîné les pieds pour en faire un succès. Sans doute est-ce un peu dérangeant de voir un ancien séducteur de l’écran dans le rôle d’un très vieux bonhomme bien abimé par la vie, mais le plus important est qu’on finit par se perdre dans les intentions de l’auteur et finalement par se désintéresser de l’histoire elle-même, alors que le vrai Forrest Tucker est un personnage très haut en couleur qui sans doute méritait un peu mieux.
A sa sortie de prison, Jewell sera là
 votre commentaire
votre commentaire
-
Décidemment l’année 1968 a été un excellent cru pour le film noir ou plus précisément pour sa tendance néo-noir. Cette année-là, on eut droit à Bullitt de Peter Yates[1] et à Point blank de John Boorman[2]. Bullitt se passait à San-Francisco, Point blank, à Los Angeles principalement. Il était donc dans l’ordre des choses que Madigan se déroule à New York. Dans les trois cas les décors urbains réels jouent un rôle décisif. L’histoire ne se veut pas héroïque, ni même extraordinaire, mais plutôt ancré dans le quotidien des policiers. Le scénario est basé sur un ouvrage de Richard Dougherty qui n’a jamais été à ma connaissance traduit en français. Dougherty était d’abord un journaliste, et c’est sans doute de cette expérience de journaliste qu’il a tiré son roman. The commissioner veut dire en anglais « le commissaire », soit le chef de la police. En vérité le film déborde le personnage du chef de la police largement et donne un rôle décisif au policier Madigan.
Une paire de flics, Rocky Bonardo et Dan Madigan, tentent d’arrêter un truand nommé Benesch. Mais ils font une erreur, et il leur échappe après leur avoir volé leurs armes. Cela va leur valoir des remontrances aigües. Le chef de la police, Russell, leur donne 72 heures pour le retrouver. Mais Russell a bien d’autres soucis, Charley Kane qui est aussi bien son meilleur ami que son fidèle lieutenant, semble avoir cédé au trafic d’influence. Il ne sait pas quoi faire et n’ose même pas en parler avec lui. Madigan et Bonaro suivent une fausse piste, tandis que Russell essaie de mettre un peu d’ordre dans ses relations avec sa maîtresse, la belle Tricia. Il va parler à Kane et lui demander des explications. Celui-ci avoue que c’est son fils, qui est aussi membre de la police qui s’est fait piéger bêtement par le truand, et donc qu’il l’a couvert. Kane propose de démissionner, mais Russell n’accepte pas. Pendant ce temps Madigan et Bonaro cherchent Benesch, ils vont se servir pour cela d’un nain, Castiglione, qu’ils retrouvent à Coney Island et qui les met sur la piste d’un certain Hughie qui fournit Benesch en filles. Madigan et Bonaro bouscule un peu Hughie et celui-ci se fait coopératif. Comme il ne sait pas où loge Benesch, il faut attendre le soir que le truand contacte Hughie. Madigan va accompagner sa femme à une soirée de la police, mais il doit rapidement s’esquiver. Le temps qu’il rejoigne Bonaro, deux autres policiers en tenue ont aperçu Benesch, ils vont essayer de l’arrêter, mais celui-ci leur tire dessus et arrive à s’enfuir. La femme de Madigan flirte un moment avec un autre policier qui assiste au bal, mais elle refusera d’aller plus loin. Finalement Hughie arrive à loger Benesch et appelle Madigan. La police est sur les dents, l’hôtel où s’est réfugié Benesch est cerné bien peu discrètement. Madigan et Bonaro montent à l’assaut, ils vont flinguer Benesch, mais Madigan sera mortellement blessé, laissant sa femme au désespoir qui invective Russell et le désigne comme responsable de la mort de son mari.
Dans le petit matin les flics attendent
Cet excellent scénario est dû à Abraham Polonsky dont la carrière a été malheureusement tronquée et massacrée pour cause de chasse aux sorcières dont il fut une victime. Il oppose deux lignes différentes, d’un côté Madigan et Bonaro confrontés à leur travail de rue, difficile et harassant, incertain et dangereux, et de l’autre les problèmes de la hiérarchie et l’amitié entre Russell et Kane qui est en train de craquer. Cette opposition a un double intérêt : d’une part, elle permet de tracer une ligne de démarcation entre le haut et le bas de l’échelle, car même si le commissaire et son adjoint connaissent bien les problèmes de la police, ils ne sont plus confrontés à la réalité du quotidien. On verra d’ailleurs Russell qui est un homme un peu rigide et qui se veut intègre, jalouser sans le dire le fait que Madigan profite de son statut de policier pour bénéficier de menus avantages, se faire offrir des repas, une chambre dans un hôtel de luxe, alors que Kane par son laisser-aller apparaît comme finalement plus dangereux pour le bon fonctionnement de la police. C’est sans doute cela qui va conduire Russell finalement à avoir un peu plus d’indulgence, comme le lui demande d’ailleurs Tricia. D’ailleurs sa relation adultérine avec Tricia va lui montrer que la frontière entre le bien et le mal est plus que floue. Mais une grande partie du film c’est aussi le travail de Madigan et de son acolyte qui se donnent beaucoup de mal pour piéger Benesch, et s’ils n’emploient pas des moyens très orthodoxes, ils représentent une certaine efficacité. Madigan apparaît sous ses airs bourrus, comme un homme finalement très moral, très droit derrière les apparences. Cela se voit dans la façon dont il s’adresse au nain sur le bord de la plage. Contrairement à Russell, il n’a aucun doute sur ce qu’il est. En filigrane il y a aussi l’amitié entre Bonaro et Madigan qui est le contrepoint de l’amitié entre Russell et Kane.
Madigan et Bonaro veulent surprendre Benesch
C’est un très grand Don Siegel, qui signe ici Donald Siegel. Très à l’aise avec la description du travail de rue, et Madigan annonce certainement le douteux inspecteur Harry. La réalisation est impeccable – il y a bien quelques transparences assez médiocres, mais après tout chez Hitchcock aussi n’est-ce pas – avec une utilisation excellente de l’écran large qui permet de donner de la profondeur de champ aux larges avenues de New-York. Les scènes tendues sont particulières réussies, que ce soit le début lorsque Madigan et Bonaro tentent d’appréhender Benesch, ou que ce soit la fausse alerte quand ils pénètrent dans le bistrot par la porte de derrière, avec une saisie sur ces arcades qui ouvrent sur une situation potentiellement dangereuse. La fusillade finale est aussi tout à fait convaincante. Il y a une science du mouvement qui est étonnante, aussi bien dans les larges panoramiques qu’en ce qui concerne les mouvements de caméra dans des espaces étroits.
Russell apprend que son meilleur ami fricote avec la pègre
L’interprétation c’est d’abord Richard Widmark, ici il n’est pas trop cabotin, il est le pivot de tout le film. Il est excellent. Henri Fonda est moins intéressant, il a même l’air de s’ennuyer un peu. Certes il joue le rôle d’un homme froid et distant, mais il n’est pas vraiment remarquable. James Withmore dans le rôle de Charley Kane montre ici toute les nuances de son jeu. C’était un très grand acteur, il le démontre encore ici. Harry Guardino qu’on retrouvera dans d’autres films de Don Siegel, notamment Dirty Harry, est lui aussi très bon. Les femmes sont très bien, que ce soit Susan Clark dans le rôle de Tricia, ou d’Inger Stevens dans celui de Julia. Mais il y a deux acteurs qui attirent l’attention sur eux, d’abord Michael Dunn dans le rôle du nain Castiglione et puis Don Stroud dont on se demande encore comment il n’a pas fait une meilleure carrière, dans le rôle de Hughie.
Tricia est écartelée entre son mari et son amant
C’est donc un excellent film qui se revoie très bien malgré les cinquante années qui nous séparent maintenant de sa sortie. Le rythme est soutenu. Ce sera un gros succès public, ce qui amènera d’ailleurs à produire une série télévisée intitulée Madigan. Cette série de six épisodes a la particularité d’avoir été écrite pour partie par le grand William P. McGivern. Pour ce faire on ressuscitera Madigan ! Tout cela démontre qu’à la fin des années soixante, il y avait un engouement très fort pour cette tendance néo-noir qui cherchait à mettre en scène une vérité aussi bien matérielle que psychologique.
Madigan et Bonaro cherchent à rentrer par la porte de service
Derrière la vitre, ils observent celui qu’ils croient être Benesch
Madigan va voir son ancienne maîtresse
Madigan et Bonaro flinguent Benesch
 1 commentaire
1 commentaire
-

C’est un film noir très étrange, je crois qu’il est même unique en son genre. Non pas tant en ce qui concerne l’intrigue et son déroulement, mais dans le traitement graphique des décors et leur stylisation. Le scénario est de Jonathan Latimer, certainement un des auteurs de romans noirs le plus sous-estimé, mais aussi un scénariste de premier plan qui travaillait souvent avec John Farrow à cette époque. Le scénario est très fidèle au roman de Kenneth Fearing. Il avait été traduit en français par Boris Vian en 1947. Il y eut par la suite des rééditions multiples de cet ouvrage qui n’est pas un polar ordinaire. En effet Fearing était un personnage très particulier, un poète pour tout dire, un intellectuel, mais surtout très engagé à gauche, ce qui lui attira les foudres de l’HUAC au moment de la chasse aux sorcières. Il fonda également la Partisan Review une revue très à gauche qu’on a dite ensuite financée par la CIA – ce qui semble étonnant parce que la CIA s’occupait plutôt de financer des activités anti-communistes à l’étranger. Ce contexte particulier va expliquer pour partie le sens de The big clock. Et ce sens est très bien compris par Jonathan Latimer aussi bien que par John Farrow qui tous deux étaient classés très à gauche, même s’ils n’étaient pas membre du parti communiste.
George Stroud travaille pour les publications Janoth, un magnat de la presse, au département criminel. Il a réussi un joli coup en découvrant Fleming qui était en fuite. Janoth le félicite car il faut que le journal trouve de nouvelles manières de faire augmenter le tirage. George se dispute avec son patron, car celui-ci veut l’envoyer au-devant de Fleming alors qu’il aimerait bien partir en vacances avec sa femme à qui il a promis une vraie lune de miel. Il va affronter Janoth et celui-ci le vire. De colère George se retrouve à boire dans un bar en attendant d’aller rejoindre sa femme pour prendre le train. Mais dans le bar il rencontre une femme, Pauline York, la maîtresse de Janoth. Elle l’accroche et prétend monter contre Janoth une sorte de chantage. George refuse, mais Pauline l’a fait boire, et il perd la notion du temps. Ils se retrouvent à errer dans les rues de New York, juste au moment où ils achètent une peinture signée Patterson chez un antiquaire. De là ils rejoignent un bar où George est très connu. Ensuite George se retrouve chez Pauline, mais il s’endort. Il est réveillé par Pauline qui lui dit que Janoth va arriver et qu’il faut qu’il parte. Ce qu’il fait. En partant il aperçoit Janoth qui arrive. Celui-ci va avoir une violente dispute avec Pauline, et il la tue. Il s’en va chez Hagen son fidèle lieutenant en lui demandant de le couvrir. Ils vont trouver une solution bâtarde : tenter de faire porter le chapeau au mystérieux individu qui accompagnait Pauline dans ses pérégrinations nocturnes. Mais comme ils ne savent pas qui c’est, ils vont demander à George de le trouver ! celui-ci ne peut pas refuser, parce qu’il comprend que c’est la seule chance qu’il s’en sorte en trouvant le coupable avant tout le monde. Au fur et à mesure que l’enquête avance et se resserre autour de lui, George comprend que le meurtrier est Janoth. Mais il est piégé dans le building de Janoth, il ne peut même pas retrouver le chauffeur de taxi qui a conduit Janoth, l’homme de main de celui-ci l’a soudoyé pour qu’il ne parle pas. Avec l’aide de sa femme il va accuser Hagen pour que celui-ci réagisse et finisse par se détacher de Janoth. C’est ce qui se passe, Janoth tue Hagen et croyant fuir, il tombe dans la cage de l’ascenseur.
George Stroud tente d’échapper à la surveillance des gardiens
Avec des rebondissements constants, l’intrigue est solide et soutient l’attention en permanence. Mais derrière cette apparence se cache une métaphore du capitalisme prédateur. En voyant ce film on pense aussi bien à Citizen Kane qu’à Scandal sheet de Phil Karlson sur un scénario de Samuel Fuller, qu’à Park row de ce même Samuel Fuller. Le film explore donc la face noire d’un magnat de la presse. Ce tyran est aussi un criminel, et Hagen son complice dans cette œuvre de mort. Le temps c’est de l’argent selon la devise de l’abominable Benjamin Franklin, c’est comme cela que compte Janoth, et c’est pourquoi son immeuble est couronné d’une série d’horloges qui donnent l’heure de tous les coins du monde. Le capitalisme repose clairement sur a maîtrise et le découpage du temps[1]. Toutes les minutes sont comptées et celui qui perd du temps est mis à la porte. La corruption c’est de l’argent et Janoth s’en sert, mais cela passe aussi par la corruption du temps de ses employés, il vole le temps des époux Stroud. Le temps c’est la plus-value, tous les marxistes vous le diront. Au-delà de l’aspect criminel du magnat, et donc du capitalisme, il y a la crainte qu’il inspire à tous ses employés. Mais en même temps ses employés espèrent bien à l’image du sinistre Bill qui se fait maltraiter mais qui masse son patron presqu’avec amour, des retombées en argent ou en attention. Pauline cherche à faire chanter Janoth. Et après tout, si George se retrouve au service de Janoth, c’est bien qu’il espérait en tirer des bénéfices. Masi George représente aussi la conscience de classe. Dès le départ on le voit contester la toute puissance de Janoth en se moquant de lui devant tout le monde, et en moquant aussi ceux qui le craignent. Il est donc dans la position du révolté qui n’attend qu’une occasion pour passer à l’attaque. La morale de l’histoire est qu’il vaut mieux renoncer à la richesse et ne pas vivre à genoux. Contrairement à ce qu’on a dit, ce n’est pas un film léger, bien au contraire, l’oppression est permanente et va être renforcée par la façon dont en permanence George doit éviter d’être reconnu par les témoins qui l’ont vu avec Pauline. Ce n’est pas du Hitchcock. Pendant longtemps George échappe à Janoth parce que les témoins en guise solidarité mentent ouvertement pour le protéger car ils ont compris la nocivité de Janoth.
Le conseil de rédaction attend dans la crainte le terrible Janoth
Sans doute le plus important réside dans la réalisation elle-même. D’abord, il y a cette structure en flash-back qui nous montre que George est prisonnier de la grande tour dans un endroit vide et aseptisé, sans aspérité. On va donc utiliser astucieusement la pénombre de l’immeuble plongé dans le silence de la nuit. Mais ces ombres sont liées particulièrement à l’architecture des lieux. C’est une tour très haute, un symbole arrogant du capitalisme flamboyant. A l’intérieur, la hauteur des plafonds donne encore plus de poids à l’écrasante autorité de Janoth. Il y a ensuite cette rationalisation des lieux, étage par étage, qui ne laisse aucune place à la fantaisie. Et puis il y a ce design art déco qui accentue le côté tapageur de la richesse de Janoth. La photo est signée Daniel Fapp, mais en réalité elle semble devoir beaucoup à John Seitz. Le noir et blanc met particulièrement en valeur la flamboyance des décors qui représentent une menace permanente. L’immeuble est une réalité labyrinthique dans laquelle s’il est facile de se cacher, il est aussi facile de s’y perdre.
George Stroud démontre à Janoth comment il a fait pour trouver Fleming
On y trouve de très belles scènes, notamment l’ouverture qui voit George tenter d’échapper à la vigilance du gardien, mais aussi le conseil de rédaction dans une scène tellement magnifique qu’elle inspirera les frères Coen pour leur The hudsucker proxy. D’autres scènes du film des frères Coen s’inspirent de The big clock, dans l’utilisation de l’immeuble massif, comme un symbole phallique planté au milieu de la ville. Les scènes de foule, aussi bien la visite de la tour par les touristes que l’évacuation de l’immeuble pour tenter de trouver le fameux Jefferson Randolph, sont parfaitement filmées en plongée ou avec de larges panoramiques qui donnent une belle profondeur de champ, accentuant le poids de l’architecture. Il y aussi beaucoup de virtuosité dans le jeu de cache-cache auquel doit se livrer George pour échapper à sa propre enquête ! c’est bien l’art d’un vrai cinéaste que d’aller au-delà de l’histoire proprement dite en utilisant le langage particulier des images et de leur enchaînement.
Hagen demande à Stroud de découvrir qui est Jefferson Randolph
Le film est construit sur l’opposition de deux caractères, Janoth est incarné par Charles Laughton qui est méconnaissable dans le rôle de cette crapule manipulatrice. Il en devient même émouvant quand il se livre sans retenue à Hagen qui est le seul à pouvoir le sortir de ce mauvais pas. Il joue aussi bien les patrons autoritaires, que l’amant déçu et humilié par Pauline. George Stroud est le héros, une sorte de faux coupable, c’est Ray Milland qui l’interprète. C’est un acteur qu’en général je trouve un peu fade, mais ici il est très bien, comme s’il s’était réveillé pour ce film avant de replonger dans le coma. John Farrow a donné le rôle de l’épouse fidèle à sa propre femme, la belle Maureen O’Sullivan, anciennement femme de Tarzan qui avait délaissé les plateaux pour s’occuper de sa famille nombreuse – elle a eut en effet 7 enfants avec John Farrow ! Dont Mia Farrow. Il y aussi de très bons seconds rôles. Elsa Lanchester qui incarne la peintre un peu dérangée Louise Patterson. Harry Morgan dans le rôle de l’inquiétant Bill qui ne parle jamais, l’âme damnée de Janoth qui espionne peu discrètement George et qui ne craint aucun coup tordu.
Dans l’ombre de la grande horloge Stroud guette
Le film a fait l’objet de deux remakes inutiles et poussifs, No way out de Roger Donaldson, en 1987, l’histoire ayant été dépaysée dans l’antre des services secrets américains, et Police python 357 d’Alain Corneau, en 1976. Curieusement ce sont les frères Coen qui dans un style comique et parodique ont le mieux saisi l’importance du film de John Farrow dans l’hommage appuyé qu’ils lui ont rendu dans The hudsucker proxy. Certains prétendent que ce n’est pas un vrai film noir. Certes le héros s’en sort à son avantage, et il n’y a pas de femme fatale pour le perdre. Cependant, outre qu’il va être victime de la fatalité, il est aussi manipulé par une femme qui ne rêve que de vengeance. Il y a aussi cette oppression de la ville et de la verticalité de l’architecture qui en fait vraiment un film noir. C’est donc un très bon film noir qui a passé avec les honneurs l’obstacle des années.
George explique à sa femme pourquoi il risque d’aller en prison
Les époux Stroud incriminent Hagen pour le faire réagir
Deux images de The hudsucker proxy des frères Coen (1994)
 votre commentaire
votre commentaire
-

Il y a une tendance forte et affirmée dans le roman noir, celle des auteurs féminins qui insiste sur la perversité dans les relations de domination que subissent les femmes. Il y a eu la grande Margaret Millar, mais aussi l’excellente Dolores Hitchens, et puis il y a aussi Evelyn Piper de son vrai nom Marryam Modell. Ces femmes ont en commun de s’éloigner des niaiseries de type Agatha Christie, et d’avancer sur les voies dangereuses de la folie, des apparences et de la manipulation. Ces romans sont écrits du point de vue d’une subjectivité féminine, et en ce sens ils ne sauraient être écrits par des hommes – bien que Sébastien Japrisot et Frédéric Dard s’y soient essayés avec succès. On peut considérer que c’est une manière d’affirmation d’une sensibilité féminine qui s’éloigne des canons de la douceur et de la soumission à un ordre patriarcal. Les romans d’Evelyn Piper, américaine de naissance, ont été publiés en français chez Denoël dans la collection Crime-Club qui accueillait entre autres, Boileau-Narcejac, Hubert Montheilet, ou encore Louis C. Thomas et Sébastien Japrisot, des romans noirs à tendance neurasthénique. Comme on le voit cette collection avait un ton particulier et compte de très nombreux chef d’œuvres. Un autre roman d’Evelyn Piper a donné lieu à une belle adaptation cinématographique, il s’agit de The nany, La nounou en français, toujours en 1965, sous la direction de Seth Holt, avec Bette Davis qui s’était habituée l’âge venu aux rôles de sorcières. Otto Preminger va donc adapter un roman d’Evelyn Piper, et curieusement il va dépayser Bunny Lake is missing de New York à Londres. Pour des raisons qui ne sont pas connues et que lui-même ne dévoile pas dans ses mémoires. En vérité à cette époque-là, l’Angleterre a le vent en poupe, c’est le triomphe des Beatles et de la culture pop. Il dira qu’il a aimé travailler dans ce pays, tout en y jetant un regard un peu étonné sur ses mœurs.
Ann Lake vient d’arriver à Londres depuis quelques jours et accompagne sa fille à l’école. Elle signale à la cuisinière que Bunny âgée de quatre ans est dans la salle du 1er jour, celle-ci promet de la surveiller en attendant l’arrivée de la maîtresse. Ann s’empresse de retourner à sa nouvelle maison où les déménageurs l’attendent. Là elle se fait harceler par le propriétaire, un ivrogne cauteleux et collant. Mais quand Ann revient pour la chercher, Bunny a disparu. Elle appelle Steven qui arrive en vitesse, et tout le monde se met à chercher où a pu bien passer Bunny. Devant le peu de succès de ces recherches, il faut en appeler à la police. Celle-ci en la personne du superintendant Newhouse va interroger Ann et Steven. Il se rend compte alors que Steven et Ann ne sont pas mari et femme, mais frère et sœur. Mais en outre, il ne trouve personne qui a vu effectivement Bunny. Peu à peu on commence à douter que Ann ait réellement un enfant, la vieille madame Ford, la fondatrice de l’école, avance que celle-ci s’est peut-être créer un « ami imaginaire ». Newhouse ne désespère pas, et il va même rechercher la preuve que les deux Lake sont bien venus en bateau, avec Bunny. Ann, pour démontrer que Bunny existe bien va chercher une poupée qu’elle a porté à réparer. Mais alors qu’elle trouve cette poupée, elle est stoppée par Steven qui l’assomme et l’envoie à l’hôpital. Peu après, Ann va s’échapper de l’hôpital, et retourner vers la maison où elle trouve Steven en train de vouloir tuer Bunny et l’enterrer. Ann va retarder ce moment en incitant Steven à jouer avec elle comme quand ils étaient enfants. Jusqu’à ce que la police arrive finalement et mette fin à ce cauchemar.
Steven et Ann interrogent le personnel de l’école
Sans doute c’est l’aspect psychologique qui a intéressé Preminger, cette manière de passer sans trop de coupures de la vie réelle à la folie. Et puis le thème sous-jacent est très sulfureux puisqu’il traite de l’inceste comme d’un traumatisme dans l’éducation. En effet le frère et la sœur se sont retrouvés seuls au monde après le décès des parents, et se sont repliés sur leur relation. Mais en grandissant Steven qui s’était donné pour mission de protéger sa sœur n’a pas voulu admettre que Anne ait des relations sexuelles en dehors de lui et surtout qu’elle soit enceinte. Aussi, après l’avoir poussée à avorter, ce qu’elle refusera, il fera tout pour l’empêcher de se marier avec celui qu’il considère comme un intrus dans leur univers. Ann et Steven vivent dans un monde à part, coupés qu’ils sont de la réalité ordinaire. La disparition de Bunny va en fait être le révélateur : Ann va sortir de son somnambulisme et comprendre enfin que son frère est complètement fêlé. Jusqu’alors, elle s’en remettait à lui pour toutes les choses de la vie courante, c’est lui qui faisait les démarches administratives, c’est lui qui assurait leur existence matérielle. C’est donc l’histoire d’une émancipation. C’est d’ailleurs cette émancipation qui va faire voir que le plus dépendant des deux dans cette relation incestueuse est Steven et non Ann.
La vieille madame Ford explique le rôle des amis imaginaires chez les enfants
Cette histoire plutôt dense va être mélangée habilement dans le décor très lisse d’une enquête policière menée par le superintendant Newhouse, un policier calme et blasé, mais obstiné. En apparence, Steven est une excellente personne, il travaille pour le FMI, il a donc un bon salaire, voyage beaucoup et il est très sophistiqué. Mais peu à peu on va s’apercevoir que tout cela n’est qu’un masque, on le comprend mieux quand on voit Ann porter une cigarette à Steven qui se trouve dans son bain. Evidemment le pot aux roses est dévoilé dès lors qu’on voit Steven assommer sa sœur et ensuite brûler la poupée de Bunny avec beaucoup de délectation. L’ensemble de cette sombre histoire est filmé à travers des symboles, les poupées qui représentent à la fois l’enfance, mais aussi une malfaisance latente, c’est ce qu’explique d’ailleurs le vieil ivrogne qui loue sa maison aux Lake et qui propose ses masques africains à Ann. On retrouvera l’hôpital comme lieu de rétention arbitraire. Mais le fil rouge est bien de savoir qui est fou et qui ne l’est pas. Toute la subtilité de la mise en scène visera à faire apparaître jusqu’aux deux tiers du film Ann comme une folle imaginative, et son frère comme un protecteur, un peu collant, mais plutôt dévoué et rationnel, ayant remplacé dans la foulée, le père comme la mère.
Ann recherche la poupée de Bunny
La mise en scène est astucieuse puisqu’elle plonge dans un univers onirique, celui de la névrose d’Ann. Elle est donc d’abord subjective, du reste Anne change de comportement quand elle se réveille à l’hôpital. De passive et relativement obéissante, elle va prendre en charge ses propres affaires et mettre finalement son imagination au service de la recherche de Bunny. La virtuosité de Preminger fait oublier les approximations scénaristiques, par exemple on ne sait pas comme Steven a fait pour endormir Bunny et la garder des heures entières dans le coffre de sa voiture. De même la façon dont Ann le manipule en l’invitant à jouer est peu crédible et repose d’ailleurs sur le jeu des acteurs. Mais après tout, nous sommes en Angleterre, un peu sous le signe de Lewis Carroll donc. Preminger utilise des décors bien réels, notamment le fameux musée de la poupée qu’il plonge dans la pénombre et qu’il donne à garder à un handicapé en fauteuil à roulettes. Mais il sait aérer son récit de manière pertinente en faisant alterner les séquences de jour, lisses et assez convenues dans un Londres de carte postale, et les séquences de nuit, troublantes jusqu’à l’excès dans cet amas d’objets menaçants qu’on retrouve aussi bien chez le vieux Wilson, ou chez la vieille madame Ford. C’est bien la vision d’un américain que de regarder l’Angleterre comme un musée poussiéreux ! On trouve aussi cela vers la même époque chez Joseph Losey, autre américain en exil, dans le très méconnu Secret ceremony. Les jeunes réalisateurs feraient bien de voir et revoir ce film pour comprendre un peu ce que c’est que la science du mouvement et donc du déplacement de la caméra.
Steven ferme toutes les portes
L’interprétation qui repose, à l’époque, sur des noms quasiment inconnus, sauf Laurence Olivier, c’est d’abord Carol Linley qui ne retrouvera jamais plus un rôle aussi dense et intéressant que celui d’Ann Lake. Elle s’était déjà fait remarquer chez Preminger justement dans The cardinal en 1963, mais aussi auparavant dans le très beau film de Robert Aldrich, the last sunset en 1961. Ici, elle est excellente, passant du tremblement compulsif à la détermination et la colère. Elle est présente dans le film de bout en bout. Et rien que pour sa performance il faut voir ce film. Keir Dullea avait déjà été remarqué dans le curieux David and Lisa le film culte de Frank Perry où déjà il jouait un déséquilibré rencontrant une schizophrène dans un hôpital psychiatrique. Il est très bien, passant sans problème de la rigidité au jeu, révélant une âme enfantine sous des dehors bien policés. Il trouvera ensuite un rôle important dans un film sans importance, 2001 : a space Odyssey, l’ennuyeux film à succès de l’ennuyeux Stanley Kubrick, et puis ensuite Keir Dullea disparaitra peu à peu du devant de la scène. Laurence Olivier a accepté ici un second rôle. Il est très bien dans le rôle du superintendant Newhouse, il est aussi flegmatique que compatissant et représente la solidité des institutions face à la folie du genre humain. Je pesse sur le cabotinage éhonté de Noël Coward qui joue l’ivrogne de service.
Ann s’enfuit de l’hôpital
A sa sortie, Preminger voulait le lancer comme une sorte de Psycho en plus sophistiqué. Il avait d’ailleurs copié la publicité du film de Hitchcock en demandant de ne pas admettre le public après le début du film. Si la critique fut plutôt enthousiaste, le public ne suivit pas. Ce n’est qu’au fil du temps que ce film est devenu fort justement important, du point de vue de la filmographie d’Otto Preminger, mais aussi dans cette nouvelle forme de traiter le film noir. Dans ce film d’ailleurs, Preminger montre qu’il n’a pas oublié les codes visuels du film noir, même si l’utilisation du grand écran en change un peu la signification. Et en prime on a droit au générique de Saül Bass ! C’est un peu le dernier film important d’une longue carrière, ses films ultérieurs seront de moins en moins bien maîtrisés et de moins en moins intéressants. Mais peut-être avait-il fini par perdre la foi après l’échec commercial de Bunny Lake is missing.
Steven retrouve un esprit joueur avec sa soeur
Preminger dirige Laurence Olivier
 2 commentaires
2 commentaires
-
Bien que ce film ne soit pas un des plus importants dans l’œuvre de Preminger, il tient pourtant une place à part dans l’histoire du cinéma. Il inaugure le film de tribunal en donnant la première place à l’avocat. L’avocat n’est plus celui qui va défendre le héros – généralement le faux coupable – mais c’est le héros du film lui-même. En vérité il signifie que la place de l’avocat va être de plus en plus décisive dans la vie civile des Américains. En quelque sorte on passe du détective à l’avocat dans une forme d’embourgeoisement du roman policier. Le roman qui a servi de base au film de Preminger a été écrit par un avocat John D. Voelker sous le nom de Paul Traver. Ce sera un immense succès de librairie, rien qu’aux Etats-Unis il se vendra à plus de 4 millions d’exemplaires. Il est remarquable par la minutie un peu maniaque dans la description des rituels d’un procès. Ça donne un gros pavé de 400 pages. Mais sous les dehors d’un thriller assez rébarbatif, l’histoire recèle de nombreuses ambiguïtés qui en font tout l’intérêt.
Paul Biegler est un ancien procureur qui s’ennuie en essayant de faire son métier d’avocat, c’est un vieux garçon passionné par la pêche. Mais il va sortir de sa torpeur quand il est contacté par Laura Manion qui lui demande de défendre son mari qui est en prison pour le meurtre de Quill qui aurait violé sa femme. Il va rencontrer le meurtrier, c’est un militaire plutôt arrogant qu’il hésite à défendre. Manion ne nie pas le crime, il le justifie seulement par le fait que sa femme a été violée. Paul va cependant accepter de le défendre parce que manifestement il est attaché à Laura Manion, une fille un peu frivole et directe qui pense à s’amuser. Au tribunal deux thèses vont s’affronter, celle de Paul qui plaide la démence passagère, et celle de Lodwick et Dancer, les deux procureurs qui affirment que le meurtre a eu lieu de sang-froid, et qu’en réalité Manion était très jaloux de l’inconduite de sa femme. Chacun va produire son expert psychiatrique pour soutenir sa théorie, et chacun va chercher des témoins plus ou moins inattendus. Dancer va faire sortir de prison un témoin qui est manifestement un menteur et qui affirme que Manion voulait se débarrasser de sa femme. Mais Paul grâce à son associé Parnell, un avocat ivrogne, va découvrir que la fille de Quill travaille à l’auberge de son père assassinée, elle va venir témoigner et en prime elle a retrouvé dans le débarras à linge sale, le slip de Laura, probablement déposé par son père. Paul va gagner son procès. Mais quand il va essayer de se faire régler ses honoraires sous la forme de billets à ordre, les Manion sont partis ! L’expérience a cependant donné le goût à Paul et à son acolyte Parnell de reprendre le chemin des prétoires.
Paul Biegler retrouve la frivole Laura devant la prison
L’histoire en elle-même est assez médiocre. Cependant, elle a posé des problèmes à la censure qui n’en voulait pas parce qu’on y parle de viol, de slip arraché, puis disparu, mais aussi parce que Laura apparaît comme une femme libre. Le militaire qui a tué n’est pas très sympathique non plus. C’est une manière d’éviter le manichéisme. Du reste c’est ce que dira Paul à la fille de Quill qui défend son père bec et ongles : personne n’est totalement bon ou totalement mauvais. Le personnage le plus complexe est sans doute celui de Laura. C’est une fausse ingénue qui s’amuse à allumer les hommes qui passent à sa portée. Mais la morale du film est claire, ce n’est pas une raison pour la violer. Le fait que Manion soit déclaré non coupable est aussi une manière de justifier qu’un homme puisse venger sa femme, venger son honneur, ou simplement indiquer à un homme violent qu’il y a des limites qu’on ne doit pas franchir. Que ce soit Paul Biegler, ou Dancer, les avocats sont toujours à la limite de la tricherie. Dancer suscite un faux témoignage de Duane Miller, mais Paul ne vaut pas mieux en bousculant la fille de Quill. Le but est de gagner, sans penser à la justesse de la cause. Paul Biegler et Parnell sont d’abord deux vieux garçons qui s’ennuient et toute forme de distraction sera la bienvenue dans la grisaille de leur quotidien. Manion est semble-t-il un homme violent qui n’hésite pas à corriger sa femme à l’occasion, mais celle-ci ne peut s’en éloigner. C’est un couple bizarre, on ne sait pas s’il y a de l’amour entre eux.
Paul hésite à défendre l’arrogant militaire
La réalisation de Preminger s’appuie d’abord sur un souci maniaque de réalisme. Le film a été tourné sur les lieux même de l’action, en décor naturel, dans le Michigan. Preminger disait qu’il avait été parfaitement bien accueilli dans la ville de Big Bay et que les gens se sont mis en quatre pour l’aider du mieux qu’il pouvait à la réalisation de son film. Il va donc restituer l’atmosphère d’une toute petite ville de province. La difficulté va survenir quand il s’agit de filmer les audiences. En effet elles représentent sans doute les ¾ de la durée du film qui dure 2 heures 40. Il ne faut pas ennuyer le spectateur, ni laisser l’impression qu’on se trouve face à du théâtre filmé. Il faut donner un rythme aux audiences qui fasse progresser l’histoire. Cela passe par les différentes phases des interrogatoires de témoins, mais aussi dans la manière de filmer. Comme je l’ai dit à d’autres occasions, Preminger a une capacité étonnante de filmer dans des espaces restreints. Il arrive à donner de la profondeur de champ par exemple en alignant l’un derrière l’autre l’avocat de la défense et l’avocat général. Il multiplie aussi les angles qui permettent de saisir aussi bien l’attitude nonchalante du juge que les échanges de regards entre les deux époux. C’est cette maitrise du rythme qui fait oublier les insuffisances du scénario. Il n’y a pas de suspense en ce sens qu’on sait qui est le coupable et les raisons qui l’ont poussé à tuer.
Pendant les débats, Paul fabrique des appâts pour la pèche
L’interprétation est excellente. James Stewart dans le rôle d’un faux naïf est l’avocat Biegler. C’est bien sûr autour de lui que le film s’est monté. On peut le trouver un peu monolithique, mais il est toujours comme ça. Ce côté désuet qu’il a toujours eu, même jeune, renforce le côté vieux garçon de Biegler un peu ronchonneux. Ensuite il y a l’excellente Lee Remick dans le rôle de la sulfureuse Laura. Elle est éclatante et trouve là un de ses meilleurs rôles dans les nuances d’une femme énigmatique qui semble finalement manipuler tout le monde. On appréciera ses transformations, quand elle passe d’une tenue à une autre, quand elle a ou pas ses lunettes, elle change chaque fois de personnalité. George C. Scott est l’avocat Dancer, il tient très bien sa place, il a l’air suffisamment hargneux et ironique quand il continue à plaider tandis qu’il annonce en aparté à son collègue que le procès est perdu. Il dégage une puissance inquiétante qui met mal à l’aise dans l’interrogatoire des témoins. Arthur O’Connell est le comparse Parnell, l’ivrogne de service, et comme tel il cabotine pas mal. Mais après tout les ivrognes sont aussi de grands cabotins ! Bien qu’il n’ait qu’un petit rôle, Ben Gazzara qui incarne Manion, fait remarquer toute sa classe. C’est un très grand acteur qui à mon sens n’a pas eu la carrière qu’il méritait. Ici il fait étalage d’un jeu sophistiqué et complexe. Et puis, il y a le juge Weaver qui est incarné par un vrai avocat, une célébrité des prétoires puisqu’il s’agit de Joseph N. Welsh, l’avocat qui a tenu tête à Joseph McCarthy et qui l’a fait plier, mettant fin pratiquement à la chasse aux sorcières. Pour Preminger c’est un beau symbole, lui qui s’est battu tout au long de sa vie contre la censure et qui fera réhabiliter l’année suivante le grand Dalton Trumbo.
Le juge Weaver appelle la défense et l’accusation à plus de retenue
Le film fut un énorme succès public et critique. La musique du film est due à Duke Ellington qu’on voit d’ailleurs pianoter aux côtés de James Stewart : c’est encore une manière de pousser le jazz vers une reconnaissance qu’il n’avait pas encore tout à fait. Le générique est dû comme d’habitude à Saül Bass, ce qui donne un côté un peu plus sophistiqué à l’ensemble. La photo est de Sam Leavitt qui avait travaillé avec Preminger sur The man with the golden arm et sur The court-martial of Billy Mitchell. Il suivra ensuite Preminger dans l’aventure d’Exodus. L’ensemble a cependant un peu vieilli, on a tellement vu de film de procès que plus rien ne nous étonne en la matière, mais cela se regarde très agréablement, on a même l’impression qu’on connait tout du système judiciaire biscornu américain.
Dancer a trouvé un témoin de dernière minute
Dancer essaie de déstabiliser Laura
Photographie de l’équipe du film avec au premier plan John Voelker
Preminger sur le tournage
 2 commentaires
2 commentaires Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires