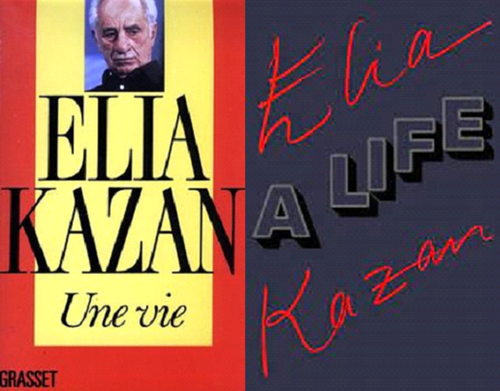-
Elia Kazan, Une vie, Grasset, 1989
Elia Kazan a été considéré pendant longtemps comme un très grand réalisateur, un incontournable. Michel Ciment qui l’a interviewé à plusieurs reprises le pensait, il ne cessera de la défendre plus ou moins directement. Mais il pensait aussi la même chose de Losey, ce qui peut paraître contradictoire tant les deux hommes étaient moralement à l’opposé[1]. Ces choses-là sont un peu subjectives. Je ne contesterais pas ici le fait que Kazan soit un bon technicien de l’image et aussi un très bon directeur d’acteur. Mais comme dirait Melville cela ne suffit pas parce que le scénario compte, aussi. D’ailleurs à lire les « mémoires » de Kazan, on comprendra que celui-ci partage ce point de vue. Il venait du théâtre, et qui plus est du théâtre ancré à gauche, très à gauche même, puisqu’il sera adhérent au Parti communiste américain qui était extrêmement rigide et très stalinien. Avec la chasse aux sorcières de l’HUAC, craignant de perdre sa situation dorée dans le cinéma, il changera son fusil d’épaule et se décrira comme une victime du Parti communiste pour justifier son travail de délation, faisant comme si le Parti communiste américain qui n’a jamais été autre chose qu’un groupuscule, s’apprêtait à prendre le pouvoir. Cette canaillerie est bien connue et documentée. Quand l’Academy Awards lui rendra hommage en 1982 et qu’il recevra un Oscar honorifique des mains du politiquement très confus Martin Scorsese qui faisait semblant, son nom sera hué à son entrée et à sa sortie, une grande partie de la salle refusant de se lever pour lui et d’applaudir cet ultime hommage. C’était un affront délibéré. Beaucoup, dont Nick Nolte, lui crachèrent dessus à cette occasion. On se souvenait donc encore trente ans après de sa conduite ignoble.
En 1938 Elia Kazan travaillait avec le Group Theater, à un théâtre communiste
Orson Welles aura une dent très dure contre lui quand une jeune journaliste française lui posera une question sur les jérémiades d’Elia Kazan dans sa difficulté de trouver des financements : « Mademoiselle, vous avez choisi le mauvais metteur en scène, car Elia Kazan est un traître. C'est un homme qui a vendu à McCarthy tous ses compagnons à une époque où il pouvait continuer à travailler à New York avec un salaire élevé. Et après avoir vendu tout son peuple à McCarthy, il a ensuite réalisé un film intitulé On the Waterfront qui était une célébration de l'informateur. Et par conséquent, aucune question qui l’utilise comme exemple ne peut recevoir de réponse de ma part. »[2] Cette traitrise, Kazan la portera comme une croix. Mais au lieu de reconnaitre sa lâcheté, comme le fit par exemple Sterling Hayden qui lui aussi avait balancé et qui le regrettait, il a toujours tenté de faire porter le poids de sa faute sur ses anciens copains du Parti communiste. Il aurait pu dire par exemple que la pression était trop forte, et qu’il avait craqué, mais Il s’est enfoncé en affirmant qu’en réalité il était déjà anticommuniste depuis longtemps, et que les communistes tentaient d’une manière rampante de coloniser les cerveaux en prenant le contrôle des théâtres et du cinéma. Dans son livre A Life, menteur comme un arracheur de dents, il ira jusqu’à dire que de toute façon on doit toujours soutenir le gouvernement ! Oubliant au passage qu’il condamna un peu plus tard le gouvernement américain qui entretenait la Guerre du Vietnam pour tenter de se refaire une santé morale auprès de la jeunesse américaine, mais là, la masse des Américains étaient de son côté. Son point de vue moral et moralisateur était tout à fait à géométrie variable. Ce sinistre individu ira jusqu’à se moquer de Robert Rossen qui lui aussi avait balancé des noms mais qui le vivait tellement mal qu’il n’arrivait plus à bander. Et voilà donc Kazan qui affirme que lui non, bien au contraire, il baisait à tour de bras tout ce qui passait à sa portée. Preuve qu’il vivait très bien son rôle de mouchard. Ses amis du théâtre lui avaient donné le surnom de The Informer, le personnage du film de John Ford[3], et beaucoup refusèrent de la saluer. Il a beau faire le fanfaron, la place que prend cette défense maladroite dans ses « mémoires » est tellement grande qu’on comprend qu’il ait mal vécu de se faire cracher dessus par ses pairs qui lui reprochaient de s’être vendu totalement au système pour protéger ses revenus. Comme Gypo, il n’arrivera jamais à se débarrasser vraiment de cette honte.
Gentleman’s agreement, 1947
Ses mémoires montrent un personnage assez répugnant. Je passe sur ses frasques sexuelles étalées complaisamment toutes les deux pages. Mais il n’a pas un mot d’excuse pour essayer de se racheter des carrières qu’il a ruinées indirectement ou directement. Je pense à Jules Dassin, Joseph Losey justement, ou encore John Berry ou Abraham Polonsky qui devra mettre sa carrière de réalisateur entre parenthèse. Et je pense aussi à John Garfield qui avait travaillé avec lui sur Gentleman’s Agreement et qui est mort de cette traque permanente. Non, dans son livre, il n’a pas un mot d’apitoiement, de remord ou de tendresse pour John Garfield, il préfère se plaindre de la méchanceté des communistes, alors que ce fut sans doute là une manière de se faire mieux accepter par le système pour faire carrière. Entendons-nous bien, il est certain que le Parti communiste américain était détestable sur de nombreux points. Il est même assez compréhensible qu’on en ait dit du mal et même que Kazan en ait démissionné – certains disent qu’il a été exclu. Mais cela ne justifiait en rien la délation, il n’y avait aucun risque que le Parti communiste américain devienne un jour puissant et apte à prendre le pouvoir. Par exemple Gary Cooper qui était un conservateur très hostile aux communistes, ne livrera aucun nom, conservant ainsi toute sa dignité, sans même faire allégeance aux communistes. Kazan va encore plus loi, il fait semblant d’avoir été investi de cette mission de sauver l’Amérique du communisme. On devrait le remercier ! C’est bien entendu une plate excuse, même sans la chasse aux sorcières les communistes n’avaient que très peu d’audience dans la population et dans les syndicats. La vérité est que le lâche Kazan ne voulait pas perdre son travail dans l’industrie cinématographique. Je ne le crois pas assez bête pour qu’il ait cru un seul instant à ces bobards. On le récompensa d’ailleurs, la rédemption est récompensée par les maîtres. Darryl F. Zanuck lui donna la possibilité de se racheter de son passé communiste en lui permettant de mettre en scène une caricature de film anticommuniste, Man on the Tightrope. Kazan lui-même reconnaitra que ce film de propagande était nul, mais, fidèle à son image de menteur, toujours cherchant à se défausser de ses turpitudes, il l’expliquera par la médiocrité de l’équipe technique allemande qui avait été mise à sa disposition ! Cependant il dira que ce film lui donnait raison d’avoir dénoncé ses anciens copains. En vérité dans cette mise en scène, il avait sombré au niveau idéologique de John Wayne qui vers la même époque tournait le ridicule Big Jim McLain. Mais au moins John Wayne, comme le répugnant Cecil B. De Mille qui passait son temps à filmer des bondieuseries d’un autre âge[4], n’a jamais retourné sa veste, il a toujours été conservateur et anti-communiste viscéral, on savait à quoi s’attendre avec eux et avec leurs films. Quand Kazan filme cette caricature anticommuniste, il ne produit pas une œuvre artistique – fut-elle mauvaise – il donne allégeance au système afin de pouvoir continuer à tourner des films qui lui rapporteront beaucoup d’argent. Autrement dit, qu’il le veuille ou non, c’est juste un vendu !
Viva Zapata, 1951
Fort de son succès avec A Streetcar Named Desire, Elia Kazan se lancera dans l’aventure de Viva Zapata, avec John Steinbeck. A Streetcar Named Desire avait été charcuté pour faire plaisir à la censure de l’Église catholique emmenée par le cardinal Spellman de sinistre mémoire. Viva Zapata[5] dut lui aussi se plier aux exigences de la censure américaine afin de ne pas passer pour communiste, après tout on y parlait de révolution des pauvres contre les riches ! Ce qu’acceptèrent Kazan et Steinbeck. Mais cet épisode est intéressant parce que le sinistre Kazan persiste tout au long de son ouvrage à nous dire que s’il avait dénoncé ses amis devant l’HUAC, c’est parce que les communistes étaient des censeurs ! Le mensonge n’est pas dans le fait que le parti communiste américain avait des intentions malveillantes, mais plutôt dans le fait que l’HUAC et l’Église catholique avaient un pouvoir effectif de censure que les communistes américains, tout rigides qu’ils soient, n’avaient pas. Le véritable pouvoir de coercition était du côté des conservateurs et certainement pas du côté des communistes. Kazan répétera stupidement qu’il préférait encore une censure des studios fondée sur la nécessité des profits que celle des communistes fondée sur une idéologie nocive, c’est un autre mensonge, les films anti-communistes ne faisant par un clou. Ça se comprend parce que Kazan gagnait beaucoup d’argent, qu’il était marié avec une descendante des vieilles familles WASP et qu’il se faisait servir à table par des domestiques stylés !
Man on the Tightrope, 1953
Avec Man on the Tightrope, Kazan avait touché le fond de l’ignoble. Il avait donné des gages idéologiques à un système totalement corrompu. Il en remettra une couche en tournant dans la foulée On the Waterfront. Ce film qui lui valut un nouvel Oscar pour sa mise en scène, est répugnant du début jusqu’à la fin, on a vu ce qu’en pensait Orson Welles. Après avoir attaqué les communistes, Kazan qui en avait travaillé le scénario avec un autre communiste défroqué, Budd Shulberg, attaquera les syndicats qui avaient eu bien du mal pour se développer avant le New Deal à cause de la répression patronale. Certes il cachera cette sinistre idée de droite qui ne pouvait que plaire à McCarthy et ses sbires, derrière le fait que le syndicat des dockers était sous l’emprise de la mafia. Encore qu’il n’aura pas suffisamment de couilles pour parler clairement de la mafia, parce qu’à cette époque J. Edgar Hoover qui était subventionné par la mafia italo-sicilienne, niait son existence. Pire encore, il ira chercher la caution morale de cette vilénie en développant la figure d’un curé, incarné par Karl Malden qui guide le semi-délinquant sans cervelle joué par Brando sur le chemin de la délation, lui qui pourtant avait subi les avanies de la censure de l’Église catholique. Il faudrait écrire plus longuement sur la place du curé dans le cinéma américain, d’Elia Kazan à Clint Eastwood, ça nous éclairerait sur cette propagande rampante. On the Waterfront, est clairement un film d’extrême-droite. Il se place dans la continuité des films anticommunistes de cette époque qui faisaient l’apologie de la délation comme si c’était une vertu morale, des films du genre I Was Communist for the FBI par exemple. Vu le contexte de la Chasse aux sorcières, il n’est pas étonnant qu’il ait été couronné par pas moins de 8 Oscars. Le système aime bien les communistes défroqués qui affichent leur volonté de rédemption, c’est sa caution morale, la preuve qu’il représente le meilleur des mondes possibles ! Curieusement ce film a été beaucoup plus critiqué aux Etats-Unis pour ses faibles valeurs morales qu’à l’étranger. Mais en France où la critique cinématographique l’a applaudi, on est coutumier du fait, comme par exemple lorsqu’on avale les couleuvres d’extrême-droite de Clint Eastwood dans American Sniper ou dans Gran Torino, sans se poser trop de questions. Mais il est vrai que Clint Eastwood n'a pas vendu ses anciens camarades et a toujours été le porte-drapeau officiel des idées de l’extrême droite américaine. S’il aimera souvent se faire passer pour un rebelle, Kazan déploie tout au long de son existence l’idée que tout de même, malgré leurs défauts, les Etats-Unis sont le meilleur pays du monde, la preuve ? Ils l’ont fait riche et célèbre, lui permettant de baiser toutes les poulettes qui passaient à sa portée dans les coulisses des studios hollywoodiens – sujet sur lequel il s’étend pendant la moitié de son ouvrage – et donc tout le reste passe après !
On the Waterfront, 1954
L’année suivant le succès de On the Waterfront, Kazan tournera East of Eden, encore un très grand succès. Sans doute ce que Kazan a fait de mieux. L’étonnant dans son livre de « mémoires » est qu’il rappelle deux choses, d’abord à quel point il était proche de John Steinbeck avec qui il avait concocté le médiocre Viva Zapata, encore un qui passera de la littérature prolétarienne à l’extrême droite, allant jusqu’à soutenir l’engagement des Etats-Unis au Vietnam – contrairement à Kazan, plus malin, qui avait senti le vent tourner. Mais dans son livre Kazan manifeste une haine difficilement contenue envers James Dean qu’il présente comme un imbécile crasseux ! Or à l’évidence, sans James Dean East of Eden n’aurait jamais atteint cette densité. Après ce film la carrière d’Elia Kazan va commencer à patiner et le succès va le fuir. Bien entendu la critique qui reste fascinée par son savoir-faire va continuer dans son soutien, envers et contre tout, surtout en France. Même sur le plan technique cela va dégringoler. Je ne vois que Wild River en 1960 qui tienne vraiment la route de ce point de vue, et encore sans être trop regardant sur le message sous-jacent qui nous indique comment plier pour satisfaire au sens du progrès décidé depuis Washington. Il se complaira d’ailleurs à monter des films plus ou moins autobiographiques, comme America, America, son film préféré, ou The Arrangement. Sans grand succès, même son film sur la Guerre du Vietnam, The Visitors, ne fera pas recette. Après Splendor in the Grass, en 1961, tous ses films seront des lourds échecs commerciaux, seuls les critiques de cinéma parisiens continueront à le soutenir. Il prendra sa retraite de réalisateur de cinéma en 1976, à l’âge de 65 ans seulement, après le fiasco commercial et critique de The Last Tycoon, film qui était inspiré d’un roman de Francis Scott Fitzgerald et qui malgré une distribution prestigieuse, souffrait d’un budget bien trop faible pour réussir une reconstitution consistante de la glorieuse époque d’Irving Thalberg.
East of Eden, 1955
Dans ses « mémoires », Elia Kazan montre toute l’étendue de sa mesquinerie lorsqu’il parle de Lee Strasberg. On considère en effet généralement que les deux hommes sont à l’origine de l’Actor’s studio, Lee Strasberg étant plus particulièrement associé à la « Méthode ». Inspirée des préceptes de Stanislavski, cette discipline forma des acteurs de grand renom, de Marlon Brando et Paul Newman, à Robert De Niro et Al Pacino. Mais évidemment la lutte entre Kazan et Strasberg était une lutte pour le contrôle des comédiens, et donc une lutte pour le pouvoir. Kazan perdit une partie de son aura avec son action lamentable contre ses anciens amis du Group Theater, et Strasberg qui refusa de dénoncer, sauta sur l’occasion pour reprendre le contrôle. Kazan déblatère tout ce qu’il peut sur Strasberg et sur sa femme Paula qu’il haïssait, comme il haïssait Lilian Hellman, la compagne de Dashiell Hammett, insistant sur son caractère d’origine juive. Révélant qu’en réalité il était un homme de pouvoir, un manipulateur. On connait dans le milieu du théâtre cette importance des gourous sur les jeunes acteurs et actrices en formation. Elia Kazan se venge comme il le peut de cette position en recul qu’il dut accepter dans le milieu du théâtre. Kazan s’est fait une philosophie avec Budd Schulberg, autre défroqué du communisme, pour lui le message politique ne doit pas être apparent. Et c’est ce qui fait la force de ses films, il explique que, par exemple, l’histoire d’amour entre Terry Malloy et Edie Doyle, dans On the Waterfront, qui masque la trahison de Terry Malloy envers les siens, est nécessaire pour que les spectateurs acceptent le message sans se poser de question. Ce n’est pas un hasard s’il réalisa A Face in the Crowd en 1957, il s’y connaissait en manipulation des foules !
The Arrangement, 1969
S’il est malveillant avec James Dean, il est carrément goujat avec Marilyn Monroe qui n’était regardante sur les hommes qui rentraient dans son lit, a eu pourtant des bontés pour lui. Il la décrit comme une espèce de maniaque sexuelle qui se faisait monter part tous ceux qui portaient un pantalon, une grande malade qu’on pouvait baiser pour rien à condition de jouer les compatissants. Pire encore il se montre fier de sa fourberie. Il parle aussi très mal de Gloria Grahame, peut-être ne lui a-t-elle pas accordé ses faveurs ? Barbara Loden, une actrice qui fut pourtant sa deuxième épouse et avec qui il eut un fils, aura droit à des critiques acerbes en ce qui concerne sa voix et même son physique. Il la traite comme si elle n’avait jamais compté pour lui autrement que comme un jeune corps destiné à entretenir ses restes de verdeur, alors qu’elle était décédée depuis un bon moment quand il a rédigé ce livre. Ce n’était guère un homme fidèle, ni avec ses femmes, ni avec ses amis, et encore moins avec ses idées. Habitué à trahir tout le monde, il ira jusqu’à se trahir lui-même. Il appelait cela l’ambiguïté, mais cette absence de sens moral était bien au-delà, c’était le résultat d’un ego surdimensionné, lié à un complexe d’infériorité lié à ses origines gréco-turques dont il se disait fier. Il passera des années en analyse ! Vous me direz que dans ce secteur du spectacle, c’est monnaie courante que de rencontrer ce genre de caractère aussi faux que tourmenté, c’est vrai. Mais chez Kazan ça prend l’allure d’une sournoise envie de faire du mal et de se moquer du monde. Il dresse un portrait terrible d’Arthur Miller son soi-disant meilleur ami, il le montre fourbe et sournois, lâche et dissimulateur, retournant sa veste autant que c’est possible. Par exemple Arthur Miller écrira une pièce, Les sorcières de Salem, histoire de faire contrepoids aux saloperies de l’HUAC. Kazan prétend qu’ensuite sur ce point son « ami » se dédira. Lui-même considère stupidement qu’il n’y a aucun rapport entre les « sorcières » de Salem qui n’ont pas existé et les communistes qu’il dénonce et qui ont bien existés. Sauf qu’il fait semblant de croire que le complot communiste avait des raisons sérieuses d’aboutir à un renversement de la démocratie américaine ! C’est à la fois un mensonge et de la stupidité. Quand Staline était au pouvoir, tout criminel qu’il fût, il avait le peuple derrière lui. le parti communiste américain était un groupuscule. Au plus haut ce parti comptait en 1932, avant la mise en place des réformes de Roosevelt, 12 000 membres pour une population de plus de 124 millions d’habitants, dans un contexte pourtant hautement revendicatif ! Le candidat du parti communiste, William Foster aux mêmes élections fera 102 000 voix, soit 0,26% des suffrages exprimés. Ces simples chiffres expliquent qu’en réalité l’HUAC avait bien d’autres buts que de combattre le communisme. Le but était d’introduire un réarmement culturel généralisé tendant à faire la réclame des idées capitalistes d’extrême-droite en reprenant en main le secteur de la culture au sens le plus large et de terroriser ceux qui y travaillaient, afin qu’ils s’alignent. Les palinodies de Kazan, de Dmytryk ou de Schulberg sont pitoyables autant que honteuses. Certes on peut toujours dire que la violence de l’HUAC explique énormément choses, mais cela n’a touché que les plus fragiles. Mais ensuite faire semblant de croire que les Etats-Unis risquaient de tomber sous la coupe d’une sorte de stalinisme, c’est une façon de se dédouaner de sa propre lâcheté.
Arthur Miller, Barbara Loden, Jason Robards et Elia Kazan lors du montage d’After the Fall
En homme de pouvoir à l’ancienne, il considérait que le droit de cuissage devait être la norme pour un metteur en scène de théâtre et de cinéma, il s’en flatte même ! Vous me direz que c’est encore aujourd’hui courant dans le milieu du théâtre, à New York, comme à Paris, malgré les mouvements féministes et le coup de tonnerre de #Me too mais cela n’excuse rien. Même s’il est capable de se définir lui-même par son ambiguïté et par sa propre fourberie il passe son temps à rabaisser presque tous ceux qui l’ont entouré. Il a des mots très durs aussi envers Nicholas Ray, prétendant se situer bien au-dessus de lui. Même Tennessee Williams avec qui il travaillera longtemps pour le théâtre a droit à des remarques plus qu’acerbe et des moqueries déplaisantes sur son homosexualité. Toute cette mesquinerie et cette malveillance n’est pas sans rapport avec ses films. Elle explique leurs insuffisances et leur orientation politique au sens large du terme. De son œuvre, jadis mise au pinacle par les critiques, notamment français, fasciné par la science de sa mise en scène, il ne reste pas grand-chose. L’ensemble, quand il n’est pas entaché d’un message politique conservateur, est trop marqué par le théâtre. A Streetcar Named Desire, c’est bavard et pesant, sans Brando et Vivien Leigh, c’est inregardable. De tout cela, je l’ai dit, je ne sauverais pour ma part que East of Eden et peut-être Splendor in the Grass. Je pense que ce réalisateur est très surévalué, bien qu’il ait un certain talent, comme je l’ai dit au début, un sens de l’image et qu’il soit capable d’une bonne direction d’acteurs, talent gâché par ses trop nombreuses compromissions sur le plan politique, son manque de dignité et son absence de morale.
Elia Kazan et Lee Strasberg
L’ouvrage est intéressant bien entendu, non pas que la plume de Kazan soit bonne, ni parce que ses souvenirs triés sur le volet soient exacts et sans discussion, mais plutôt parce qu’il raconte deux choses : d’abord quelle a été cette période de la création cinématographique étatsunienne qui conservait une prétention esthétique, entre engagement politique et répression, ensuite il décrit ces allers-retours entre théâtre et cinéma, allers-retours qu’on ignore généralement aujourd’hui alors que le théâtre n’existe plus que de façon résiduelle dans la culture occidentale pour une élite faussement cultivée. Or Kazan a fait une grande carrière de metteur en scène de théâtre et de formateur d’acteurs. Certains trouveront cet ouvrage pompeux, et il l’est, et peut-être n’auront-ils pas tout à fait le courage de passer au-delà de ses longues jérémiades. L’édition française fait un peu plus de 700 pages ! Quand il raconte le décès de sa femme Molly, c’est assez peu sobre. Mais le pire est sans doute qu’on dirait que c’est lui qui est décédé ! Tant il avait de la compassion pour sa propre personne ! Il était d’ailleurs tellement égocentrique qu’il se permettait de dénigrer la presque totalité de sa filmographie ! D’ailleurs en se servant de ce qu’il dit dans ce livre et dans ses nombreux entretiens avec Michel Ciment, on a vraiment de quoi descendre l’ensemble de son œuvre, rien qu’en reprenant ses propos ! En tous les cas tout cela rappelle le rôle idéologique du cinéma dans la diffusion des normes civilisationnelles américaines vers le reste de la planète. Les Américains ont été en effet les premiers à comprendre combien les productions culturelles qui s’adressaient à la masse, cinéma, télévision, journaux et musiques, devaient être contrôlées. Ce contrôle n’a heureusement jamais été complet, mais en tous les cas il a permis de freiner les velléités d’indépendance des artistes et des créateurs. Le cas d’Elia Kazan est exemplaire, il va passer d’une position de gauche – radicale on dirait aujourd’hui – à un anticommunisme primaire, adaptant sa volonté créatrice aux exigences d’un système économique, politique et social qui avait abandonné une position libérale dans la culture.
[1] Michel Ciment, Kazan, Losey : édition définitive, Stock, 2009.
[2] https://www.openculture.com/2023/01/when-orson-welles-denounced-elia-kazan-as-a-traitor-1982.html
[3] http://alexandreclement.eklablog.com/le-mouchard-the-informer-john-ford-1935-a130846054
[4] Cecil B. De Mille tournait en permanence des films moralisateurs, ce qui ne l’empêchait pas par ailleurs de se livrer aux pires turpitudes dans sa vie privée, abusant du droit de cuissage sur les stars et les tarlettes.
[5] Ce film médiocre est d’une incroyable fausseté en tout, y compris dans la description de ce qu’étaient les Mexicains à cette époque. C’est une simple caricature, aggravée par le jeu outrancier des acteurs principaux, Marlon Brando et Anthony Quinn.
 Tags : Elia Kazan, HUAC, Arthur Miller, James Dean, Marlon Brando, Hollywood, John Garfield
Tags : Elia Kazan, HUAC, Arthur Miller, James Dean, Marlon Brando, Hollywood, John Garfield
-
Commentaires