-
Edouard Rimbaud est originaire de Marseille, où il est né en 1920. Après avoir tâté du métier de policier durant l’occupation, il passera de l’autre côté du miroir et deviendra un vrai truand, avec un pied à Marseille et l’autre à Paris. Il a été aussi convoyeur de drogue dans le cadre de ce qu’on a appelé la French Connection. Mais apparemment sa carrière de truand a commencé bien avant puisqu’on trouve son nom mêlé à celui du faux baron Foucou d’Ines dans une affaire d’escroquerie en 1956. A cette époque il se faisait appeler Roucas. On ne sait pas grand-chose de sa vie, hormis ce qu’il a bien voulu en dire dans des mémoires forcément sélectives. Il a été également condamné aux Etats-Unis à trente ans de prison, ce qui l’a amené à balancer ses petits copains, et par suite, ce sera là un sujet de méditation pour lui. Bien sûr le fait d’avoir passé un deal avec la justice américaine l’a mis en danger, et probablement sa tête a-t-elle été mise à prix, ce qui l’obligea pendant un temps plus ou moins long à vivre sur le qui-vive, à se déplacer et à éviter de se faire repérer. Ce qui ne l’a pas empêché de faire publier deux ouvrages sous son nom.
Pour ce qui nous intéresse ici, il est l’auteur de deux ouvrage sous son nom : Les pourvoyeurs, roman dans le milieu de la drogue, paru en 1974 et de Doudou, paru en 2000, et qui raconte une partie de sa vie de truand. C’est ce dernier ouvrage qui lui a amené une certaine renommée. Il fait donc partie de cette cohorte d’écrivains qui ont un passé de truand : Simonin, Le Breton, José Giovanni, Mariolle et bien sûr l’immense Boudard. Ce qu’on sait moins est qu’il est l’auteur de deux autres romans parus en Série noire sous le nom de Louis Salinas, Comme à Gravelotte, et Le pot-au-feu est assuré, et qu’il aurait aussi aidé Jean Mariolle à retaper son bouquin, Les louchetracs, paru aussi en Série noire et réédité ces derniers temps à La manufacture de livres. Certains pensent même que c’est Rimbaud qui l’a écrit de A jusqu’à Z. Il est vrai que l’histoire des Louchetracs est assez semblable à celles que développaient Salinas, sauf que Les louchetracs est écrit avec un grand nombre de formules argotiques, ce qui n’est pas le cas ni de Salinas, ni de Rimbaud
L’ensemble de ces ouvrages révèle deux choses :
- d’une part que Edouard Rimbaud aime écrire, et qu’il peut écrire bien qu’il est également plus cultivé que la moyenne des malfrats qui traîne dans ce milieu.
- d’autre part que ses récits, signés de son nom, sont un témoignage de première main sur le quotidien des trafiquants de drogue, quelle que soit leur place dans la hiérarchie. C’est une sorte de « vie quotidienne » chez les trafiquants de came, dans les années soixante-dix.
Ecrits sans fioritures, les récits de Rimbaud développent une forme chorale qui ressemble un peu, mais comme un miroir aux romans de Wambaugh car il s’y trouve de l’autre côté de la barrière, du côté des marchands de drogue. Comme Wambaugh Rimbaud utilise les formes particulières de langage de la rue, et aussi des anecdotes propres à ce milieu particulier.
On peut diviser son œuvre en deux, d’un côté deux romans publiés en Série noire sous le nom de Salinas qui s’inscrivent dans une veine assez bien codifiée du roman de truands à la française, louchant du côté de Simonin ou de Pierre Lesou, mais sans grand éclat, et de l’autre un roman et un récit autobiographique d’excellente facture, signés Edouard Rimbaud et qui s’approchent par le ton et par la tenue des grands romans noirs américains.
En apparence son patronyme l’inclinait à allier une vie d’aventure à une vie d’écrivain. D’ailleurs, il exerça aussi un temps, assez bref il vrai, le métier de libraire, ce qui tend à prouver qu’il aimait aussi les livres.
Comme à Gravelotte, 1968
Rimbaud va utiliser d’abord un pseudonyme. Louis est le prénom de son père, mais Salinas on ne sait guère à quoi cela ressemble. Rimbaud ne s’en expliquera pas plus dans ses mémoires.
C’est la première tentative littéraire d’Edouard Rimbaud. Publié en 1968, c’est une histoire de truands marseillais assez traditionnelle. Sorti de prison, Serge retrouve ses deux anciens complices et amis, Gabarit et Gaspard. A partir de là, et d’une manière très confuse, deux histoires vont se croiser : d’un côté, Serge va poursuivre une vengeance vis-à-vis d’une équipe qui l’a doublé, et de l’autre Gaspard et Gabarit vont monter un cambriolage avec ouverture d’un coffre fort au chalumeau, ce qui semble avoir été un temps la spécialité de Rimbaud lui-même.
L’histoire est d’autant plus décousue que l’inspecteur Crespo a juré la perte de nos trois truands. Et à cette fin, il usera de toutes les fourberies possibles et imaginables, alternants chantage et fabrication de fausses preuves, allant jusqu’à flinguer les truands qu’il ne peut arrêter.
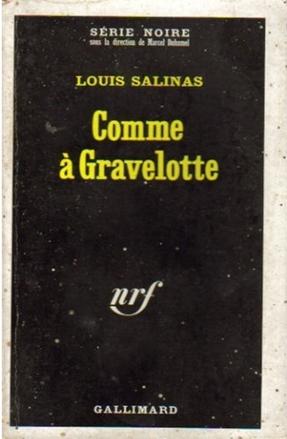
Il semblerait que l’histoire ait été tronquée par l’éditeur, la Série noire, de façon à la faire entrer dans les normes de l’époque, car il semble manquer des passages entiers, notamment vers la fin, quand on apprend que Serge a effectivement éliminé les frères Sartanéo et Allessandrini. En effet, suivant la logique de l’écriturre de Salinas, cela aurait dû être le clou de l’ouvrage, et non pas une digression de deux lignes rapportée par Crespo. Même chose pour l’arrestation de Serge, ou encore l’extraction de Gabarit.
Si les personnages avaient eu un minimum de psychologie et d’épaisseur, cela aurait pu faire un roman dans le genre de ceux que Pierre Lesou écrivait à l’époque, le personnage de Crespo y fait inmanquablement penser. Mais ce n’est pas le cas. C’est seulement une succession de scènes de genre : le cambriolage, le triquard qui se fait mettre à l’amende par le condé, etc.
L’ouvrage est râté dans son ensemble, le langage se veut un mélange de formules argotiques parisiennes à la Simonin et de français académique, les scènes d’amitié virile entre Gaspard et Gabarit ne sont pas très crédibles non plus. Il y a pourtant quelques éléments intéressants, par exemple on voit assez bien que l’auteur connait Marseille, car sans rajouter des détails, il campe clairement le décor. Par exemple les bistrots qu’il décrit dans la rue Vincent Scotto, anciennement rue de l’Arbre, étaient bien tels qu’il les décrits. Comme le toubib des allées Léon Gambetta qui est lui aussi plus vrai que nature. Il y a le Frippé qui va revenir dans l’ouvrage suivant. Mais on y trouve aussi une violence complaisamment décrite, comme cela ne se faisait guère à l’époque.
Le pot-au-feu est assuré, 1973
Le deuxième ouvrage de Louis Salinas, alias Edouard Rimbaud, pa raît cinq ans après. Le délais semble assez long. Mais il n’est pas certain qu’il ait été écrit aussi longtemps après que Comme à Gravelotte. Le style est un peu meilleur, mais l’histoire elle-même paraît dater du début des années soixante, plutôt que du début des années soixante-dix. En effet, il s’agit d’un conflit entre maquereaux parisiens et arabes, à cause d’une fille qui a choisi de tapiner pour un « tronc ».
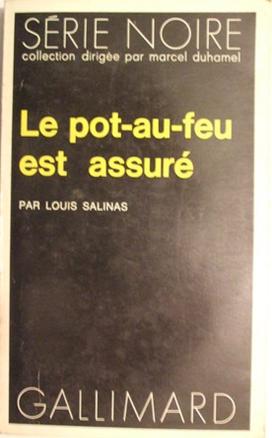
Il y aura des bains de sang, avec des scènes de torture assez osées, mais aussi une histoire de cambriolage avec ouverture de coffre-fort. Cette histoire est d’ailleurs assez embrouillée parce que se sont les bourgeois qui choisissent d’endormir les malfrats et de les manipuler à leur avantage.
Mais comme tout le monde trahit tout le monde, le héros, Gaston, va à son tour être trahi. Il faut noter cependant que le héros est plutôt faible, tout maquereau qu’il soit, et tout ex-taulard qu’il soit, ce sont les femmes qui lui font la loi dans tous les sens du terme. On est loin des romans à la Le Breton où le mac se contente de faire régner la loi à coups de ceinturon. Mais on est aussi assez éloigné du héros de Pierre Lesou, Cœur de hareng.
Le récit est écrit à la première personne, ce qui est sensé donner un peu plus de relief à la personnalité du héros. Mais Louis Salinas essaie aussi de jouer sur les différences de langage, entre d’un côté le pseudo-argot des truands, et de l’autre le parler encore policé des bourgeois – preuve que l’histoire date d’avant mai 68. Il inaugure aussi des scènes d’amour saphique qu’on retrouvera avec plus de mordant dans l’ouvarge suivant, cette fois signé Edouard Rimbaud.
Outre que Salinas dénigre systématiquement le comportement des gens du milieu, il faut bien avouer que l’intrigue est assez invraissemblable. C’est probablement voulu pour donner un ton plus léger au récit, ajouter une dose d’humour. Mais il faut bien reconnaitre que l’ensemble est daté.
 votre commentaire
votre commentaire
-

Dorothy Lyons vient de sortir de prison, où elle était emprisonnée pour sa kleptomanie, sa sœur l’attend. June Lyons est la secrétaire d’un riche homme d’affaire, Frank Jansen, qui veut aussi devenir maire de Bay City pour nettoyer la corruption. Mais la ville est sous la coupe de Solly Caspar, un gangster. Ben Grace qui est amoureux de June Lyons, joue un jeu très ambigu. Il semble vouloir aider Jansen à se débarrasser de Caspar, mais en fait il roule pour lui-même et ne songe qu’à prendre sa place.

Sur cette histoire banale de pourrissement d’une ville, il y a un certain nombre d’histoires d’amour qui vont se greffer : d’abord Jansen qui veut se marier avec June, mais celle-ci lui préfère le douteux Grace, tandis que Dorothy aimerait bien elle aussi que Grace tombe amoureux d’elle.
Tiré d’un excellent roman de James Cain, Le bluffeur, le scénario est très faible, navigant entre parodie, comédie et film noir. Publié en 1942, il s’inscrivait avec bonheur dans la lignée de ces ouvrages qui dénonçaient la mise en coupe réglée d’une ville par les gangs, avec la complicité de flics véreux, un peu dans la lignée de La moisson rouge et de La clé de verre de Dashiell Hammett.

Mais il n’empêche que certains, dont Bertrand Tavernier par exemple, tiennent ce film pour un chef d’œuvre. Ce qui veut dire que ce film a des qualités. D’abord il y a une photographie de John Alton qui donne un côté très kitch à l’ensemble en abusant des couleurs violentes, ensuite une utilisation très particulière du scope et de la profondeur de champ qui est assez étonnante. Mais il y a surtout l’interprétation des deux rouquines, notamment Rhonda Fleming qui est époustouflante. Les deux sœurs dégagent d’ailleurs un érotisme assez déconcertant, érotisme rehaussé par l’utilisation des vêtements, la plupart du temps le vert faisant ressortir le roux de la chevelure. Allan Dwan s’attarde d’ailleurs assez volontiers sur la chute de reins des deux rouquines, avec une tendresse plus particulière pour Rhonda Fleming en short.

Est-ce que tout ça suffit à faire un bon film ? A mon avis non. Et certainement pas un film noir, fusse-t-il en couleurs. Les personnages sont assez vide de sens, la dimension psychologique étant assez oubliée. La maladie de la sœur de June est plus une explication qu’une analyse de caractère. Bref l’ensemble reste assez creux.
 1 commentaire
1 commentaire
-

En explorant le catalogue des Films noirs américains, on trouve toujours des réalisations intéressantes. Ce film montre combien un genre peut se renouveler tout en mettant en œuvre les canons d’un genre, contrairement à ce que prétendaient les très dogmatiques Raymond Borde et Etienne Chaumeton dans leur Panorama du film noir américain. Blast of silence qui est exploité curieusement en France sous le titre de Baby boy Frankie est une des étapes obligées vers la redéfinition d’un genre qui va aboutir quelques années plus tard à ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le néo-noir. Il anticipe des films comme Les tueurs de Don Siegel, Le point de non-retour de John Boorman, qui seront eux tournés avec de gros moyens, en couleurs et à Los Angeles.
C’est l’histoire d’un tueur à gages, taciturne et solitaire. Il arrive de Cleveland à New-York pour exécuter un énième contrat, tuer un homme de la mafia. C’est à peu près tout pour l’histoire, et on pourrait dire que c’est à peu de chose près la même chose que Tueur à gages de Frank Tuttle. Et pourtant le film est d’une profonde originalité. Frankie Bono va préparer son contrat, rencontrant un gros homme qui lui fournira une arme avec silencieux, étudiant minutieusement l’itinéraire de sa cible. Mais en même temps, il va se trouver entraîner par un ancien camarade de jeunesse dans un milieu plus traditionnel dont la fréquentation va le perturbé, au point qu’il voudra renoncer à son contrat.

Tourné avec très peu de moyens, il décrit l’errance et les états d’âme de Frankie dans New York. On pourrait dire que c’est l’absence de moyens qui pousse Allen Baron à mettre en valeur le décor urbain. Cette manière de faire s’inscrit dans la droite ligne de Naked city de Jules Dassin, mais comme entre ces deux films on a fait beaucoup de progrès en ce qui concerne les caméras et les pellicules, Baron possède une plus grande fluidité que Dassin.
New York est filmé comme jamais on ne l’a filmé, selon les propres mots de Martin Scorsese qui s’est sûrement inspiré de ce film pour tourner Who’s that Knocking at my door. Il est d’ailleurs probable aussi que Jean-Pierre Melville s’en soit inspiré pour Le samouraï. Les scènes tournées dans la rue, au moment de la préparation des fêtes de Noël, sont particulièrement réussies, mais également le long plan nocturne de Frankie rentrant chez lui à pied, ou encore la fuite par les escaliers de secours après qu’il ait effacé sa cible.

Tourné à peu près à la même époque que le Shadows de John Casavetes, film qui ne coûta pas un dollar, il lui ressemble beaucoup par ses ambiances, ses personnages, et jusqu’à la musique de jazz qui rythme le film. Allen Baron endossa de façon remarquable le rôle de Frankie, après que Peter Falk se soit désisté. Il a curieusement des allures de Robert de Niro. Navigant entre mélancolie, rage froide et solitude.


Sélectionné pour Cannes en 1961, il ne put participer finalement à la compétition parce que les bobines arrivèrent en retard. Quelques années plus tard, Allen Baron tourna un autre film, Terror in the city, qui appliquait les mêmes principes aux gangs de jeunes de New York. Ce film n’est absolument pas visible, si Blast of silence est disponible en DVD, les rares qui l’ont vu le considèrent comme encore meilleur. Comme le premier film, celui-ci non plus n’eut pas de succès, mais il permit néanmoins à Baron de se faire engager à Hollywood pour tourner et scénariser des séries télévisées à succès, revenant ainsi à son premier métier après cette incursion curieuse dans le cinéma d’auteur.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Ce roman de François Brigneau, par ailleurs ancien de la Milice et militant de longue date de l’extrême droite[1], a défrayé la chronique il y a quelques mois. La raison en était que ce sont les éditions Baleine qui l’ont exhumé. Or, Baleine s’était fait connaître pour des prises de position plutôt à l’extrême gauche, publiant un héros récurrent Le poulpe dont les idées sont tout à fait dans cette mouvance. Du coup un certain nombre d’écrivains, dont Didier Daeninkx, ont signé une pétition pour demander que leur nom soit retiré du catalogue des éditions Baleine, ne voulant pas voir leur nom associé à celui de l’ancien directeur de Minute. Il est probable que cette polémique a fait connaître un peu plus l’ouvrage en question qui autrement serait passé plutôt inaperçu.
Pour ma part, je ne suis que peu motivé et par les idées de Brigneau, et par les polémiques qui vont avec. Ce qui m’intéressait dans Faut toutes les buter, c’est qu’il s‘agit là d’un des tous premiers romans noirs français, et qu’en outre il est traversé par de nombreuses formules argotiques. D’ailleurs, les quelques notations un peu racistes envers les Arabes sont plutôt légères, dans l’air du temps comme on dit, sans que ça infère quoi que ce soit.

Le roman avait été édité en effet en 1947 d’abord sous le titre de Pol Monopol, avec comme nom d’auteur Julien Guernec, aux éditions Jean Froissart[2], puis il avait reparu en 1952 sous le nom de François Brigneau et avec comme titre Faut toutes les buter, une autre édition en 1994 avait été fabriquée par François Brigneau lui-même, et présentée comme le deuxième volume de François Brigneau en argot. Enfin, en 2010, ce sont les éditions Baleine qui ressortent ce titre, sous le nom de François Brigneau et avec un couverture plutôt médiocre.
François Brigneau, de son vrai nom Emmanuel Allot, avait été pendant la guerre un militant d’extrême droite, engagé dans la milice, il purgera une peine de prison pour collaboration à Fontevrault, en même temps d’ailleurs qu’Albert Simonin. On peut penser que c’est dans ce contexte que Brigneau a rencontré quelques truands mouillés dans la collaboration et que c’est ici qu’il a pris ses idées d’écriture.
Le roman est assez faible, mal écrit, les scènes d’action succèdent aux scènes d’action, sans qu’existe réellement une intrigue digne de ce nom. Paul Monopol est un vieux truand rassis qui se trouve à la tête d’une bande de malfaiteurs qui projettent de s’emparer de plusieurs tonnes d’or. Il est opposé à une autre bande de malfrats qui veulent faire le coup à sa place. Contrairement à ce qui est dit ici ou là, il y a très peu de formules argotiques, et en tous les cas le langage est bien moins riche que celui d’un Simonin, justement, ou d’un Lebreton. Mais à l’évidence, Brigneau met en scène des figures de style qui vont faire florès dans les années cinquante, et en cela on peut dire que Brigneau est un des précurseurs du roman noir à la française. La description de Paul Monopol, forban vieillissant, ressemble à s’y méprendre à celle de Max le menteur de Simonin, franc buveur, aimant les aises bourgeoises, plutôt cupide, il aime les femmes et bouffer à s’en faire péter la sous-ventrière. Brigneau inaugure une autre mode, celle de dire qu’à travers ce récit on va démystifier le milieu, présentant les malfrats comme des abrutis qui passent leur temps à trahir et à becqueter à la table des condés. Et du reste je me demande s’il existe un seul roman noir où les voyous seraient décrit comme des mecs biens. Même dans les romans d’André Héléna les voyous quoi que victimes de la fatalité ne sont pas mieux lotis du point de vue de leur moralité. La façon dont Monopol entretient des relations amicales avec le commissaire anticipe sur Le doulos de Pierre Lesou. Là encore il semble bien que Brigneau soit un précurseur.

Le principal défaut de Faut toutes les buter, réside dans le manque de précision sociologique du roman. Contrairement à Simonin, Lebreton, ou même André Héléna, Brigneau ne semble pas connaître le milieu dont il parle. Tout sonne faux, les attitudes, les décors, et même les formules argotiques. Tout est vu de loin, dans une incapacité flagrante à relier la délinquance au petit peuple de Paris. Et puis il est incapable de faire chanter la langue verte comme le feront Simonin, Lebreton, ou encore Alphonse Boudard qui pour moi reste le maître de la littérature argotique de l’après guerre.
A côté de ça, l’ouvrage manque singulièrement d’humour, ce qui est probablement la raison qui l’a fait laisser de côté. Paul Monopol est tout simplement un héros inintéressant au possible.

Lire Faut toutes les buter aujourd’hui est seulement intéressant d’un point de vue archéologique, si on veut comprendre quels ont été les précurseurs de cette langue argotique qu’on a retrouvée dans les premiers romans noirs français. Et comme presqu’à chaque fois, on tombe sur un personnage d’extrême droite, comme des descendants tardifs de Céline.
[1] Il fut aussi un des fondateurs du Front National.
[2] On retrouvera le nom de Julien Guernec aux éditions Froissart comme traducteur d’un authentique auteur de romans noirs Sam Ross, pour J’ai descendu un flic. Cette maison d’édition Jean Froissart, fondée par Charles Frémanger, était spécialisée aussi bien dans la publications de romans populaires, policiers et érotiques soft, que dans les écrivains d’extrême droite. Elle ressortira Voyage au bout de la nuit, mais aussi L’Europe buissonnière d’Antoine Blondin, et encore les ouvrages de Jacques Laurent signés Cécil Saint-Laurent. Le nom des éditions Jean Froissart renvoyait au poète du XIVème siècle et donc à la tradition française.
 votre commentaire
votre commentaire
-
3. Le vrai Jacob
Pour ceux qui voudraient mieux connaître le vrai Alexandre Jacob, il existe une littérature maintenant importante. J’avais découvert son existence en 1970 à travers le livre de Bernard Thomas, le premier, celui qu’il a publié chez Tchou. Puis j’ai ensuite lu l’ouvrage d’Alain Sergent qui avait l’avantage de s’appuyer sur le témoignage direct de Jacob lui-même et que Thomas a utilisé abondamment. Il y eut ensuite l’ouvrage de Caruchet qui est très décalqué, pour ne pas employer le mot de plagiat, de ceux de Sergent et de Thomas. Cet ouvrage est préfacé par Alphonse Boudard qui au-delà des actes et des écrits plus ou moins théorique, salue la force de caractère de Jacob.

Plus récemment L’insomniaque a publié les Ecrits que Jacob a laissés, car c’était un grand lecteur, curieux d’un peu tout, passionné d’histoire et de science, et il mis noir sur blanc une partie de ses réflexions, soit dans des textes plus ou moins théoriques, soit à travers une correspondance abondante. Cet ouvrage a été réédité ensuite en 2004 dans une édition augmenté et révisé.
Mais le travail le plus important à ce jour est sûrement l’ouvrage de Jean-Marc Delpech, Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur, publié en 2008 et qui est tiré de sa thèse de doctorat. Cet ouvrage, outre le fait qu’il corrige un certain nombre d’imprécisions ou d’erreurs qu’on peut trouver dans les premières biographies de Jacob, contextualise la trajectoire de Jacob, montrant combien Marseille était à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, un terreau naturel pour le développement des idées anarchistes. Le plus important de ce travail réside dans la description des réseaux qui ont permis à Jacob d’œuvrer dans la reprise individuelle pendant de longues années. Il montre que ses agissements n’auraient pas pu se faire sans qu’il ne bénéficiât d’un solide réseau de relations, aussi bien dans les milieux libertaires que dans celui de la truanderie.
En ce qui concerne l’illégalisme, il montre que le parcours de Jacob se rapproche de certains autres illégalistes, comme Clément Duval par exemple dont le parcours sera plus heures puisqu’il s’évada finalement du bagne et put finir ses jours à New York, ce qui permet de l’inscrire dans un mouvement politique plus large, avec une méfiance viscérale pour les intellectuels de la révolution. Les travailleurs de la nuit, groupe de cambrioleurs dirigé par Jacob, renvoie aux Panthères des Batignolles, bande de voleurs emmenée par Clément Duval.
L’ambition de Delpech va pourtant au-delà de la précision biographique, elle vise à restituer une vraie dimension politique à l’illégalisme, de le prendre au sérieux dans sa volonté militante, malgré son caractère minoritaire au sein de la mouvance anarchiste. C’est pour cette raison que Delpech se montre aussi pointilleux en ce qui concerne les rapprochements qui ont pu être faits ici ou là entre Jacob et Arsène Lupin. Même s’il n’est pas très important de savoir si précisément Maurice Leblanc s’inspira directement du procès d’Amiens pour la création de son héros, il est évident qu’il y a un monde qui sépare Lupin de Jacob : c’est la conscience sociale. Le second représente la face bourgeoise si on peut dire de l’art de cambrioler.
Il reste pourtant beaucoup de zones d’ombre dans la trajectoire de l’anarchiste marseillais. Par exemple on ne connait pas très bien la personnalité de ceux qui l’ont entour. Rose Roux, sa compagne des bons et des mauvais jours, qui termina ses jours en prison, était prostituée, mais dans quelles circonstances Jacob l’a-t-il rencontrée ? Est-ce qu’elle eût des difficultés pour quitter son état ? La connaissance des détails de cette relation permettrait de faire le point justement sur les intersections entre le milieu libertaire et celui des voyous de basse extraction.
Bibliographie
William Caruchet, Marius Jacob, l’anarchiste-cambrioleur, Séguier, 1993.
Georges Darien, Le voleur, Jean-Jacques Pauvert, 1955.
Gilles Del Pappas, Attila et la magie blanche, Au-delà du raisonnable, 2010.
Jean-Marc Delpech, Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur, Atelier de création libertaire, 2008.
Alexandre Jacob, Ecrits, édition revue et augmentée, L’insomniaque, 2004.
Alain Sergent, Un anarchiste de la Belle Epoque, Alexandre Marius Jacob, Le seuil, 1950.
Bernard Thomas, Jacob, Tchou, 1970.
Bernard Thomas, Les vies d’Alexandre Jacob, Mazarine, 1998.
 votre commentaire
votre commentaire





