-
Julie Assouly, L’Amérique des frères Coen, CNRS éditions, 2013
On a beaucoup écrit sur le cinéma des frères Coen, sans doute parce qu’il apparaît à beaucoup comme énigmatique au sens le plus fort du terme. Le livre de Julie Assouly est une excellente et profonde introduction à leur œuvre. Elle montre comment celle-ci se déploie à travers l’espace et le temps, revisitant L’Amérique comme un mythe de moins en moins vivant dont vivent encore des millions d’Américains. Du Nord (Fargo) au Sud (Ô brother), de l’Est à l’Ouest (Barton Fink), ils mettent en scène de fortes disparités régionales, avec des différences d’accent très marquées, mais aussi de comportement. Si ce qui unifie ce pays c’est la violence qui le déchire, celle-ci n’est jamais vécue de la même manière. Très attachés à l’histoire, les réalisateurs vont remonter aux racines du film noir, c’est-à-dire au début de l’achèvement de la modernité. Ils exploreront d’autres genres, mais selon moi avec moins de bonheur, et même en s’éloignant du film noir, ils marqueront un très net déclin après The man who wasn’t there. Si True grit est une incontestable réussite, Inside Llewyn Davis également très intéressant, les films des frères Coen sont moins enthousiasmants après 2001. Le lamentable The ballad of Buster Scruggs tourné pour Netflix[1] est la preuve de cet asséchement de la créativité des deux frères, et leur dernier film, The tragedy of Macbeth qui devrait sortir sur nos écrans en 2021, l’œuvre de Shakespeare remise au goût du jour de la Cancel Culture laisse craindre le pire. Sur ce dernier film on note qu’Ethan Coen n’est pas associé au projet.
Blood simple, 1984
Si l’œuvre des frères Coen apparaît comme cohérente et novatrice, il ne faut pas non plus penser qu’elle soit toute de même valeur. Julie Assouly ne veut pas faire trop attention à cette question qui pourtant ressort aussi des conditions matérielles dans lesquelles ces films sont tournés. Ce sont des cinéastes sans doute trop habitués aux récompenses dans les grands festivals. Et sans doute celles-ci pèsent aussi sur leur volonté de se renouveler pour en gagner d’autres. C’est un problème qu’on rencontre souvent avec les grands cinéastes couverts de lauriers, plus personne n’ose dire du mal de leur production, quant bien même c’est raté. Julie Assouly ne se pose pas ce genre de question, par contre elle détaille fort bien la méthode des frères Coen. Ils usent à la fois du détournement et du retournement. Leurs films sont construits à partir d’emprunts extrêmement abondants qu’on n’a jamais fini de décrypter. Un peu comme Melville – qui est une de leur référence majeure, peu souvent remarquée – qui n’en construisait pas moins une œuvre personnelle. Cette manière de faire est intéressante et provoque des lectures foisonnantes et multiples de leurs films qui par ailleurs peuvent très bien se voir sans ne rien connaître de ces citations et de ces images dérobées ici ou là. Mais ces citations ne sont pas gratuites, elles ne servent pas seulement à faire réfléchir le spectateur. Elles sont là pour interroger le cinéma comme moyen singulier de construire une histoire de l’Amérique et donc les codes qu’elle produit. Les frères Coen introduisent une manière « grotesque » de détournement, Julie Assouly en détaille les raisons. Cette façon de se distancier de son sujet permet en réalité d’aller au-delà du simple fait de raconter une histoire. Contrairement à ce que pense Julie Assouly, je crois qu’il faut y lire aussi un commentaire politique, et ce n’est pas pour rien que les frères Coen se placent sous le parrainage de Dashiell Hammett pour Miller’s crossing. Il n’est donc pas étonnant de voir finalement Joel Coen épouser la Cancel culture et encourager l’appropriation culturelle de Shakespeare par un acteur noir, Denzel Washington.
Miller’s crossing, 1990
Dans Barton Fink, les frères Coen à travers des stéréotypes, des caricatures, se livrent à une critique féroce d’Hollywood comme miroir du capitalisme aussi bien comme système économique que comme producteur de codes sociaux. Alors bien sûr Barton Fink lui-même est un écrivain communiste complètement à côté de ses souliers, mais il représente pourtant malgré tout la fonction critique de l’artiste, il est le double moqué des frères Coen. Sa méditation dans la scène finale va en réalité lui ouvrir les yeux sur ses faiblesses et ses incapacités à passer à la pratique. La fonction de la caricature n’a pas chez eux seulement le sens de rabaisser les personnages et leur dénier toute fonction positive, c’est même le contraire. Quelles que soient les insuffisances des individus qui se voudraient positifs, ils ont le mérite d’exister, et sous les moqueries, il y a une tendresse évidente. Le Dude de The Big Lebowski en opposant une passivité et une fainéantise sans limite est attachant dans la critique implicite qu’il porte fatalement sur le mode de consommation américain. Dans la construction de ces figures, il faut y voir aussi un retournement du modèle hollywoodien qui n’admet le plus souvent que des héros positifs au physique glamour. Everett McGill de Ô brother where art thou ? a un physique avenant puisque c’est George Clooney qui l’incarne, mais il est une sorte de séducteur factice, se gominant les cheveux à longueur de temps, comme si justement en faisant d’une star de cinéma à l’ancienne un imbécile imbus de lui-même, on pouvait finalement apercevoir l’envers du décor, passer de l’autre côté.
Barton Fink, 1991
Julie Assouly a un point de vue particulier, elle considère que le noyau dur de la filmographie des frères Coen est la comédie sarcastique comme relecture des tares de l’Amérique, revisitant les genres et les sous-genres dont ils réutilisent les codes. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense au contraire que c’est le film noir qui est au cœur de l’œuvre des cinéastes. Par exemple, Julie Assouly regarde The Big Lebowski comme une comédie, certes un peu grinçante, mais une comédie. Mais, on peut voir ce film comme une relecture de The big sleep de Raymond Chandler. De là découle un grand nombre de malentendus. Par exemple arguant des origines juives des deux cinéastes, elle en déduit à tort un rapprochement avec Woody Allen, au prétexte que leur œuvre ressortirait aussi de l’humour juif. Mais outre que les frères Coen tiennent volontairement leurs propres origines à distance, les ambitions sont tout à fait différentes, et les moyens mis en œuvre aussi. Woody Allen travaille à un cinéma minimaliste, souvent redondant et peu soigné sur le plan technique, télévisuel, comptant essentiellement sur la force de ses dialogues. Les frères Coen même si leurs dialogues sont très travaillés, misent beaucoup sur les images et sur le mouvement, mais aussi sur la direction d’acteurs. Les références qu’on peut retrouver avec le film noir, notamment dans le traitement des ombres et de la lumière le prouvent. De même le travail considérable sur les couleurs ne peut que les distinguer des films de Woody Allen qui le plus souvent ressemblent à des téléfilms hâtifs. Or lorsqu’on parle de cinéma les images parlent au moins autant si ce n’est plus que les paroles. Les frères Coen revendiquent une filiation avec le grand Hollywood des années trente-quarante. C’est là que leurs emprunts se font les plus abondants, Capra, Sturges, Hawks, mais aussi ils en captent la lumière. Contrairement à Woody Allen, ils ne travaillent pas pour une élite auto-proclamée, les lecteurs de Télérama, et c’est peut-être pour cela que leurs films sont souvent dépaysés en dehors des villes. Verrait-on Woody Allen tourner un western ?

The Hudsucker proxy, 1994
Une autre dimension importante de la filmographie des frères Coen qui aurait pu être abordée plus abondamment est celle de son rapport au Marquis de Sade que Breton rangeait dans son Anthologie de l’humour noir[2]. Julie Assouly voit bien une partie du problème lorsqu’elle détaille le fait que leurs films ne mettent en scènes généralement que des imbéciles ou des personnages mal finis. Elle le souligne aussi un peu quand elle aborde la question du sacrifice animalier qu’on trouve dans la plupart de leurs œuvres – notamment ces cadavres de chiens dans No country for the old men. Mais elle ne le relie pas à cette manière de tourner la vertu en dérision, et au fond de récompenser le vice, refusant la compassion et le sentimentalisme. A cet égard le personnage d’Anton Chigurh est emblématique. C’est la bête brute qui triomphe. La plupart des criminels d’occasion qui sont mis en scène sont porteur du mal après avoir fait l’expérience du bien. Jerry, le héros négatif de Fargo, est dans ce cas. Il a bien essayé d’être un bon père de famille, travailleur, entreprenant, mais cela ne lui à pas réussi, son beau père l’escroque sans vergogne, alors il s’essaye au crime, voulant prouver par là la supériorité de son intelligence. Il est d’ailleurs remarquable que les héros de ce cirque coenien soient presque tous persuadés de leur supériorité intellectuelle. Ce même Jerry se croit bien plus intelligent que les deux criminels qu’il embauche. Il sera cruellement puni d’avoir eu cette idée saugrenue. Everett de Ô brother where art thou ? répète à ses complices de l’évasion qu’il est leur chef naturel parce qu’il est le plus intelligent. Visser le vicieux détective de Blood simple lui aussi se croit un grand manipulateur, il le paiera très cher. Les innocents ne sont pas épargnés et Ed Crane le coiffeur, mari trompé, escroqué par un colporteur, sera conduit à la chaise électrique pour un crime qu’il n’a pas commis.
Fargo, 1996
Parmi les aspects de l’œuvre des frères Coen, on relève le problème du multiculturalisme. Il est présent dans tous leurs films et aboutit à donner systématiquement un aspect positif au personnages noirs, les Amérindiens sont curieusement moins bien traités, jusqu’à faire, pour Joel Coen, de Denzel Washington un nouveau Macbeth. Tommy Johnson est un guitariste noir dans Ô brother, il se croit habité par le diable, ce qui est évidemment une façon de retourner positivement la vision que les racistes Américains avaient des noirs jusqu’à une époque assez récente, au moins dans le Sud. Les Juifs sont bien moins traités que les noirs. Cela peut sembler curieux étant donné leurs origines ethniques, mais en réalité, c’est une manière de dire qu’ils sont en haut de la pyramide et que, contrairement aux noirs, ils n’ont plus besoin de notre compassion – encore qu’on puisse se poser la question du sens du film A serious man, au-delà de leur interrogation sur ce qu’ils ont été et ce qu’ils sont devenus. Cette rhétorique ne pourrait absolument pas passer si elle n’était portée par un discours décalé et humoristique. Mais on reconnaitra que c’est une manière pour eux d’être résolument moderne et en avance sur leur temps.
The big Lebowski, 1998
Un des passages les plus intéressants de l’ouvrage est de regarder, malgré l’évidente hybridation des films, la filmographie des frères Coen comme une continuation du film noir, une évolution qui passe du cycle noir classique au néo-noir, puis au post-noir. Cette idée nous renvoie au fond à l’idée que le film noir est un genre qui comme tel évolue nécessairement au fil du temps, non seulement parce que le monde change – même quand on le situe dans une réinterprétation du passé – mais parce que les techniques narratives, comme les instruments de fabrication d’un film évoluent. Avant Melville et Le samouraï, ou Michelangelo Antonioni et il desserto rosso, le travail sur les couleurs n’est pas du même ordre et ne participe pas vraiment au récit. C’est dans les années soixante-dix qu’on y travaillera plus complètement, comme par exemple Mauro Bolognini et ses films semi-historiques, comme Bubu ou Metello. Remarquez que Julie Assouly analyse profondément les rapports des films des frères Coen avec la peinture, les influences d’Edward Hopper ou de Norman Rockwell. Automatiquement cette prise de position a des conséquences sur la réévaluation du film noir. Mais Julie Assouly ne pousse pas assez sa réflexion. Elle fait comme si le film noir était un genre spécifiquement américain – comme le western – et qui serait apparut en 1941 avec The maltese falcon de John Huston. Or justement les origines du film noir se perdent finalement dans l’histoire du cinéma. Dans sa forme la plus classique, on les trouve aussi bien chez Joseph Von Sternberg avec Underworld par exemple que chez le français Pierre Chenal avec Dernier tournant.
Ô brother where art thou ?, 2000
J’ai remarqué que Julie Assouly ne donnait pas sur le plan quantitatif autant d’importance à tous les films des frères Coen. Ses films phares sont Miller’s crossing, Barton Fink, Ô brother where art thou ? et The man who wasn’t there. Elle n’a pas grand-chose à dire sur True Grit, pourtant leur plus grand succès à ce jour, Burn after reading est presque passé sous silence. Lady’s killer aussi. Elle donne finalement moins d’importance aux films après The man who wasn’t here, et ne sait pas trop quoi faire de Inside Llewyn Davis dont elle parle dans la seconde édition de son ouvrage. Si nous la suivons, il est clair qu’à part No country for the old men, il y a globalement une baisse importante de créativité après 2001, ce qui me parait tout de même ressortir de l’évidence. Ne voulant pas faire référence à Jean-Pierre Melville elle passe d’ailleurs à côté de la signification du chapeau qu’on voit flotter au vent dans Miller’s crossing. Pourtant elle analyse finement les inflexions dans la manière de filmer, il y a un passage tout à fait intéressant lorsqu’elle montre comment les frères Coen passent d’une caméra subjective à une caméra plus objective et faussement documentaire à partir de Fargo.
The Barber, 3001
L’écriture de cet ouvrage s’appuie sur une bibliographie considérable qui peut paraître surcharger le texte, mais elle permet de remonter aussi bien l’histoire d’un genre que celle d’une méthodologie critique. C’est appréciable. C’est parfois un peu lourdement écrit, mais c’est un ouvrage des plus enrichissants car au-delà de la mise en perspective de la carrière des frères Coen, il y a une belle réflexion sur ce qu’est le cinéma, et à quoi ça sert. Quelles que soient les remarques critiques qu’on peut lui adresser, c’est un ouvrage excellent et très complet, très stimulant pour découvrir et pénétrer dans la cinématographie des frères Coen. Deux passages me semblent très forts, l'analyse qu'elle fait des rapports avec le fantastique et H. P. Lovecraft et les longs développements sur la notion d'Americana.
Extrait
 Tags : Julie Assouly, Joel & Ethan Coen
Tags : Julie Assouly, Joel & Ethan Coen
-
Commentaires
Très bien, je ne passerais pas tous les films des frères Coen en revue, après the barber, ça m'intéresse un peu moins. Avec le divorce Joel Ethan Coen, et Macbeth, je crains le pire
 Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
 Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire








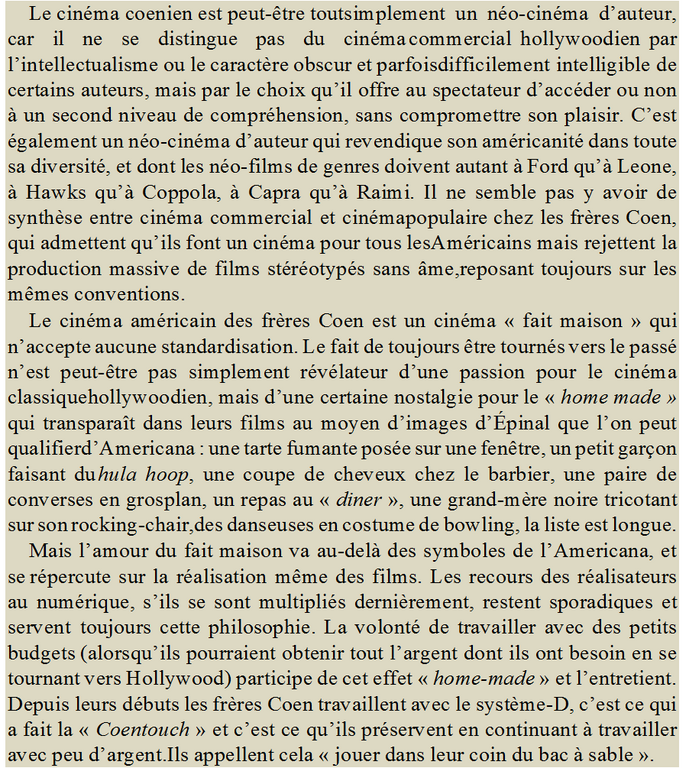



Pour vous remercier, j'ai mis en ligne la filmographie (avec liens) des frères Coen.