-
Par alexandre clement le 4 Avril 2012 à 21:09

N’ayant guère de bons souvenirs avec Chase, j’essaie périodiquement d’y retourner voir ce que les amateurs – et ils sont encore nombreux – peuvent y trouver. Je me dis qu’un tel succès a peut-être des raisons quoique je sois persuadé depuis longtemps que les succès de librairie ne sont pas forcément un gage de qualité. Le fait est encore plus juste aujourd’hui avec la prolifération d’une littérature commerciale qui encombre les rayons du polar façon thriller horrifique. Je ne citerais pas de noms.
Les bouchées doubles est l’archétype du roman noir de James Hadley Chase. Le type même attaqué par Narcejac dans La fin d’un bluff. C’est l’histoire de Dillon, un criminel un rien psychopathe, surgi de nulle part. Sans passé, ni présent, ni même futur, il décide de mettre la petite ville où il atterrit en coupe réglée. C’est la seule chose qui l’intéresse vraiment. L’argent, les gonzesses, ce n’est pas tellement son truc. L’ouvrage est un des tous premiers Chase, écrit probablement en 1939, il fut traduit en français qu’en 1950.
La chute et l’ascension de ce caïd de province est surtout décrite avec un maximum de violence, les cadavres s’empilent au fil des pages. Ni la vraisemblance factuelle, ni la psychologie n’intéresse Chase, ne reste que l’action et encore, celle-ci est très décousue. L’ouvrage part dans tous les sens. D’un côté l’attitude de Roxy et Dillon face à Chrissie rappelle Pas d’orchidées pour miss Blandish, de l’autre la sage de Dillon et Myra renvoie à Bonnie and Clyde. On ne sait pas à quelle époque cela se passe. Dans les années de la prohibition ? Les années cinquante ?
Les lieux sont à peine décrits, , les combines des voyous aussi et pour cause Chase parle d’une Amérique qu’il ne connait qu’à travers les journaux. Cet approche du polar de série a vécu, il est impossible aujourd’hui de rester aussi loin de la réalité, fusse-t-elle réinventée. La seule chose sur laquelle Chase s’appesantît, c’est la violence des voyous et des flics qui n’ont pas l’air de valoir grand-chose non plus. L’absence d’intrigue gêne aussi considérablement.
Ce n’est plus un roman behavioriste comme dirait Manchette, mais un simple roman d’action, sans âme et sans signification. Les thèmes abordés par Chase ont été nombreux, sa palette est très large, allant du roman d’espionnage à celui de criminel en série. Certains voient derrière la signature de Chase la plume de Graham Greene. Leurs arguments se défendent bien selon moi, mais il n’empêche que c’est très difficile de lire encore Chase aujourd’hui, tellement cela semble bâclé et dénué du moindre humour.
Pour beaucoup Chase est le prototype de l’écrivain de roman noir commercial. Mais le moins qu’on puisse dire est que l’opinion des amateurs est très partagée sur ses qualités. Les plus critiques considèrent qu’il n’est qu’un fabricant sans style, pour d’autres au contraire, même si son œuvre abondante n’est pas toujours de qualité égale, ils le rangent parmi les plus grands, à la hauteur de Chandler ou d’Hammett. A quelques rares exceptions près, je suis plutôt de l’avis des premiers. La raison en est probablement qu’il ne travaille pas beaucoup ses intrigues, se contentant d’aligner les scènes d’action. Ce désordre fait que les nombreuses incohérences du récit lassent le lecteur. Par exemple, dans Les bouchées doubles, Dillon ne se décide pas à sauter Myra, alors qu’elle n’en peut plus de l’attendre, mais après il s’en désintéresse et sans plus de raison s’en va la tromper avec la gonzesse de son associé. Si on compare Les bouchées doubles à Je suis un truand, autre ouvrage phare publié de manière anonyme à la série noire, on mesure l’écart qu’il restait à combler à Chase pour être un vrai auteur de romans noirs.

Tous les personnages qu’on rencontre dans ce livre sont mauvais, ils n’ont rien de bon en eux. Méchants, magouilleurs, sournois, il n’y a rien pour les sauver. C’est un peu le principe de certains romans noirs, mais il manque ici une compréhension de cette déliquescence. Quelque chose qui nous ferait les reconnaître comme des êtres humains, quelque part nos frères.
Chase s’est fait connaître à cause de ses emprunts et plagiats. Plusieurs fois condamné pour avoir pompé James Cain ou Chandler. Dans Les bouchées doubles, il y a du Steinbeck, version Des souris et des hommes. S’il retient la brutalité de ces auteurs, il n’en a pas la subtilité.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 21 Mars 2012 à 06:09

Les romans de Claude Aveline sont considérés aujourd’hui comme des classiques du roman policier. Mais s’il est bien moins souvent cité comme un des maîtres du genre, comme Simenon par exemple, c’est qu’il n’a pas beaucoup publié de grandes quantités d’ouvrages et que dans son œuvre les romans policiers ne sont pas très nombreux, il préférait suivre son bon plaisir, produire de la littérature pour la jeunesse, des essais ou des romans sur des sujets plus traditionnels. Pourtant son œuvre dans le domaine du roman policier en fait un des spécialistes incontournables du genre, voire un novateur : c’est-à-dire qu’il est un point de passage obligé pour qui veut connaître le roman policier dans sa genèse et son développement. Sa suite policière comportera cinq romans, elle est construite autour de Frédéric Belot. Elle commence du reste par la mort de celui-ci, avant qu’Aveline ne remonte le temps et n’écrive d’autres aventures de Belot. A cette suite il faut ajouter Le prisonnier qui est moins un roman policier qu’un roman noir. Mais au-delà de son aspect novateur pour l’époque on prend bien évidemment un grand plaisir à le lire.

La double mort de Frédéric Belot est publié en 1932. Il paraît au moment du boom du roman policier, il est quasi contemporain des premiers Maigret. Il est intéressant aussi bien par le fond que par la forme. Ses rééditions successives sont souvent accompagnées des notes de Claude Aveline lui-même sur le roman policier. Sa défense du genre rappelle assez celles que proposera ensuite Narcejac. Frédéric Belot est un brillant policier qui est retrouvé mort chez lui, mais en compagnie d’un sosie qui est lui agonisant. Pendant un moment du reste on ne sait si l’agonisant est ou non Belot. A partir de là il y a un double mystère à élucider, d’un côté celui de savoir qui a commis le double meurtre et de l’autre celui de savoir qui est ce sosie. L’histoire est rapportée, d’après ce qu’on lit, par le filleul de Frédéric Belot qui est lui aussi policier. Au-delà de l’enquête policière, assez classique, il y a une réflexion sur les identités. Belot devient Ferroux et Ferroux devient un peu Belot. Ce roman est une des sources d’inspiration du tandem Boileau-Narcejac, non seulement pour la dimension psychologique des personnages, mais aussi pour le style utilisé et pour les formes d’intrigues emboîtées les unes dans les autres. Le pari est évidemment de surprendre, c’est-à-dire de ne pas laisser la possibilité au lecteur de découvrir la solution du mystère. Si le cadre rappelle les romans de Simenon mettant en scène Maigret, l’histoire s’éloigne de cette manière psychologisante de mener l’enquête. La dimension psychologique n’apparaît dans le roman que dans les moments où il faut expliquer ce qui a mis en mouvement le criminel ou son complice.
Le portrait du double de Belot, Ferroux, s’appuie sur un thème qui va devenir cher à Aveline. Le hasard a amené ce pauvre homme à prendre dans un premier temps la place du coupable. Manipulé par son supérieur indélicat, il est mis à l’index par la société qui le croit coupable de détournements de fonds. Sa vie est ruiné, il ne pourra retrouver un peu de dignité qu’en aidant Belot dans son travail de policier.
Le style est étonnamment moderne, vif, rapide, l’ouvrage n’a pas le degré de confusion des Simenon contemporains. Sans être un roman d’action, c’est la lisibilité de l’intrigue qui est ici privilégiée.
Dans sa Double note sur le roman policier, Claude Aveline rappelle aussi bien pourquoi le roman policier apparaît comme un phénomène de masse entre les deux guerres, que ses rapports avec l’avènement du freudisme. S’il défend le genre, il ne se fait pas d’illusion : il pense par exemple que si on conserve en mémoire La double mort de Frédéric Belot, c’est parce que le livre ne fut pas publié dans une collection dédiée au genre policier, mais chez Grasset, comme un ouvrage « normal ».
Le prisonnier, paru en 1936, eut un retentissement énorme à la fois sur le roman policier et sur la littérature puisque cet ouvrage est une des sources d’inspiration de L’étranger de Camus. C’est une histoire très simple : un jeune employé de banque solitaire est victime d’un couple d’escrocs qui le manipulent et l’amènent à détourner des fonds. On suppose que cette idée lui est venue à cause de la multiplication des scandales financiers qui se multiplièrent au début des années trente.
C’est un vrai roman noir, à la française. Bien entendu c’est le style qui va donner toute sa force à ce texte, car l’histoire semble avoir servi cent fois. Comment caractériser ce style qui nous parait aujourd’hui encore très moderne ? Il y a d’abord la forme. L’histoire est racontée à la première personne sous la forme d’une confession envoyée à un ami de lycée d’Alain Gallon. On pourrait rapprocher Le prisonnier du film de Carné, Le jour se lève qui fut tourné en 1939. En effet les deux hommes attendent à leur fenêtre la fin imminente de leur parcours. Cette forme qui fut ensuite très souvent utilisée, on pense à Lettre à mon juge, de Georges Simenon, ou à L’accident, de Frédéric Dard s’appuie sur une utilisation de l’imparfait qui donne à l’histoire un côté irréel. C’est aussi sur cette forme que s’appuiera Camus pour L’étranger, tout en le débarrassant un peu de sa forme confessionnelle. Mais cela ne suffirait pas à rendre le roman exceptionnel.
L’autre aspect du texte est la façon dont il est découpé. D’emblée on est prévenu : cet homme va commettre un crime et cet homme va mourir. Il vient de purger sept années de prison et il désire se venger. Mais cet aspect policier, l’escroquerie, la préparation du meurtre, ne tient pas beaucoup de place dans le roman. Ce qui est plus important ce sont les raisons matérielles et psychologiques qui ont amené le « héros » dans une situation dont il ne peut sortir. Et c’est cela qui tient le lecteur en haleine, bien plus que l’aspect criminel.
Les raisons qui scellent le sort d’André Gallon sont de deux ordres : la forme particulière de sa famille : sa mère le déteste, et sa position de classe : venant d’un milieu très pauvre, il n’arrive pas à se faire accepter par ses condisciples de Jason de Sailly.
La vie d’André Gallon est une suite de traumatismes qui l’a enfermé dans une solitude dont il ne peut sortir. Et quand il croit trouver l’amour qui lui permettrait enfin de vivre il ne trouve que le mensonge. Une grande partie du roman, peut-être les deux tiers, donne à voir ce qu’est la pauvreté, cette position d’infériorité qui se construit dans la fréquentation des classes supérieures, cette humiliation de se trouver en permanence confronté à des gens qui vous méprisent et tiennent votre destinée dans leurs mains. La mère d’André fait des ménages chez les riches qu’elle déteste, elle représente une forme de révolte, encourage son mari à faire grève, à aller au-delà de ses convictions politiques. Tout cet aspect, avec la description qu’il y a à joindre les deux bouts donne au roman un aspect « prolétarien » au sens qu’Henri Poulaille pouvait donner à ce terme. On voit où plonge les racines d’Aveline, dans le roman populaire à la française, Louis-Philippe, Poulaille ou Dabit. Il anticipe les romans de Jean Meckert, le ton du Prisonnier rappelle Les coups, mais aussi une partie de ce qu’on a nommé ensuite le néo-polar. C’est ici dans cette conscience de classe affirmée, Aveline sera proche des milieux communistes, que le roman noir trouve sa meilleure source. Des scènes très fortes scandent le récit, comme lorsque la mère perd sa place dans une maison riche et qu’elle affirme sa rage impuissante, son envie de subvertir l’ordre régnant.
Mais ce n’est pas un roman engagé dans le sens où le message n’est jamais au premier plan (c’est probablement cela qui le distingue du néo-polar). C’est plutôt le récit des conséquences d’une société fondée sur la cupidité et le mensonge.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 16 Janvier 2012 à 06:20

Le projet de Jean Contrucci à travers les aventures de Raoul Signoret, journaliste au Petit Provençal, est de faire revivre le Marseille de la Belle Epoque. La série se nomme Les nouveaux mystères de Marseille, aussi bien en hommage à Eugène Sue qu’à Emile Zola, ou encore au Léo Malet des Nouveaux mystères de Paris dont il reprend l’idée de produire une enquête par quartier de Marseille. Ces aventures ne sont pas statiques et accompagnent l’évolution des héros aussi bien que de la ville, on y voit les réalisations de la mairie de Simon Flaissières qui modernisent radicalement Marseille, en même temps que cette explosion de violence et de délinquance qui vont marquer Marseille pour de longues décennies.
Jean Contrucci a une fibre sociale nettement marqué, comme son héros, c’est un Marseille populaire qu’il met en scène. Il est de gauche, avec une tendresse particulière pour les anarchistes. Justement les anarchistes sont plus que présents dans cet opus, le troisième de la série. On y retrouve Baptistin Travail, cambrioleur artiste, mais aussi l’ombre de Marius Jacob. Au-delà de l’aspect en apparence un peu folklorique et léger, il y a une description saisissante de la condition prolétaire. La pauvreté, les problèmes générés par une immigration italienne destinée à faire baisser les salaires dans les grandes usines de l’agglomération, le manque d’hygiène, etc…
Mais tout cela s’appuie sur un récit policier au sens le plus classique du terme. Si le récit se passe au début du siècle, il en épouse aussi les formes de la littérature populaire de l’époque. Car Raoul Signoret est un journaliste un peu à la manière de Rouletabille, il dénoue plus ou moins des intrigues, le plus souvent avec l’aide de sa femme, Cécile, et de son oncle qui est aussi un policier émérite et qui deviendra au fil des épisodes le chef de la sureté marseillaise. Jeune, idéaliste et enthousiaste, il pratique la boxe française, ce qui lui sert souvent dans les ruelles chaudes de Marseille.
Le secret du docteur Danglars raconte l’histoire d’une vengeance. Danglars est en effet poursuivi pour un avortement qu’il n’a pas commis, mais qui a eu comme conséquence le décès d’une jeune domestique qui est en même temps la maitresse d’un anarchiste qui vient d’être décapité pour avoir tué un commissaire de police. L’exécution par laquelle débute le livre est d’ailleurs très émouvante et particulièrement bien écrite. Rien que pour ce premier chapitre, il convient de le lire.
Or cet anarchiste a été dénoncé par son oncle qui n’est autre que le neveu du docteur Danglars. Comme c’est la loi du genre, on va aller de rebondissement en rebondissement jusqu’à la fin. Même si celle-ci est un peu téléphonée, l’histoire tient tout à fait ses promesses.
Des fumeries d’opium au trafic de stupéfiant, en passant par la description de toutes les misères des quartiers populaires et de l’égoïsme des possédants, c’est un Marseille ni tout à fait nostalgique, ni complétement désespéré qui revit sous nos yeux. L’utilisation du parler marseillais est tout à fait adéquate, c’est-à-dire qu’elle donne du corps au récit sans le saturer d’expressions folkloriques. C’est pour moi, vieux marseillais, bien sûr un plaisir de retrouver cette langue qui se parlait il n’y a pas si longtemps dans nos murs, dans ma famille, et qui s’estompe définitivement depuis trois ou quatre décennies. On est au cœur d’une culture populaire qui existe aussi bien par la langue que par la façon de cuisiner ou d’habiter des lieux, de donner une âme à un quartier ou une rue.
Tous ces lieux que Contrucci reconstruit pour nous, je les connais, et je m’amuse à en retrouver les traces et les transformations. Au fond ils existaient encore un peu dans ma jeunesse. Il y a là, malgré quelques petites erreurs factuelles bien compréhensibles (notamment sur Marius Jacob), une vraie érudition pleine de poésie qui nous enchante.
Si on a parlé de « polar marseillais » un peu à tort et à travers, il va de soi que Jean Contrucci en est le représentant le plus éminent. Et si sa série connait un grand succès, même au-dessus de Valence, celui-ci est tout à fait mérité
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 9 Janvier 2012 à 08:33
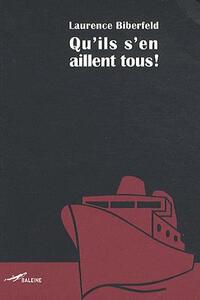
Deux détectives privés plutôt atypiques enquêtent sur la mort du capitaine d’un port de la France du Nord. Evidemment au cours de leurs recherchent ils vont croiser toute une palette de caractères qui gravitent autour des activités portuaires alors que dans le même temps les marins puis les dockers se mettent en grève pour dénoncer les dégats que provoque la mondialisation et la montée de la pauvreté.
Le capitaine devient de plus en plus curieux au fil des pages. Il n’est jamais celui qu’on croit qu’il est. Il navigue entre le dégout de lui-même et la volonté de se révolter. Mais son caractère est très compliqué : c’est un puritain, croyant, homosexuel honteux, il passe sa vie à dissimulker aux autres ce qu’il est vraiment.
Le récit va naviguer entre d’un côté une bourgeoisie arrogante et cynique, complètement tarée et les victimes du capitalisme : les travailleurs clandestins, des enfants livrés à la prostitution, les prolétaires déclassés qui découvrent la nécessité de la révolution au fur et à mesure que leur situation devient de plus en plus précaire.
Le livre est, avant d’être un roman noir, un traité de la révolution à venir. Il en décrit les raisons et les modalités. Car Biberfeld est révolutionnaire, de la tendance anarchiste, antisyndicaliste. Elle croit à la grève générale et à l’autogestion comme modalité de ressourcement et de purification de la société.
Si l’ouvrage se refuse au réalisme social, justement en décrivant une situation insurrectionnelle qui n’existe pas encore en France, il ne s’appuie pas moins sur une réalité connue plutôt déprimante. Des navires malades sont abandonnés avec leur équipage au gré des intérêts de quelques capitalistes rapaces. D’ailleurs le contexte rappelle l’ouvrage de Jean-Claude Izzo, Les marins perdus. Cependant, toute la deuxième partie du roman est plutôt délirante, puisque l’auteur imagine une situation insurrectionnelle sembable à un mai 68 en plus violent et en plus radical.
Il n’y a guère de suspense, par contre la dynamique de la révolution est décrite dans le détail. Les patrons, les hommes politiques, les leaders syndicaux sont tous aux abonnés absents. C’est le parti des émigrés qui va tenter d’étouffer la révolution depuis l’étranger.
C’est un roman curieux, on y rencontre, contrairement à la veine passée du néo-polar, des flics révolutionnaires, d’ailleurs originaires de Marseille. Cette simple assertion aurait d’ailleurs suffit aux surréalistes ou aux situationnistes pour tenir Biberfeld à distance. Mais les temps changent, et en bon apôtre du roman noir, la plupart des personnages restent ambigus, coincés dans leur nécessité matérielle.
Plus que l’intrigue qui parfois se perd un peu dans les redondances de l’enquête de nos deux détectives, c’est l’écriture qui intéresse Biberfeld. Elle multiplie les formes, passant du dialogue théâtral, à la narration naturaliste, jonglant avec les temps, le passé et le présent, entremêlant la chronologie, allant d’une vision onirique des rapports sociaux à la sécheresse des scènes de violence sordide. Le meilleur étant sans doute dans les dialogues où Biberfeld peut user des différences dans les langages utilisés en fonction des personnages. L’ensemble tire dans le sens d’une démonstration de la nécesité à réinventer la vie pour construire une société post-capitaliste, ce qui devrait être reconstruit sur une société qui s’effondre sous nos yeux. Cette nouvelle société se construira dans une refondation de nos références culturelles et des rapports sociaux. L’art y aura une grande importance, mais cet art est celui qui viendra de façon spontanée de la rue dans la libération de nos sens. Par les principes qu’elle met en œuvre, Biberfeld rejoint la longue tradition du roman prolétarien telle qu’elle est définit par Henri Poulaille.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 4 Novembre 2011 à 07:46

Ce court roman est écrit sous la forme d’une lettre envoyée à un haut responsable de la Gestapo auquel le narrateur va demander un service. On ne saura qu’à la fin quelle est la nature de ce service. Se pensant obligé de se justifier, il va raconter sa triste existence.
Paul-Jean Husson est un écrivain célèbre, membre de l’Académie où il se lit avec le Maréchal Pétain, il représente la bourgeoisie conservatrice qui allie le patriotisme le plus désuet à la collaboration forcenée avec l’occupant. Il est une de ces tristes plumes qui vont faire semblant d’agir pour le bien commun en éructant un antisémitisme criminel autant que stupide. Mais la réalité le piège, car son fils va tomber amoureux d’une jeune Allemande qui a tous les traits de l’aryanité, mais qui est en réalité juive. Quand notre académicien découvre cela il va être effondré, n’ayant dans un premier temps que l’idée de se venger.
La vie d’Husson est étriquée, elle se partage entre des mondanités littéraires et des amours adultérines dérisoires. Or la soixantaine étant là, il va croire qu’il est amoureux de la femme de son fils. Dévoré par un orgueil démesuré, il va commencer à manœuvrer pour séduire la jeune Allemande.
Tout cela finira très mal et plus le temps passera et plus Husson se roulera dans la turpitude, masquant le plus souvent la veulerie de son caractère derrière des objectifs élevés et une sorte d’idéalisme de pacotille : la nécessité de relever la France au cœur d’une Europe dominée par l’Allemagne nazie.
Le roman est volontairement écrit dans un style ampoulé qui est celui d’une certaine littérature bourgeoise d’avant-guerre. C’est la grande réussite du roman que d’avoir usé de ce manque de distance puisqu’en effet il montre la vacuité et la tricherie de ce « beau style » qui n’est qu’une coquille vide.
Monsieur le commandant repose sur une documentation très solide qui donne du corps à ce que fut la collaboration. Il n’hésite d’ailleurs pas à citer des noms réels qui se sont compromis sans retenue, des articles de journaux. Dans cette année dédiée à la gloire de l’immonde Céline, c’est une bonne chose d’exhiber toute cette sournoiserie. Slocombe recycle d’ailleurs un épisode de la vie de Céline, l’exode sous l’avancée des Allemands qui ressemble tout à fait au périple de l’auteur du Voyage au bout de la nuit. Mais si Husson n’est pas Céline, son style de vie est plus bourgeois, plus vieille France si on veut, et sa langue bien moins « peuple », il n’en est pas moins criminel dans l’usage de sa plume. Il appartient à ce funeste troupeau d’écrivains, Jouhandeau, Rebatet, Coston ou Céline et bien d‘autres qui se sont engouffrés dans la littérature antisémite violente. Se recopiant les uns les autres, usant des mêmes arguments pourris et des mêmes formules stylistiques, ils étaient aussi habités par l’opportunisme et cet esprit femelle de soumission qui les portaient à admirer la force virile des soldats allemands. Certains traits de caractère d’Husson semblent également inspirés d’Abel Bonnard, écrivain célèbre en son temps qui avait obtenu le prix de la triste Académie française.
Husson est un délicat et il est remarquable qu’il soit très gêné quand il est confronté à la réalité physique de la torture ou de la déportation des Juifs. Ça ne lui coûte pas grand-chose et ça l’aide à laver sa noire conscience. Les tortures morales qu’il s’inflige lorsqu’il se lance dans des stratégies biscornues pour séduire sa belle-fille lui servent avant tout à faire de la littérature. On les rapprochera de la fausse contrition qu’il nous fait partager à propos de la maladie et de la mort de sa femme.
Ce roman a été salué un peu partout et sa bonne réputation n’est pas usurpée. Il est un contrepoids bienvenu à la célébration sans retenu de Céline en 2011.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique





