-
Par alexandre clement le 26 Avril 2011 à 21:59

Charles-Louis Philippe est un écrivain qu’on oublie, et puis qu’on redécouvre depuis des décennies. Décrivant et méditant sur la condition de « pauvre » et de « misérable » au début du XXème siècle, il est pourtant très moderne. La plupart de ses ouvrages, romans et contes, sont imprégnés de sa propre existence, de l’expérience de la pauvreté.
Le meilleur de son œuvre est concentré sur quelques années au début du XXème siècle. Il peut être considéré à juste titre comme un précurseur de la littérature prolétarienne, devant Poulaille ou Dabit. Mais il est bien plus que cela parce qu’en effet il effectue un travail sur la langue, un travail semblable à celui des artisans. Il possède un style, à la fois drôle et tendre, ironique aussi.
Il est mort très jeune, à trente-cinq ans, emporté par une méningite foudroyante. On peut dire que malgré son enthousiasme, la vie ne lui a pas été favorable. Excellent élève, il poursuit ses études à coups de bourse, il progressera comme ça jusqu’à l’examen de Centrale qu’il échoue et qu’il refuse de tenter à nouveau. Mais comme il faut bien vivre, il va tenter sa chance à Paris et finit par obtenir un petit emploi de fonctionnaire qui, à défaut de l’enrichir, lui laisse du temps pour écrire. Assez rapidement il se fait remarquer des intellectuels de sa génération : Gide, Larbaud et bien d’autres le trouve terriblement moderne et novateur.
Pourtant son style est simple, et au premier abord il apparait dans la continuité du naturalisme de Zola ou même de Maupassant dont les contes l’inspireront. Le peuple pourrait le lire facilement, sauf qu’il n’a pas derrière lui un éditeur important, ses ouvrages seront d’abord édités à compte d’auteur, et sauf aussi que ses récits sont tout à fait sombres.
Philippe est le témoin d’un monde qui disparait et qui s’oriente vers l’industrie et le commerce. Imprégné de théories libertaires, ses écrits ne sont pourtant pas militants. Son propos est ailleurs. Il trace des caractères, comme des logiques dont le sens propre les dépasse. Tous ces personnages sont les victimes de leur condition matérielle. Ils n’ont pas assez de force pour s’élever au-delà de leur déterminisme. C’est le cas de Bubu, maquereau d’occasion par laisser-aller, mais c’est aussi le cas de Berthe, sa femme qu’il prostitue, et encore le cas de Pierre qui n’a pas assez de volonté pour aider Berthe à s’en sortir. La façon dont ils acceptent tous les trois la fatalité de la syphilis est parlante. Le père Perdrix est aussi dans le déterminisme, même s’il est d’un autre genre. Croyant devenir aveugle, il fait confiance à son médecin qui lui enjoint de ne plus travailler. Il est maréchal-ferrant, c’est un métier peut-être dur, mais c’est un métier qui nourrit sa famille et qui demande aussi une certaine habileté. Or tout cela lui est enlevé d’un seul coup, d’un seul, sans même qu’il ait l’intention de se révolter.
C’est probablement Bubu qui reste le chef-d’œuvre de Charles-Louis Philippe. C’est ce roman qui a situé son auteur quelque part entre Nietzche et Dostoïevski. Et c’est là qu’il se révèle aussi un grand styliste. Le roman est très noir, bien avant que ce soit la mode. On y croise des prostituées, des maquereaux, des étudiants pauvres aussi. La misère est partout, tant physique, que morale. Peut-être est-ce même que ce roman est à l’origine de style particulier du roman noir français qui se poursuivra avec Carco, Auguste Le Breton, Pierre Lesou et quelques autres. Et Philippe en l’écrivant semble être habité par une sorte de rage plutôt rare et détonante dans les lettres de cette époque. Jamais on n’a parlé aussi bien de la syphilis qu’ici.
« Oh ! sois bénie ! Vieille chanson des véroles, dans l’hôpital où tu naquis, tu chantais de lit en lit dans tous les cœurs, tu divinisais les mourants et tu battais des ailes des ailes sur le front des vérolés, vieille chanson des véroles ! »
« Il eut ensuite une idée de vérole. Eh ! s’il n’avait pas la vérole s’il n’avait pas la vérole ! Alors il lui sembla que ce serait retrancher quelque chose à sa gloire. Il marchait avec tant de passion que ses jambes semblaient soulevées. S’il n’avait pas la vérole, il était grand temps de l’avoir »

L’histoire de Bubu a été portée en 1971 (époque à laquelle on croyait encore à la transformation sociale dans un sens positif) à l’écran par Mauro Bolognini. Il est bien curieux que ce soit un italien qui ait eu l’idée d’adapter Philippe à l’écran. A croire que les réalisateurs français ne savent pas lire. Le film est excellent, probablement un des meilleurs de Bolognini. Le film possède des qualités nombreuses, à commencer par la photographie d’Ennio Guarnieri et les décors qui donnent intentionnellement un aspect très pictural au film, certains lui ont reproché son caractère esthétisant. On peut entendre également Léo Ferré chanter du Verlaine. Mais si l’histoire est assez fidèle à la lettre, elle en trahit cependant l’esprit. En effet, l’idée de transposer la prostitution du boulevard Sébastopol à Florence donne un côté provincial au drame. Egalement le film est porteur d’un message politique explicite qui n’est pas dans les intentions de Philippe, Berthe était une petite fleuriste, dans le film est une simple ouvrière. Car la prostitution est le résultat non seulement de la misère sociale, mais aussi de la perversité et de la fainéantise du maquereau de Berthe qui s’appuie sur l’imbécilité de celle-ci. Enfin, le film de Bolognini appuie plutôt sur la responsabilité de Piero (Pierre) et sur sa lâcheté. Dans le livre, quand Maurice vient reprendre Berthe, accompagné du Grand Jules, il revendique un droit marital car il a épousé Berthe, cet aspect disparaît dans le film et rend le retour de Berthe (Berta) à sa déchéance de femme publique plus difficilement compréhensible. Mais ces réserves, si elles donnent au film un contenu bien différent du livre, ne doivent pas faire oublier qu’il s’agit d’un très grand film. Ottavia Piccolo tient parfaitement le rôle de cette très jeune femme naïve qui se transforme au fil des jours en une putain marquée par la fatalité. L’utilisation des très beaux décors est accentuée par des mouvements de caméra virtuoses. On admirera la sortie de l’usine, l’enterrement de la pauvre prostituée ou encore les scènes de ces femmes malades dans le vieil hôpital. On notera que c’est la même équipe qui réalisa l’année précédente le très beau Metello.



Bibliographie
La mère et l’enfant, 1900
Bubu de Montparnasse, 1901
Le père Perdrix, 1902
Marie Donadieu, 1904
Croquignole, 1906
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 19 Mars 2011 à 08:10
Pécherot publie depuis plusieurs années à la Série noire. Après des débuts peu remarqués dans le polar contemporain car trop marqués des tics du néo-polar, avec complots en chaîne et message politique appuyé, il s’oriente vers le roman noir à connotation historique. Tout comme l’extravagant James Ellroy, mais avec plus de conscience sociale (ce qui n’est pas bien difficile) et une meilleure écriture, il mêle des personnages réels et des personnages historiques dans le déroulement de ses fictions. Ce sont ses pastiches de Léo Malet qui l’avaient d’ailleurs fait remarquer au-delà du petit cercle des amateurs de néo-polars. Il avait imaginé la jeunesse de Nestor Burma à partir d’un titre de Léo Malet, Les brouillards de la Butte, une aventure de Nestor Burma au moment de la Guerre d’Espagne et aussi Nestor Burma pendant l’Occupation, au tout début de celle-ci. Il était ensuite revenu au polar contemporain avec Soleil noir, mais ce fut un ouvrage peu convaincant, versant dans les travers misérabilistes du début. Pécherot se trouve finalement plus à l’aise quand il revisite l’histoire récente, disons la première partie du XXème siècle, du temps que les classes sociales existaient en tant que classes et luttaient pour leur hégémonie. Manifestement la défaite du prolétariat a produit une société aseptisée et sans humanité.
Ce retour en arrière permet à Pécherot de travailler sur le langage, revenir au parler populaire, ancré dans une classe sociale spécifique. En effet, le point de vue politique révolutionnaire de Pécherot est très clair : il ne s’accommode guère de la réalité économique et sociale capitaliste, et préfère défendre le point de vue des classes offensées, des marginaux, des pauvres et des exclus de toute sorte. Ce qui veut dire que la reconstitution de cette langue populaire n’est pas gratuite, elle désigne tout ce que nous avons perdu en termes de civilisation.
Dans son dernier ouvrage, qui est publié à la blanche, alors que Pécherot le destinait à la Série noire, il s’intéresse à la trajectoire d’André Soudy, un second rôle de la bande à Bonnot qui fut exécuté pour des crimes que probablement il n’avait pas commis. Il l’avait déjà cité dans Belleville-Barcelone au milieu de quelques autres héros de l’histoire de l’anarchie comme Marius Jacob. Ici, il va reprendre son parcours, resituer sa trajectoire à travers une vie de misère et d’exploitation et un engagement dans l’anarchisme illégaliste. Tuberculeux en sursis, Soudy flotte dans sa vie comme dans ses habits qui paraissent trop grands pour lui.
L’ouvrage est remarquable, que ce soit dans la description de la situation sociale et politique ou que ce soit dans la présentation de la répression policière qui s‘appuie à l’évidence sur l’ignorance du peuple. Pécherot esquisse (c’est d’ailleurs le sous-titre de son roman) plus qu’il ne décrit, suggérant des relations sociales complexes. Pour ceux qui se poseraient des questions sur la nécessité d’écrire de la fiction, la lecture de L’homme à la carabine les éclairera. C’est en effet par ce que Pécherot imagine être la vie de Soudy et de ses complices qu’il parvient à nous faire comprendre d’une manière « suprasensible » ce que furent ces temps où la lutte sociale s’effaçait lentement des mémoires et laissait la place à l’action individuelle.
Avec le recul des années, il est inintéressant de prendre position pour ou contre l’illégalisme de Bonnot qui trop souvent est présenté comme un imbécile sans conscience sociale. Et ce n’est d’ailleurs pas le but de Pécherot qui resitue la course à la mort des « bandits tragiques » dans le développement du capitalisme industriel triomphant et son cortège de misère. Ce qu’il détruit, ce qui est perdu irrémédiablement c’est cette idée de solidarité, de partage qui caractérise justement la culture ouvrière.
Si l’ouvrage de Pécherot nous touche c’est bien parce qu’il met en adéquation le langage de cette époque avec les actes et la situation politique. Découpé en petits chapitres courts, le roman utilise aussi plusieurs techniques d’approche. Parfois Soudy parle, parfois c’est Pécherot qui s’adresse à nous, mais on peut y lire des lettres, des rapports de police… Cette multiplication des points de vue, qu’on trouvait déjà dans Tranchecaille, n’est pas si facile à manier, et parfois elle peut paraître artificielle, mais dans l’ensemble elle procure une forte émotion, comme le portrait en creux qu’on découvre de Barbe, petite Bretonne à moitié idiote qui, fuyant la misère de ses campagnes échoue comme bonniche à Paris, avant d’être prise en affection par l’un des membres de la bande à Bonnot. Dans le corps du texte, Pécherot a inclus des photos qui rendent Soudy plus proche de nous et qui lui redonne un peu d’humanité.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 23 Février 2011 à 07:39
Edouard Rimbaud est originaire de Marseille, où il est né en 1920. Après avoir tâté du métier de policier durant l’occupation, il passera de l’autre côté du miroir et deviendra un vrai truand, avec un pied à Marseille et l’autre à Paris. Il a été aussi convoyeur de drogue dans le cadre de ce qu’on a appelé la French Connection. Mais apparemment sa carrière de truand a commencé bien avant puisqu’on trouve son nom mêlé à celui du faux baron Foucou d’Ines dans une affaire d’escroquerie en 1956. A cette époque il se faisait appeler Roucas. On ne sait pas grand-chose de sa vie, hormis ce qu’il a bien voulu en dire dans des mémoires forcément sélectives. Il a été également condamné aux Etats-Unis à trente ans de prison, ce qui l’a amené à balancer ses petits copains, et par suite, ce sera là un sujet de méditation pour lui. Bien sûr le fait d’avoir passé un deal avec la justice américaine l’a mis en danger, et probablement sa tête a-t-elle été mise à prix, ce qui l’obligea pendant un temps plus ou moins long à vivre sur le qui-vive, à se déplacer et à éviter de se faire repérer. Ce qui ne l’a pas empêché de faire publier deux ouvrages sous son nom.
Pour ce qui nous intéresse ici, il est l’auteur de deux ouvrage sous son nom : Les pourvoyeurs, roman dans le milieu de la drogue, paru en 1974 et de Doudou, paru en 2000, et qui raconte une partie de sa vie de truand. C’est ce dernier ouvrage qui lui a amené une certaine renommée. Il fait donc partie de cette cohorte d’écrivains qui ont un passé de truand : Simonin, Le Breton, José Giovanni, Mariolle et bien sûr l’immense Boudard. Ce qu’on sait moins est qu’il est l’auteur de deux autres romans parus en Série noire sous le nom de Louis Salinas, Comme à Gravelotte, et Le pot-au-feu est assuré, et qu’il aurait aussi aidé Jean Mariolle à retaper son bouquin, Les louchetracs, paru aussi en Série noire et réédité ces derniers temps à La manufacture de livres. Certains pensent même que c’est Rimbaud qui l’a écrit de A jusqu’à Z. Il est vrai que l’histoire des Louchetracs est assez semblable à celles que développaient Salinas, sauf que Les louchetracs est écrit avec un grand nombre de formules argotiques, ce qui n’est pas le cas ni de Salinas, ni de Rimbaud
L’ensemble de ces ouvrages révèle deux choses :
- d’une part que Edouard Rimbaud aime écrire, et qu’il peut écrire bien qu’il est également plus cultivé que la moyenne des malfrats qui traîne dans ce milieu.
- d’autre part que ses récits, signés de son nom, sont un témoignage de première main sur le quotidien des trafiquants de drogue, quelle que soit leur place dans la hiérarchie. C’est une sorte de « vie quotidienne » chez les trafiquants de came, dans les années soixante-dix.
Ecrits sans fioritures, les récits de Rimbaud développent une forme chorale qui ressemble un peu, mais comme un miroir aux romans de Wambaugh car il s’y trouve de l’autre côté de la barrière, du côté des marchands de drogue. Comme Wambaugh Rimbaud utilise les formes particulières de langage de la rue, et aussi des anecdotes propres à ce milieu particulier.
On peut diviser son œuvre en deux, d’un côté deux romans publiés en Série noire sous le nom de Salinas qui s’inscrivent dans une veine assez bien codifiée du roman de truands à la française, louchant du côté de Simonin ou de Pierre Lesou, mais sans grand éclat, et de l’autre un roman et un récit autobiographique d’excellente facture, signés Edouard Rimbaud et qui s’approchent par le ton et par la tenue des grands romans noirs américains.
En apparence son patronyme l’inclinait à allier une vie d’aventure à une vie d’écrivain. D’ailleurs, il exerça aussi un temps, assez bref il vrai, le métier de libraire, ce qui tend à prouver qu’il aimait aussi les livres.
Comme à Gravelotte, 1968
Rimbaud va utiliser d’abord un pseudonyme. Louis est le prénom de son père, mais Salinas on ne sait guère à quoi cela ressemble. Rimbaud ne s’en expliquera pas plus dans ses mémoires.
C’est la première tentative littéraire d’Edouard Rimbaud. Publié en 1968, c’est une histoire de truands marseillais assez traditionnelle. Sorti de prison, Serge retrouve ses deux anciens complices et amis, Gabarit et Gaspard. A partir de là, et d’une manière très confuse, deux histoires vont se croiser : d’un côté, Serge va poursuivre une vengeance vis-à-vis d’une équipe qui l’a doublé, et de l’autre Gaspard et Gabarit vont monter un cambriolage avec ouverture d’un coffre fort au chalumeau, ce qui semble avoir été un temps la spécialité de Rimbaud lui-même.
L’histoire est d’autant plus décousue que l’inspecteur Crespo a juré la perte de nos trois truands. Et à cette fin, il usera de toutes les fourberies possibles et imaginables, alternants chantage et fabrication de fausses preuves, allant jusqu’à flinguer les truands qu’il ne peut arrêter.
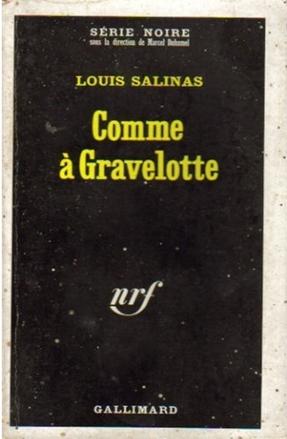
Il semblerait que l’histoire ait été tronquée par l’éditeur, la Série noire, de façon à la faire entrer dans les normes de l’époque, car il semble manquer des passages entiers, notamment vers la fin, quand on apprend que Serge a effectivement éliminé les frères Sartanéo et Allessandrini. En effet, suivant la logique de l’écriturre de Salinas, cela aurait dû être le clou de l’ouvrage, et non pas une digression de deux lignes rapportée par Crespo. Même chose pour l’arrestation de Serge, ou encore l’extraction de Gabarit.
Si les personnages avaient eu un minimum de psychologie et d’épaisseur, cela aurait pu faire un roman dans le genre de ceux que Pierre Lesou écrivait à l’époque, le personnage de Crespo y fait inmanquablement penser. Mais ce n’est pas le cas. C’est seulement une succession de scènes de genre : le cambriolage, le triquard qui se fait mettre à l’amende par le condé, etc.
L’ouvrage est râté dans son ensemble, le langage se veut un mélange de formules argotiques parisiennes à la Simonin et de français académique, les scènes d’amitié virile entre Gaspard et Gabarit ne sont pas très crédibles non plus. Il y a pourtant quelques éléments intéressants, par exemple on voit assez bien que l’auteur connait Marseille, car sans rajouter des détails, il campe clairement le décor. Par exemple les bistrots qu’il décrit dans la rue Vincent Scotto, anciennement rue de l’Arbre, étaient bien tels qu’il les décrits. Comme le toubib des allées Léon Gambetta qui est lui aussi plus vrai que nature. Il y a le Frippé qui va revenir dans l’ouvrage suivant. Mais on y trouve aussi une violence complaisamment décrite, comme cela ne se faisait guère à l’époque.
Le pot-au-feu est assuré, 1973
Le deuxième ouvrage de Louis Salinas, alias Edouard Rimbaud, pa raît cinq ans après. Le délais semble assez long. Mais il n’est pas certain qu’il ait été écrit aussi longtemps après que Comme à Gravelotte. Le style est un peu meilleur, mais l’histoire elle-même paraît dater du début des années soixante, plutôt que du début des années soixante-dix. En effet, il s’agit d’un conflit entre maquereaux parisiens et arabes, à cause d’une fille qui a choisi de tapiner pour un « tronc ».
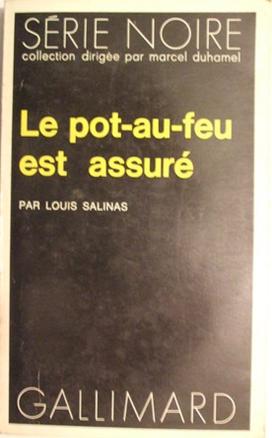
Il y aura des bains de sang, avec des scènes de torture assez osées, mais aussi une histoire de cambriolage avec ouverture de coffre-fort. Cette histoire est d’ailleurs assez embrouillée parce que se sont les bourgeois qui choisissent d’endormir les malfrats et de les manipuler à leur avantage.
Mais comme tout le monde trahit tout le monde, le héros, Gaston, va à son tour être trahi. Il faut noter cependant que le héros est plutôt faible, tout maquereau qu’il soit, et tout ex-taulard qu’il soit, ce sont les femmes qui lui font la loi dans tous les sens du terme. On est loin des romans à la Le Breton où le mac se contente de faire régner la loi à coups de ceinturon. Mais on est aussi assez éloigné du héros de Pierre Lesou, Cœur de hareng.
Le récit est écrit à la première personne, ce qui est sensé donner un peu plus de relief à la personnalité du héros. Mais Louis Salinas essaie aussi de jouer sur les différences de langage, entre d’un côté le pseudo-argot des truands, et de l’autre le parler encore policé des bourgeois – preuve que l’histoire date d’avant mai 68. Il inaugure aussi des scènes d’amour saphique qu’on retrouvera avec plus de mordant dans l’ouvarge suivant, cette fois signé Edouard Rimbaud.
Outre que Salinas dénigre systématiquement le comportement des gens du milieu, il faut bien avouer que l’intrigue est assez invraissemblable. C’est probablement voulu pour donner un ton plus léger au récit, ajouter une dose d’humour. Mais il faut bien reconnaitre que l’ensemble est daté.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 19 Décembre 2010 à 12:31
Ce roman de François Brigneau, par ailleurs ancien de la Milice et militant de longue date de l’extrême droite[1], a défrayé la chronique il y a quelques mois. La raison en était que ce sont les éditions Baleine qui l’ont exhumé. Or, Baleine s’était fait connaître pour des prises de position plutôt à l’extrême gauche, publiant un héros récurrent Le poulpe dont les idées sont tout à fait dans cette mouvance. Du coup un certain nombre d’écrivains, dont Didier Daeninkx, ont signé une pétition pour demander que leur nom soit retiré du catalogue des éditions Baleine, ne voulant pas voir leur nom associé à celui de l’ancien directeur de Minute. Il est probable que cette polémique a fait connaître un peu plus l’ouvrage en question qui autrement serait passé plutôt inaperçu.
Pour ma part, je ne suis que peu motivé et par les idées de Brigneau, et par les polémiques qui vont avec. Ce qui m’intéressait dans Faut toutes les buter, c’est qu’il s‘agit là d’un des tous premiers romans noirs français, et qu’en outre il est traversé par de nombreuses formules argotiques. D’ailleurs, les quelques notations un peu racistes envers les Arabes sont plutôt légères, dans l’air du temps comme on dit, sans que ça infère quoi que ce soit.

Le roman avait été édité en effet en 1947 d’abord sous le titre de Pol Monopol, avec comme nom d’auteur Julien Guernec, aux éditions Jean Froissart[2], puis il avait reparu en 1952 sous le nom de François Brigneau et avec comme titre Faut toutes les buter, une autre édition en 1994 avait été fabriquée par François Brigneau lui-même, et présentée comme le deuxième volume de François Brigneau en argot. Enfin, en 2010, ce sont les éditions Baleine qui ressortent ce titre, sous le nom de François Brigneau et avec un couverture plutôt médiocre.
François Brigneau, de son vrai nom Emmanuel Allot, avait été pendant la guerre un militant d’extrême droite, engagé dans la milice, il purgera une peine de prison pour collaboration à Fontevrault, en même temps d’ailleurs qu’Albert Simonin. On peut penser que c’est dans ce contexte que Brigneau a rencontré quelques truands mouillés dans la collaboration et que c’est ici qu’il a pris ses idées d’écriture.
Le roman est assez faible, mal écrit, les scènes d’action succèdent aux scènes d’action, sans qu’existe réellement une intrigue digne de ce nom. Paul Monopol est un vieux truand rassis qui se trouve à la tête d’une bande de malfaiteurs qui projettent de s’emparer de plusieurs tonnes d’or. Il est opposé à une autre bande de malfrats qui veulent faire le coup à sa place. Contrairement à ce qui est dit ici ou là, il y a très peu de formules argotiques, et en tous les cas le langage est bien moins riche que celui d’un Simonin, justement, ou d’un Lebreton. Mais à l’évidence, Brigneau met en scène des figures de style qui vont faire florès dans les années cinquante, et en cela on peut dire que Brigneau est un des précurseurs du roman noir à la française. La description de Paul Monopol, forban vieillissant, ressemble à s’y méprendre à celle de Max le menteur de Simonin, franc buveur, aimant les aises bourgeoises, plutôt cupide, il aime les femmes et bouffer à s’en faire péter la sous-ventrière. Brigneau inaugure une autre mode, celle de dire qu’à travers ce récit on va démystifier le milieu, présentant les malfrats comme des abrutis qui passent leur temps à trahir et à becqueter à la table des condés. Et du reste je me demande s’il existe un seul roman noir où les voyous seraient décrit comme des mecs biens. Même dans les romans d’André Héléna les voyous quoi que victimes de la fatalité ne sont pas mieux lotis du point de vue de leur moralité. La façon dont Monopol entretient des relations amicales avec le commissaire anticipe sur Le doulos de Pierre Lesou. Là encore il semble bien que Brigneau soit un précurseur.

Le principal défaut de Faut toutes les buter, réside dans le manque de précision sociologique du roman. Contrairement à Simonin, Lebreton, ou même André Héléna, Brigneau ne semble pas connaître le milieu dont il parle. Tout sonne faux, les attitudes, les décors, et même les formules argotiques. Tout est vu de loin, dans une incapacité flagrante à relier la délinquance au petit peuple de Paris. Et puis il est incapable de faire chanter la langue verte comme le feront Simonin, Lebreton, ou encore Alphonse Boudard qui pour moi reste le maître de la littérature argotique de l’après guerre.
A côté de ça, l’ouvrage manque singulièrement d’humour, ce qui est probablement la raison qui l’a fait laisser de côté. Paul Monopol est tout simplement un héros inintéressant au possible.

Lire Faut toutes les buter aujourd’hui est seulement intéressant d’un point de vue archéologique, si on veut comprendre quels ont été les précurseurs de cette langue argotique qu’on a retrouvée dans les premiers romans noirs français. Et comme presqu’à chaque fois, on tombe sur un personnage d’extrême droite, comme des descendants tardifs de Céline.
[1] Il fut aussi un des fondateurs du Front National.
[2] On retrouvera le nom de Julien Guernec aux éditions Froissart comme traducteur d’un authentique auteur de romans noirs Sam Ross, pour J’ai descendu un flic. Cette maison d’édition Jean Froissart, fondée par Charles Frémanger, était spécialisée aussi bien dans la publications de romans populaires, policiers et érotiques soft, que dans les écrivains d’extrême droite. Elle ressortira Voyage au bout de la nuit, mais aussi L’Europe buissonnière d’Antoine Blondin, et encore les ouvrages de Jacques Laurent signés Cécil Saint-Laurent. Le nom des éditions Jean Froissart renvoyait au poète du XIVème siècle et donc à la tradition française.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 6 Décembre 2010 à 17:42
3. Le vrai Jacob
Pour ceux qui voudraient mieux connaître le vrai Alexandre Jacob, il existe une littérature maintenant importante. J’avais découvert son existence en 1970 à travers le livre de Bernard Thomas, le premier, celui qu’il a publié chez Tchou. Puis j’ai ensuite lu l’ouvrage d’Alain Sergent qui avait l’avantage de s’appuyer sur le témoignage direct de Jacob lui-même et que Thomas a utilisé abondamment. Il y eut ensuite l’ouvrage de Caruchet qui est très décalqué, pour ne pas employer le mot de plagiat, de ceux de Sergent et de Thomas. Cet ouvrage est préfacé par Alphonse Boudard qui au-delà des actes et des écrits plus ou moins théorique, salue la force de caractère de Jacob.

Plus récemment L’insomniaque a publié les Ecrits que Jacob a laissés, car c’était un grand lecteur, curieux d’un peu tout, passionné d’histoire et de science, et il mis noir sur blanc une partie de ses réflexions, soit dans des textes plus ou moins théoriques, soit à travers une correspondance abondante. Cet ouvrage a été réédité ensuite en 2004 dans une édition augmenté et révisé.
Mais le travail le plus important à ce jour est sûrement l’ouvrage de Jean-Marc Delpech, Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur, publié en 2008 et qui est tiré de sa thèse de doctorat. Cet ouvrage, outre le fait qu’il corrige un certain nombre d’imprécisions ou d’erreurs qu’on peut trouver dans les premières biographies de Jacob, contextualise la trajectoire de Jacob, montrant combien Marseille était à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, un terreau naturel pour le développement des idées anarchistes. Le plus important de ce travail réside dans la description des réseaux qui ont permis à Jacob d’œuvrer dans la reprise individuelle pendant de longues années. Il montre que ses agissements n’auraient pas pu se faire sans qu’il ne bénéficiât d’un solide réseau de relations, aussi bien dans les milieux libertaires que dans celui de la truanderie.
En ce qui concerne l’illégalisme, il montre que le parcours de Jacob se rapproche de certains autres illégalistes, comme Clément Duval par exemple dont le parcours sera plus heures puisqu’il s’évada finalement du bagne et put finir ses jours à New York, ce qui permet de l’inscrire dans un mouvement politique plus large, avec une méfiance viscérale pour les intellectuels de la révolution. Les travailleurs de la nuit, groupe de cambrioleurs dirigé par Jacob, renvoie aux Panthères des Batignolles, bande de voleurs emmenée par Clément Duval.
L’ambition de Delpech va pourtant au-delà de la précision biographique, elle vise à restituer une vraie dimension politique à l’illégalisme, de le prendre au sérieux dans sa volonté militante, malgré son caractère minoritaire au sein de la mouvance anarchiste. C’est pour cette raison que Delpech se montre aussi pointilleux en ce qui concerne les rapprochements qui ont pu être faits ici ou là entre Jacob et Arsène Lupin. Même s’il n’est pas très important de savoir si précisément Maurice Leblanc s’inspira directement du procès d’Amiens pour la création de son héros, il est évident qu’il y a un monde qui sépare Lupin de Jacob : c’est la conscience sociale. Le second représente la face bourgeoise si on peut dire de l’art de cambrioler.
Il reste pourtant beaucoup de zones d’ombre dans la trajectoire de l’anarchiste marseillais. Par exemple on ne connait pas très bien la personnalité de ceux qui l’ont entour. Rose Roux, sa compagne des bons et des mauvais jours, qui termina ses jours en prison, était prostituée, mais dans quelles circonstances Jacob l’a-t-il rencontrée ? Est-ce qu’elle eût des difficultés pour quitter son état ? La connaissance des détails de cette relation permettrait de faire le point justement sur les intersections entre le milieu libertaire et celui des voyous de basse extraction.
Bibliographie
William Caruchet, Marius Jacob, l’anarchiste-cambrioleur, Séguier, 1993.
Georges Darien, Le voleur, Jean-Jacques Pauvert, 1955.
Gilles Del Pappas, Attila et la magie blanche, Au-delà du raisonnable, 2010.
Jean-Marc Delpech, Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur, Atelier de création libertaire, 2008.
Alexandre Jacob, Ecrits, édition revue et augmentée, L’insomniaque, 2004.
Alain Sergent, Un anarchiste de la Belle Epoque, Alexandre Marius Jacob, Le seuil, 1950.
Bernard Thomas, Jacob, Tchou, 1970.
Bernard Thomas, Les vies d’Alexandre Jacob, Mazarine, 1998.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique






