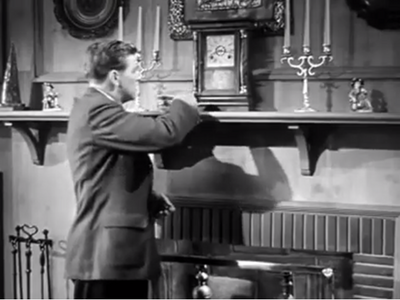-
Par alexandre clement le 16 Octobre 2019 à 08:19
C’est en apparence un remake de La chienne de Jean Renoir qui date de 1931. Si on voulait du reste retrouver les origines du film noir dans le film réaliste français, il faudrait se souvenir que Fritz Lang réalisa deux remakes à partir des films de Jean Renoir, Scarlet Street, d’après La chienne et Human desire d’après La bête humaine (1938). Mais pour ce qui nous concerne on peut dire aussi que Scarlet street est un remake de The woman in the window. La chienne est un roman à succès parue en 1930, il a été écrit par un auteur complètement oublié depuis – sauf pour ce titre – qui avait l’air d’une sorte de Céline, peut-être un peu moins enragé. Ecrivant dans la presse collabo pendant l’Occupation, il avait commis en 1938 un ouvrage antisémite, Histoire d’un petit juif. Peut être visait il un succès à la Céline qui l’année précédente avait cassé la barraque avec Bagatelles pour un massacre. Il est vrai que Renoir qui l’adapta une première fois était lui aussi antisémite, comme son père sans doute. Dans une interview à L’aurore, Henri Jeanson rappelait qu’il avait choisi de s’établir aux Etats-Unis parce qu’il trouvait que les Juifs avaient tué le cinéma en France[1] ! L’anecdote ne manque par de piquant puisqu’on sait que les studios d’Hollywood étaient tous tenus par des Juifs. En vérité Renoir était parti à cause de la guerre et il voulait éviter d’y être mêlé. C’est encore plus étrange puisque Fritz Lang était d’origine juive, et Edward G. Robinson – né Goldenberg – était aussi un juif pratiquant. C’est pourquoi il est sans doute erroné de croire que Fritz Lang en adaptant La chienne connaissait le roman et le personnage qui l’avait écrit. Mais il avait connu Jean Renoir à Paris et savait très bien que La chienne avait été un énorme succès au cinéma. Fritz Lang venait de créer sa propre société de production en 1945 avec Joan Bennett et son mari, et il était pressé de trouver un sujet à monter. Je n’ai pas une passion folle pour l’œuvre de Renoir, et La chienne est un film qui a très mal vieilli. C’est boursoufflé et prétentieux, ce qui me renforce dans l’idée que Lang s’est plus emparé de l’idée pour faire une sorte de remake tragique de The woman in the windows plutôt qu’un film qui rendrait hommage à Renoir.
Christopher Cross est un petit employé de banque qui fête ses 25 ans de bons et loyaux services. Son patron donne un banquet en son honneur, et pour le remercier lui offre une très belle montre. Après cette petite fête, il va regagner son domicile. Mais sur le chemin il va croiser un homme qui bat une femme. Chris se précipite au secours de la jeune femme et d’un coup de parapluie, il assomme la brute. Pendant qu’il part à la recherche d’un policier, Kitty se relève, mais Johnny est parti. Chris va raccompagner la jeune femme chez elle. Elle prétend être artiste, et croit que Chris est un peintre très riche. Tout va se jouer sur ce quiproquo. Chris est très mal mariée, sa mégère de femme a été mariée dans le temps avec un policier qui, croit-on est mort noyé pour sauver une personne. Cette femme tyrannique le brime sur tous les plans, elle l’empêche de peindre, de recevoir ses amis chez lui. Il va se tourner vers Kitty qui est amoureuse de Johnny un bon à rien qui l’exploite sans vergogne. Celui-ci va lui demander de se faire donner du pognon par Chris qu’ils croient riche. Mais Chris n’a pas d’argent. Pour s’en procurer, il va d’abord voler sa femme qui a encaissé la prime d’assurance pour la disparition de son mari, puis il volera sa propre banque. Il installe Kitty dans un appartement luxueux où il entrepose ses toiles et son matériel de peinture. Mais Johnny qui est toujours à court d’argent, va vendre les toiles de Chris. Curieusement elles plaisent, et un galeriste propose de les acheter très cher. Johnny fait croire que c’est Kitty qui les a réalisées. Chris se rend compte que ses toiles ont disparu, mais il n’en veut pas à Kitty qui dit qu’elle les a vendues parce qu’elle avait des problèmes d’argent. Les toiles sont exposées, mais Adèle, la propre femme de Chris les aperçoit et croit que c’est Chris qui copie une peintre célèbre ! Johnny mène maintenant la grande vie grâce aux toiles de Chris. Mais dans sa vie va réapparaitre le vrai mari d’Adèle qui n’est pas mort et qui veut le faire chanter. Chris voit là une manière de se débarrasser de sa femme pour s’en aller épouser Kitty. Tout se passe bien, sauf qu’en arrivant chez Kitty, il l’aperçoit dans les bras de Johnny. Celui-ci en allé, il va revenir chez Kitty qui se moque de lui. Il la tue. Mais comme entre temps Johnny s’était disputé avec elle, c’est lui qui va être arrêté et condamné. Chris s’est fait aussi virer de la banque car ses vols ont été découverts. Il va devenir un vrai clochard, tentant même de se suicider.
Chris a ramené un policier, mais Johnny est parti
C’est moins percutant que le précédent film de Lang, The woman in the windows, et en même temps c’est un peu plus compliqué. On retrouve le thème de l’homme faible accablé et dominé par les femmes. Ici aussi il sera question de s’en débarrasser. Opportuniste et solitaire, il a épousé une vraie mégère, sa logeuse qui le martyrise, l’obligeant à faire la vaisselle, à peindre dans la salle de bains, etc. Croyant lui échapper il se tourne vers Kitty qu’il croit avoir sauvé des griffes de Johnny, manifestement son maquereau. Mais il tombe de Charybde en Scylla, Kitty va l’exploiter sans vergogne, le poussant à voler, lui subtilisant même son identité en lui volant ses peintures. Il va évidemment finir par se révolter, d’abord en se débarrassant de sa femme, puis ensuite en assassinant Kitty et en envoyant son maquereau à la chaise électrique. C’est que cet homme-là en a trop subi. Humilié dans tous les compartiments de sa vie, il finira même par tenter de se suicider. On voit donc que cette œuvre n’a pas une once de cynisme contrairement à La chienne de Renoir. C’est le portrait d’un rêveur qui va se rendre compte au fur et à mesure que sa vie est sans espoir. Dans un premier temps il se cachera volontairement sur ce qu’est Kitty, et aussi sur ce qu’est Johnny, tant il veut préserver ses illusions. Et pourtant son intuition ne le trompe pas. Sa rencontre avec Kitty est la chose la plus heureuse qui lui soit arrivée dans la vie. Il découvre en lui-même cette capacité à aimer d’une manière désintéressée, sans se poser de questions. Replié sur lui-même, il laisse tout passer. Il sera très étonné d’ailleurs d’avoir assommé le grand Johnny avec son parapluie. Cet acte de courage est incongru dans son existence. Il s’appelle Christopher Cross, en abrégé Chris Cross. Criss Cross en anglais possède plusieurs sens, mais tous ce sens se rejoignent pour signifier le passage d’un lieu à un autre, la transgression ou la transformation. Chris justement est trahi, et cette trahison va le transformer en un tueur cynique et jaloux. On le verra d’ailleurs se rendre à l’exécution de Johnny qu’il sait innocent, pour jouir de son triomphe. C’est sans doute cela qui va donner la clé du film : c’est une lutte à mort entre deux mâles pour prendre possession de la femme. Peut importe qu’elle ait choisi Johnny. Elle est l’objet du combat.
Chris hésite à voler sa banque
Dans ce contexte le personnage féminin, contrairement à ce qu’il était dans The woman in the windows, est absolument sans ambigüité. Kitty, même s’il la bat et lui pique son pognon, aime Johnny, elle l’a dans la peau. Et donc toutes les misères qu’elle fera endurées à Chris ne sont que la conséquence de cette prise de position. Elle n’a aucun mystère à révéler. A l’intérieur du triangle, elle est le lien entre Johnny et Chris. Là va se déployer un étrange ballet : Johnny évite le plus possible de se retrouver en face de Chris, et celui-ci manifeste une grande méfiance à son endroit. Cette simple opposition entre le grand blond sans scrupule et le petit brun complétement coincé est le cœur du film. C’est donc une relation homosexuelle qui ne dit pas son nom et à laquelle Johnny se refuse. Il acceptera pourtant indirectement l’argent de Chris comme une femme entretenue en se p ayant une belle voiture sur son compte. L’élément féminin c’est Chris, on le verra avec un tablier en train de faire la vaisselle. Il est à la recherche de son pénis. On le verra d’abord s’emparer d’un grand couteau avec lequel il découpait des tranches de foie, et en menacer Adèle qui prend peur. C’est la première phase de la révolte. La deuxième viendra lorsqu’en s’emparant du pic à glace, il tuera Kitty. Cela lui permettra au moins de recouvrer sa virilité. Adèle quant à elle on suppose qu’elle récupérera son ancien mari réapparu miraculeusement et qu’elle s’appliquera à le martyriser comme elle a martyrisé Chris.
Il va prendre les actions de sa femme pour les vendre
Chris est socialement un être inférieur, perdu au cœur de la mégalopole. Même si son patron le traite bien en lui faisant cadeau d’une belle montre, il est bien son employé plutôt soumis. Sa condescendance ira même assez loin puisqu’il se permettra de ne pas porter plainte contre un employé qui l’a tout de même volé. Chris est un homme vieillissant et solitaire, c’est pourquoi il est content que ses toiles se vendent bien, même si Kitty le vole ouvertement, il atteint par ce biais une reconnaissance inattendue. Le thème de la peinture est encore plus présent que dans The woman in the windows. Mais ici il est décalé vers le peintre, l’artiste, et sa misère, l’incompréhension dont il est entouré. Sa femme et sa protégée n’ont aucune idée de ce qu’il exprime à travers ses toiles. Il est probable que cette métaphore concerne Lang qui toute sa vie courra après une reconnaissance, même quand il avait atteint une grande renommée. Ce qu’exprime Chris à travers sa peinture naïve, c’est ce qu’il ne peut pas exprimer avec des mots ou avec son corps. C’est l’amour dira-t-il. Dans le film il sera fait allusion aussi au fait que les meilleures toiles de Chris sont ses dernières, soit celles qu’il a peintes en étant amoureux de Kitty.
Dans le silence de la nuit, Chris attend qu’il n’y ait plus personne
La réalisation de Fritz Lang est très appliquée, peut être plus que dans The woman in the windows. Il y a des emprunts assez n ombreux aux autres films noirs, et donc aux siens également. La scène o ù l’on voit Kitty se faire peindre les ongles par Chris sort évidemment de Double indemnity proposé l’année précédente par Billy Wilder. Le film cependant souffre de déséquilibres importants. La première partie est très longue. La seconde partie s’anime et retient un peu plus l’attention, les rebondissements se multiplient et on s’écarte du vaudeville pour aller vers le noir, bien noir. Je trouve que c’est dans cette partie que le talent de Lang est plus évident. Il utilise alors parfaitement l’image de Milton Krasner, avec de beaux noirs profonds comme des tombeaux. Si la scène introductive du repas célébrant les 25 ans de bons et loyaux services de Chris est très bien organisée et filmée, avec une profondeur de champ qui est amplifiée en filmant la scène en plongée, c’est dans les scènes finales qu’il donne le meilleur. Par exemple dans le train qui mène Chris vers le lieu d’exécution de son rival quand il va se trouver confronté aux journalistes qui lui expliquent à quel point la culpabilité finit toujours par submerger un assassin, même s’il s’en tire devant un tribunal. J’aime aussi beaucoup les scènes qui se passent à la banque quand, dans la solitude de la pénombre vespérale, Chris tente de voler, puis vole son patron. Là aussi Lang utilise la plongée, puis un léger mouvement sur l’avant pour se rapprocher du malheureux Chris. Quand celui-ci passe devant la vitrine où ont été exposés ses œuvres, il n’y a plus rien à admirer, ses tableaux ont été vendus, et donc Lang utilise un travelling arrière qui va permettre à Chris de se fondre dans ce qu’on pense être une nuit de Noël. Comme dans sa précédente œuvre, Lang film tout en studio, ça rend parfois la forme un peu étriquée. Ce sont des choses qu’on ne fait plus depuis longtemps, on préfère toujours des décors naturels où la vie a un peu plus de chance de se manifester, réservant les plateaux aux seuls intérieurs.
Kitty se fait peindre les ongles des pieds par Chris
L’interprétation est dominée par le même trio que celui de The woman in the windows. Sans doute ici Robinson a-t-il la part plus belle. Il va user de tout son savoir-faire et démontrer qu’il était un acteur sublime. Par exemple, on le verra très à l’aise et enjoué dans le petit déjeuner qu’il prend au début du film avec Kitty, puis, défait et vouté lorsqu’il comprend à quel point Kitty s’est moquée de lui. Il joue très bien de sa petite taille. Lang s’amuse à le filmer face au policier immense qu’il rencontre au début du film, ou encore face au mari revenant qu’il retrouve au coin d’une rue d’une manière si inattendue. Joan Bennett est la perverse Kitty, un peu innocente toutefois, perdue dans ses rêves frelatés de grand amour avec Johnny dont elle accepte de devenir la chose. Son rôle est différent de celui du précédent film de Lang où elle était d’abord une femme forte qui avait appris à se débrouiller toute seule. Ici elle est dépendante de Johnny. C’est peut-être pour cela qu’elle est moins éclatante ici. Mais elle est très bien et met bien en valeur les hésitations de son personnage, car quelque part elle a un peu honte de ce qu’elle fait subir à ce malheureux Chris. Et puis il y a Dan Durya dans le rôle de Johnny. Il a pratiquement le même costume et le même chapeau que dans The woman in the windows. S’il a fait une large partie de sa carrière dans des rôles de crapules et de sournois, on dit que dans la vie réelle il était tout l’inverse, bon mari, bon père de famille, il n’a jamais alimenté les gazettes toujours à la recherche d’un scandale. Il parait qu’il s’occupait aussi beaucoup de son jardin. Sa fin de carrière – il est mort à 61 ans – a été très difficile sur le plan matériel. Peut-être était il trop marqué par ses rôles de canaille ? En tous les cas, c’est incontestatblement un des acteurs majeurs du film noir, j’ai eu l’occasion plusieurs fois de le souligner, et il en fait encore la démonstration ici. Le reste de la distribution ne vaut pas vraiment le coup d’être commenté. Rosalind Ivan dans le rôle d’Adele en fait peut-être un peu trop. Mais dans l’ensemble c’est très bien.
Le mari d’Adèle est réapparu
Le titre du film Scarlet street est une allusion à la prostitution et donc à la Bible où on parle de la rue rouge. Lang ne voulait pas reprendre le titre de Renoir, La chienne, qui en anglais aurait pu être traduit pas The bitch. C’était trop violent pour les censeurs et puis cela l’aurait sans doute aussi relié trop précisément à Renoir. Le film eut aussi pas mal de succès, mais moins toutefois que The woman in the windows, peut être à cause de l’effet de répétition, on a l’impression d’avoir déjà vu le même film. Peut-être l’a-t-on trouvé trop long dans sa première partie ? Peut-être que de revoir le même trio dans des rôles un peu similaires rendait le chaland méfiant ? Longtemps ce film ne se trouvait que dans des copies médiocres, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Wild Side a republié The woman in the windows et Scarlet street dans un ensemble Blu ray d’excellente qualité, avec bonus et livret comme on fait maintenant. La qualité de l’image HD fait redécouvrir le film sous un nouvel angle, film qu’à vrai dire j’avais un peu négligé dans mon jeune âge.
Dans le train qui le mène à Sing-Sing pour assister à l’exécution de Johnny, Chris va converser avec les journalistes
Johnny va être execute
Devant la galerie qui expose ses œuvres Chris passe comme un clochard
Lang dirigeant Robinson et Bennett
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 12 Octobre 2019 à 08:03

Même si cela n’a pas été toujours facile, Fritz Lang est, en 1944, un réalisateur reconnu et admiré. Mais c’est sans doute avec ce film, The woman in the windows, qu’il va s’imposer comme un des maîtres du cycle classique du film noir. C’est très certainement un des films noirs les plus commentés. Il est tourné la même année que Laura d’Otto Preminger, pratiquement en même temps. Si les deux projets semblent avoir été indépendants, ils ont pourtant des ressemblances formelles très intéressantes. Le tableau représentant une jeune et belle femme est le véritable point de départ de l’intrigue, ce tableau entraîne une forme de rêverie poétique qui va tourner au cauchemar, et ensuite, il va révéler les tensions entre l’homme et la femme comme l’expression d’une forme de guerre des sexes. Dans les deux cas ce sont des romans à succès qui ont été adaptés, et dans les deux cas le réalisateur a été rattaché au projet une fois que celui-ci a été formulé et décidé par les studios. Néanmoins comme Preminger et Lang sont des caractères forts, il ne faudrait pas penser que ce sont de simples commandes et qu’ils ne vont pas y ajouter leur touche personnelle. Les deux films rencontreront un succès critique et commercial très fort. L’ouvrage de Wallis, dont seulement deux livres ont été traduits en français, a servi de base à une adaptation somme toute assez fidèle, quoique des différences demeurent par exemple dans l’ouvrage de Wallis, Wanley lit des poèmes érotiques de la Grèce antique, tandis que dans le film il s’endort sur la lecture du Cantique des cantiques, poème sulfureux où la religion semble être contournée dans sa rigidité par un appel à une sexualité libérée. Notez qu’on a présenté Le cantique des cantiques, bien qu’il soit attribué à Salomon, comme écrit par une femme, parce que cet ensemble de poèmes parle plus d’amour charnel que de mariage, ce qui lui donnerait justement ce côté érotique très particulier. Par rapport au roman la fin a également été changée, moins tragique puisque par un artifice du scénario Wanley ne sera pas puni pour le crime qu’il a commis, elle est habituellement présentée comme un apport particulier de Lang[1]. L’ouvrage de Wallis sera adapté par Nunnally Johnson, un scénariste à succès, qui, de The grapes of warth de Ford à Dirty dozen d’Aldrich, accumulera les succès commerciaux dans presque tous les genres du cinéma américain. Mais comme il le reconnaitra, il adoptera de nombreux points de vue amenés par Lang. Il trouvait que de faire appel au rêve était une paresse scénaristique, mais il avoua avoir compris l’intention de Lang de ne pas punir un innocent pour avoir bu quelques verres de trop.
Richard Wanley est un professeur d’université qui enseigne la psychologie criminelle à Gotham university[2] et qui n’hésite pas à citer Sigmund Freud. Il est, dans sa partie, reconnu. Il a une réputation, une famille, des amis. Il est à l’abri du besoin. Pour cause de vacances, il emmène sa petite famille à la gare, restant tout seul à New York. Clairement il se sent libéré d’un poids. Il va se rendre à son club où il rencontre ses amis, le procureur Lalor, et le médecin Barkstane avec qui il boit un peu et fume des cigares. Il reste tout seul à lire Le cantique des cantiques jusqu’à assez tard. Il s’en va par les rues désertes pour regagner à pied son domicile. Mais en passant devant une galerie, il va s’arrêter pour admirer le portrait d’une inconnue exposée en vitrine. Il va cependant voir le portrait s’animer. Il reconnait à côté de lui le modèle qui a stimulé l’imagination du peintre. Il entame la conversation avec cette belle jeune femme qui le drague ouvertement. Après avoir été boire un verre, elle l’emmène chez elle pour lui faire voir des dessins d’elle. Mais quelques instants après, arrive un individu, Mazard qui manifestement entretient la jeune femme et qui se croit des droits sur elle. Il commence à la battre, Wanley va s’interposer, mais comme Mazard menace de l’étrangler, il est plus fort que lui, Alice va lui tendre une paire de ciseaux avec lesquels il va tuer son protagoniste. Dès lors ils ne savent plus quoi faire. Craignant pour leur réputation et des ennuis avec la justice, Wanley va décider de faire disparaitre le corps. Il dit alors à Alice qu’il va chercher sa voiture et qu’elle doit l’attendre. N’ayant manifestement pas confiance en lui, Alice lui demande de lui laisser en échange de sa patience son gilet. Elle s’arrange aussi pour lui subtiliser son porte mine. Mais Wanley revient, avec milles difficultés, il charge Mazard dans sa voiture et s’en va le déposer dans les bois. Il se fera remarquer au péage pour des questions de monnaie, et puis il se déchirera le costume et s’égratignera sur les barbelés. Mais il revient chez Alice. Ils pensent tous les deux qu’ils vont s’en tirer. Ils souhaitent ne pas se revoir. Wanley reprend ses habitudes, au club il discute avec le procureur Lalor qui lui explique de la financier Mazard a disparu. Alice téléphone le lendemain à Wanley pour lui dire qu’elle a appris sa promotion à l’université par le journal. Mais peu après on a retrouvé son cadavre. Lalor pense que l’enquête sera facile, et qu’ils cherchent une femme. On apprend aussi que les amis de Mazard le faisaient surveiller par une sorte de détective. Celui-ci va se présenter d’ailleurs chez Alice pour la faire chanter. Il explore son appartement à la recherche d’une preuve du meurtre, mais il n’en trouve pas. Il va réclamer 5000 $ à Alice sous peine de la dénoncer. Celle-ci gagne du temps et lui dit de revenir le lendemain. Entre temps elle va téléphoner à Wanley. Ils se retrouvent pour mettre au point l’élimination du maitre chanteur. Elle va proposer 5000 $ à Tim, et lui verser du poison dans son verre pour qu’il décède lorsqu’il partira de chez elle. Mais Tim est malin, devant la nervosité d’Alice, alors que celle-ci a promis de partir avec lui, il va la frapper, la dépouiller et la mettre à l’amende, il récupère en même temps la montre de Mazard ce qui est bien la preuve de l’implication d’Alice dans sa disparition. Entre temps Wanley a dû assister la mort dans l’âme à la découverte du corps. Lalor lui ayant dit qu’ils avaient trouvé la maîtresse de Mazard, il craint de rencontrer Alice. Mais ce n’est qu’une fausse alerte. Ce n’est pas la bonne femme. L’élimination de Tim ayant échoué, Alice téléphone à Wanley qui, désemparé, s’empoisonne. Mais non loin de l’appartement des coups de feu éclatent. C’est la police qui a abattu Tim qui cherchait à fuir, probablement parce que les objets qu’il avait sur lui l’incriminaient maintenant dans le meurtre de Mazard. Heureuse de cette issue, Alice téléphone à Wanley qui est en train de mourir dans son fauteuil. Mais en vérité il s’était endormi au club sur Le cantique des cantiques. Soulagé il s’en retourne chez lui par les rues désertes, repassant une dernière fois devant le portrait qu’il a attribué à Alice, croisant sur le trottoir une prostituée, il prendra ses jambes à son cou, probablement pour retrouver la sécurité de sa petite famille.
Richard Wanley est un professeur renommé de psychologie
Le récit est parfaitement développé en trois temps. Cette manière de faire va accroître la tension, mais aussi l’incertitude dans laquelle se trouve le héros. C‘est donc bien le point de vue de Wanley qui est présenté. La première partie se situe entre le départ de sa petite famille et la mort de Mazard. Autrement dit il s’agit d’une quête douloureuse de la liberté. Plus Wanley pénètre l’intimité d’Alice, et plus il se rapproche du drame. C’est l’irruption inattendue du riche financier au cœur d’un lieu calme et rassurant qui est le prix qu’il faut payer pour ses propres fantasmes. Le second temps c’est bien évidemment la complicité qui va se mettre en place entre Alice et Wanley pour une question de survie élémentaire, mais en même temps on comprend que cette complicité va un peu au-delà car en prenant les choses en mains, Wanley retrouve sa virilité – bien difficilement il est vrai – et va susciter l’admiration de sa partenaire. La preuve que Wanley retrouve son statut, c’est qu’Alice lui téléphone pour le féliciter de sa promotion, mais en fait elle le félicite de sa conduite pour s’être débarrassé proprement du corps de Mazard en les protégeant. Cette période très active de Wanley va se clôturer avec l’arrivée du nouveau rival, le cauchemardesque Tim. Celui-ci représente une menace pour tous les deux, et surtout il va remettre sur le tapis la virilité de Wanley parce qu’il prétend s’emparer de la femme par la force. Cette nouvelle épreuve va produire la déchéance de Wanley parce qu’au fond elle démontre son impuissance. Il a voulu être un mâle dominant, c’est raté. Cette troisième partie aurait pu se conclure par la mort de Tim et laisser donc toute ses chances à Wanley de retrouver son statut auprès d’Alice. Mais dans la confusion de son esprit, il abandonne la lutte et s’empoisonne. Seule la mort peut le délivrer de son impuissance. Cependant, la véritable fin de l’histoire étant qu’il a rêvé tout cela, on comprend qu’en réalité il a été incapable de faire autre chose que de rêver. On ne sait pas qu’elle est la pire des deux fins : cette incapacité à être l’amant d’Alice, ou celle de ne pas triompher de son rival.
Sa femme et ses enfants partent en vacances, il les accompagne à la gare
C’est un film extrêmement compliqué, moins dans sa structure narrative que dans ses intentions d’ailleurs. Très souvent ceux qui en font le commentaire commencent par la rencontre de Wanley avec le portrait d’Alice, puis avec Alice. Ce n’est pas juste. La scène importante est le départ de la famille de Wanley dont il se débarrasse à la gare. C’est si je puis dire le premier assaut contre la famille. Ce type de scène a été très souvent vu au cinéma. The seven years itch de Billy Wilder le reprendra sur le mode de la comédie amère en 1955. D’une autre manière dans Pitfall, André de Toth raconte la même chose, un homme mûrissant envoie en l’air sa sécurité familiale pour vivre sa vie, notamment une passion sexuelle[3]. On a souvent dit que le film noir remettait en cause le modèle familial proposé par l’american way of life. C’est encore le cas ici. Le thème principal du film c’est la transgression et cette transgression va très loin puisqu’elle pousse Wanley jusqu’à tuer. On va donc voir Wanley, un petit homme faible et conformiste se transformer pour retrouver sa virilité. C’est là que les choses vont se compliquer. Alice est certainement une prostituée, ce n’est pas dit, mais c’est suggéré, notamment par le décor dans lequel elle vit, une sorte de bonbonnière luxueuse et vulgaire. Et donc dans un premier temps nous avons un adultère – celui de Wanley – qui met en scène un trio : Alice, Wanley et puis Mazard. Wanley se débarrasse de son rival à coups de ciseaux. Il est assez facile de voir ce à quoi renvoie les ciseaux. Mais justement quand Wanley se bat avec Mazard, ils se roulent par terre ensemble et c’est Wanley qui le pénètre de plusieurs coups dans le dos. L’allusion à l’homosexualité latente de Wanley est évidente, d’autant que dans son club bourgeois, il ne fréquente par définition que des hommes. Mais ce premier trio va laisser bientôt la place à un autre trio, Tim, Alice et Wanley. Tim est le mâle dans toute sa force : il veut non seulement s’approprier l’argent d’Alice comme un vulgaire maquereau, mais il veut aussi son corps et qu’elle parte avec lui. Dans les deux cas le pivot est Alice, la femme comme un trophée d’une lutte à mort. Mais Wanley est faible, déjà il s’en est miraculeusement sorti contre Mazard, aussi va-t-il choisir le poison pour éliminer Tim. Le poison c’est considéré depuis la nuit des temps comme l’arme des femmes, l’arme des faibles. Devant son impuissance, Tim ayant éventé facilement la ruse, il renoncera. On remarque que si Alice est bien l’enjeu de cette lutte, Wanley ne la possédera jamais. Celui-ci a admis sa défaite bien avant de combattre physiquement Mazard et Wanley pour les détruire. Il discutera avec ses amis Lalor et Barkstane très précisément de cela, avançant en parlant du portrait que tous les trois ont vu du fait qu’ils seraient bien incapables de faire quoi que ce soit avec une si belle fille, ils se trouvent trop vieux. Wanley répétera aussi devant Alice qu’il n’a pas d’intention malsaine à son endroit comme pour s’en convaincre. Wanley se sent très seul, et d’autant plus seul qu’il s’est enfoncé dans une histoire scabreuse. Il va écrire à sa famille pour leur dire combien elle lui manque, mais il n’ira pas jusqu’au bout, trouvant sans doute dérisoire d’étaler ainsi des faux sentiments. Il jettera la lettre à peine ébauchée.
Dans une vitrine il rencontre à la fois un portrait et son modèle
Le film noir a bâti sa spécificité sur l’ambigüité. C’est bien Wanley l’intellectuel, celui a lu Freud et qui l’enseigne qui représente cette ambigüité. Il vit en respectant l’ordre bourgeois, mais il ne rêve que de le transgresser. Tim au moins est beaucoup plus direct et moins hypocrite, il affiche clairement la couleur, c’est un prédateur, et il le dit. Mais Wanley dissimule ses instincts, sans doute comme ses amis. C’est peut-être ça qui le rend impuissant à satisfaire ses pulsions sexuelles. Pire encore, il réfléchit sur cette dissimulation. C’est à tel point qu’on peut se demander dans quelle mesure ce sont les pulsions de Wanley qui ont engendré le drame. C’est sans doute par référence à sa propre culpabilité que Wanley finalement ne reproche rien à Alice. En effet il aurait pu au contraire souligner la responsabilité de la jeune femme puisque c’est bien parce qu’elle est une femme entretenue qu’elle autorise Mazard à avoir des droits sur elle et donc à être jaloux au point d’avoir des envies de meurtre. Mais il ne dit rien et va se lancer dans une opération périlleuse pour tenter de restaurer l’ordre antérieur.
Wanley a tué Mazard à coups de ciseaux
Et Alice ? Elle apparaît à la fois comme un personnage clé, mais en même temps comme relativement indéterminé. Elle représente plus le désir masculin que la réalité d’une femme. C’est l’objet de la lutte sanglante entre les mâles. C’est sans doute comme cela qu’il faut comprendre sa mise en perspective par le portrait interposé. On ne sait pas vraiment qui elle est. Femme entretenue, certainement, demi-mondaine, probablement. Sans doute se tourne-t-elle vers Wanley parce qu’il représente plus la figure du père que celle de l’amant. On la sent prête à se confier à lui, elle lui montre les dessins qu’on a fait d’elle. Cependant, dès qu’elle va se sentir en danger, elle rompra cette complicité naissante en prenant ses précautions, elle exigera le gilet de Wanley, mais elle dissimulera son porte mine et la montre de Mazard. N’étant pas née de la dernière pluie, elle se méfie de la gent masculine, que ce soit de Mazard, de Tim et même de Wanley. Elle fera de même d’ailleurs avec Tim qui bien naïvement croit qu’il peut s’approprier Alice et son corps uniquement en exerçant la violence. Il vient que ce portrait est celui d’une femme en voie d’émancipation. C’est finalement elle plus encore que Wanley qui vit dans un univers hostile. Elle vient manifestement de la rue, et pourrait être tentée de se rapprocher du professeur comme une promotion sociale. Elle est le lien entre des classes sociales forcément antagoniques. Mais la rigidité des relations sociales va empêcher ce rapprochement. Au fond ce qui la sépare de Wanley ce sont les amis de celui-ci, Lalor et Barkstane. Ce sont eux les gardiens de la société, eux qui indiquent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. L’incompatibilité sociale entre Wanley qui la désire, et Alice, est représentée par cette scène où pour des raisons de sécurité ils se rencontrent dans le couloir d’un immeuble neutre et impersonnel, et où ils finissent par se tourner le dos. Wanley manque de courage, c’est évident aussi quand il accompagne Lalor pour inspecter les lieux où on a découvert le cadavre de Mazard, et où il craint de croiser Alice. Cependant Alice reste un personnage ambigu. Pour résoudre le problème de l’intrusion de Mazard, elle s’en remettra à l’intelligence de Wanley qu’elle pense supérieure à la sienne. Quoiqu’elle soit intervenue de manière décisive en lui tendant une paire de ciseaux – image de la femme castratrice – pour qu’il la débarrasse de Mazard. Notez que le titre américain, The woman in the windows est bien plus parlant que le titre français. En effet, on pourrait le traduire par La fille dans la vitrine – c’est du reste le titre d’un film excellent de Luciano Emmer La ragazza in vetrina qui traite explicitement de la prostitution – ce qui renverrait à ces femmes qui vendent leurs charmes en les affichant dans une vitrine sans rien donner du tout. D’ailleurs Alice apparaît au début comme quelqu’un de relativement froid et distant. Peut-être est-ce cela qui intrigue et attire Wanley ? Mais elle va vite s’animer ensuite dès qu’elle l’entraîne chez elle en lui prenant le bras comme s’ils étaient des vieux amis. Dans cette promenade nocturne étonnante Alice oscille entre le racolage le long d’un trottoir et la pression amicale pour entraîner Wanley chez elle, dans son antre, comme si elle en faisait une proie facile à dépouiller, et du reste elle le dépouillera… de son gilet !
Wanley a accompagné le procureur Lalor sur les lieux de la découverte du corps
Le film va jouer sur la définition d’une réalité qui se révèle bien aléatoire. Il n’y a pas que le fait d’avoir rêvé. Dès le début nous avons un jeu sur la peinture, ou plutôt d’un portrait. Alice semble physiquement sortir du tableau, donner la vie à une image, mais on note que ce portrait est lui-même enfermé derrière une vitrine, signifiant la difficulté d’y accéder. Il y a bien trois niveaux de perception de l’image : d’abord le portrait perçu au-delà de la vitrine, ensuite le reflet trompeur d’Alice dans cette même vitrine, et enfin Alice elle-même qui apparaît au côté de Wanley, et preuve de sa matérialité, elle va lui prendre le bras pour l’emporter. Et donc tout de suite va se poser la question du rapport entre l’image qui la représente et la réalité de son existence. On peut se demander si Wanley ne préfère pas plutôt cette image à la réalité faite de chair et de sang de la jeune femme. De même il y aura de longues scènes avec des jeux de miroir dans l’appartement d’Alice, à la fois pour démultiplier les possibilités d’interprétation, mais aussi pour introduire une distance presqu’infranchissable entre Wanley et la femme. C’était déjà le cas dans Laura, le policier qui enquête sur la disparition de Laura s’endort devant son tableau. Mais ici Wanley ne s’endort pas devant le tableau, il crée une histoire et un rêve à partir de ce qu’il en a entrevu. Nous sommes donc aussi dans la perspective des mensonges de l’art, ces mensonges qui aident finalement à supporter les vicissitudes de la vie, mais aussi de la transfigurer au point de l’empêcher d’exister autrement qu’à l’état de fantasme. Le tableau est donc cette mise à distance non seulement de la réalité, mais celle qui existe entre les personnages : au lieu de les rapprocher, il les éloigne : c’est cet objet inanimé qu’est le tableau qui les empêche de se rencontrer véritablement. Le fait que la même année deux films reprennent cette idée est aussi une manière de repositionner le cinéma par rapport aux autres formes artistiques. En effet le 7ème art a longtemps été considéré comme un art inférieur à l’écriture ou à la peinture. Et ce que nous voyons dans la première rencontre entre Wanley et Alice, c’est une image derrière une vitrine qui va s’animer peu à peu, affirmant de fait la supériorité du cinéma sur la peinture parce que le cinéma s’anime et rend les personnages vivants. Nous sommes à la fin de la guerre, les puissances de l’Axe sont battues de partout, il est temps de repartir de l’avant, et l’émergence d’une nouvelle forme de représentation, le cinéma, est nécessaire à cet emballement. La peinture est restée enfermée dans les musées, réservée à une élite, le cinéma au contraire s’adresse aux foules denses des formes urbaines nouvelles. Pour toutes ces raisons, le film noir entretient un rapport compliqué avec la peinture[4], non seulement parce qu’il utilise des tableaux comme des éléments décisifs de l’intrigue, mais aussi parce que dans ses formes il emprunte des constructions d’images à des peintres modernes[5], il se pense obligatoirement comme une esthétique nouvelle, il est concomitant de l’émergence de la cinéphilie[6]. La même idée sera reprise d’ailleurs dans le film suivant de Lang, Scarlet street qui peut apparaître comme une version tragique de The woman in the windows.
Tim, le détective va faire chanter Alice
Le film est, à cause de ses décors en tout petit nombre, volontairement claustrophobique. Il y a deux principaux décors, l’appartement d’Alice, et le club masculin où se retrouvent Wanley et ses amis comme des comploteurs. Ces deux décors sont en opposition frontale. L’appartement est fortement éclairé, décoré de miroirs et de bibelots féminins, le club est sombre, éclairé par une lumière tamisée, meublé de fauteuils dans lesquels on s’enfonce comme dans un cercueil. On a donc d’un côté un univers violent, vivant et sensuel, et de l’autre l’exact contraire, tout est calme, et ce n’est pas pour rien que Wanley s’endort en rêvant d’être ailleurs. Cette relative clôture de l’espace entraine forcément que Lang doit multiplier les angles de prise de vue pour éviter le côté théâtre filmé, et il y arrive parfaitement. Il utilise aussi souvent le plan en pied, malgré la toute petite taille d’Edward G. Robinson. Lorsque celui-ci se trouve au milieu de ses amis, il est filmé plutôt en plongée de façon à moins insister sur sa faiblesse, car si Wanley est un homme faible dans l’univers très fortement sexué de l’appartement d’Alice, ailleurs, à l’université ou à son club, il est respecté et reconnu comme un personnage important du fait de son savoir. Tim est par contre filmé en mouvement notamment quand il investit l’appartement d’Alice. Il est grand, et Lang utilise très bien les mouvements de ses longs bras pour envahir encore un peu plus l’espace et prendre indirectement possession d’Alice. Il est très mobile, furette de partout sans demander l’autorisation, chose que Wanley ne se serait sûrement pas permis étant donné sa retenue expliquée par son formatage. Il y a quelques autres décors qui sont importants. D’abord le bois dans lequel Wanley a perdu le cadavre de Mazard. Mais de ce bois on ne verra rien, la première visite de Wanley se passe la nuit et sous la pluie, et la seconde est rapidement écourtée, Wanley se repliant dans la voiture de Lalor pour s’y enfermer et s’exclure. C’est du studio, Lang ne s’intéresse que rarement aux décors naturels, le coin de rue où habite Alice, ou la rue où se trouve le club et la galerie où est exposé le portrait de la jeune femme, sont réduits à leur plus simple expression. Même de la gare de New York où Wanley est sensé emmener sa femme on ne verra rien, de l’université, à peine la plongée sur un amphithéâtre. Ce parti-pris renforce sans doute l’isolement de Wanley et des différents protagonistes de l’histoire. Une scène étonnante est la scène du réveil de Wanley : celui-ci s’endort chez lui après avoir pris son poison, revêtu de sa veste d’intérieur, et il se réveille dans le même plan dans son club, revêtu de sa veste de costume ! Cela a été rendu possible par le fait que Robinson portait deux vêtements l’un sur l’autre, et que pendant que Lang filmait son visage en très gros plan, des techniciens enlevaient sa veste d’intérieur. On a salué cette séquence comme un exploit, le genre de prouesse dont aurait été fier Hitchcock, mais cela n’apporte pas grand-chose sur le plan narratif.
Alice et Wanley vont se rencontrer dans un endroit neutre
La distribution est excellente, à commencer par Edward G. Robinson qui incarne Wanley. C’était une grande vedette à cette époque, et ce depuis les années trente. C’est un des grands acteurs du film noir. Il sera d’autant plus intéressant d’ailleurs que lorsque les studios le banniront pour cause de trop grande proximité avec les communistes, il s’investira dans des films noirs à petit budget, avant de rebondir en fin de carrière dans des grosses productions. Ici il s’éloigne des rôles de gangsters qui ont fait sa réputation et inaugure ici un certain nombre de rôles d’intellectuels, ou de policiers qui réfléchissent avant que d’agir, comme par exemple dans The stranger d’Orson Welles en 1946. Il dira par la suite qu’il n’a pas aimé ce rôle, comme il n’a pas aimé celui que Lang lui donnera pour Scarlet street. Sans doute ne le trouvait il pas assez positif et viril. Notez qu’en 1944 on le verra aussi dans Double indemnity, un autre chef d’œuvre du film noir, mais là il gagnera sa bataille contre son subordonné, coupable de meurtre. Il y a ensuite Joan Bennett. Elle a peu tourné de films noirs. C’était déjà une grande vedette avant la guerre, mais juste avant The woman in the window, elle va tourner pour Preminger Margin of error. Elreprésente ce qu’il y a de plus engagé à gauche à Hollywood. Elle tournera trois films avec Fritz Lang, dont The scarlet street et Secret beyond the door. Elle tournera aussi le film de Max Ophuls, The reckless moment. Elle fera encore une apparition dans Highway dragnet, un petit film noir à petit budget de Nathan Juran. Il est probable que ce soit l’HUAC qui l’ait marginalisée. Elle est ici excellente. Et puis il y a Dan Durya, rien que pour lui il faut voir ce film. Abonné aux rôles de mauvais garçon, dans les westerns comme dans les films noirs, le voilà dans la peau de Tim le maître chanteur. C’est un acteur incroyable qui savait tout faire. Il n’apparait qu’au dernier tiers du film, mais son rôle est déterminant et dans son affrontement avec Alice, on en oublie presque Edward G. Robinson ! Cette distribution se reformera pour Scarlet street. Il y a encore Raymond Massey dans le rôle du procureur un peu rigide qui croit un peu trop à ses capacités d’enquêteur. En vérité il pataugera jusqu’à la fin.
Il est difficile de tromper Tim et celui-ci évente le piège, récupère l’argent et la preuve du meurtre de Mazard
La réception critique fut très bonne et le public fut au rendez-vous. Ce succès permis d’ailleurs à Fritz Lang de monter sa propre entreprise de production qui produire d’ailleurs The scarlett street. Curieusement et pendant de longues années son ne pouvait voir ce film que dans des copies médiocres, sans parler des copies qu’on pouvait voir dans les ciné-clubs. Mais maintenant, c’est un des avantages de la numérisation, on le trouve dans une copie impeccable chez Wild Side. Il n’existe pas à ma connaissance de copie Blu ray sur le marché français, mais vu la qualité de la photographie de Milto Krasner, le film le mériterait amplement, d’autant que la nuit est omniprésente dans le film, stimulant les contrastes d’un excellent noir et blanc. Comme on l’a compris, The woman in the window est non seulement une œuvre majeure du film noir, mais c’est aussi une œuvre décisive dans la filmographie de Fritz Lang.
La police a tué Tim dans une impasse
Sortant de son club, Wanley va retrouver le portrait qui l’a fait rêver
Fritz Lang sur le tournage de The woman in the window avec Joan Bennett
[1] Lotte H. Eisner, Fritz Lang, Cahiers du cinéma, Cinémathèque française, 1984.
[2] C’est évidemment un emprunt curieux à la bande dessinée mettant en scène les aventures de Batman.
[4] Hitchcock utilisera la peinture d’Hopper comme référence à la construction de l’image dans Psycho (1960) par exemple, mais le portrait que Judy Barton va admirer au musée dans Vertigo (1958) signale aussi que cette image va jouer un rôle clé dans l’intrigue. On peut citer aussi Shockproof (1949) de Douglas Sirk qui va dans ce sens.
[5] Jean Foubert, « Edward Hopper : film criminel et peinture », Transatlantica, 2 | 2012
[6] Laurent Jullier, Jean-Marc Leveratto, Cinéphiles et cinéphilies, Armand Colin, 2010
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 8 Octobre 2019 à 08:26

Edgar Ulmer est connu et admiré pour quelques films, comme par exemple Detour qu’on considère à juste titre comme un chef-d’œuvre du film noir de série B[1]. il est très apprécié aussi pour son western très décalé, The naked dawn, qui donna sans doute son plus beau rôle à Arthur Kennedy qui fut tourné aussi en 1955. Dans Detour il avait engagé un acteur assez extravagant, Tom Neal, connu plus pour ses bagarres et ses séjours en taule que pour ses qualités d’acteur. Ici Edgar Ulmer va engager laq sulfureuse Barbara Payton, ancienne compagne de Tom Neal pour laquelle celui-ci s’était méchamment battu avec Franchot Tone, son mari de l’époque, qui lui avait quitté Joan Crawford pour elle ! Tom Neal était un peu boxeur, il s’en tira avec quelques côtes cassées et Franchot Tone partit faire un séjour à l’hôpital, ce qui ne pouvait que ravir les gazettes hollywoodiennes, mais un peu moins les patrons de studio qui voulaient préserver un peu une image assez lisse pour ses employés[2]. Cette jeune femme qui avait tous les talents, et la beauté en sus, ne fit malheureusement qu’une carrière médiocre. Elle ne planifiait pas grand- chose et brûlait surtout la vie par les deux bouts. Marylin Monroe était aussi peut-être une bad girl, mais elle avait totu de même un certain souci de sa carrière. Mais un certain nombre de films surnagent cependant, notamment Kiss me tomorrow goodye[3] – c’était le frère de James Cagney avec qui elle avait une liaison – et aussi Trapped de Richard Fleischer où elle se faisait remarquer en bien d’ailleurs[4]. Alcoolique et droguée, elle finira par se prostituer sur les trottoirs d’Hollywood pour se payer sa dose, et succombera à une crise cardiaque à l’âge de 39 ans. Comme Frances Farmer, c’est une martyre d’Hollywood. Elle publiera ses mémoires de misère pour 2000 $[5]. Dans le film d’Ulmer, son physique avait déjà changé, empâtée, elle portait les marques de ses turpitudes. Ce sera d’ailleurs son dernier film avant qu’elle ne plonge complètement dans la débine. Ce film n’a d’ailleurs pas très bonne réputation et est considéré comme très mineur dans la carrière d’Edgar Ulmer.
Bert a retrouvé son subordonné Ray
Ray Patrick est inspecteur à la section des homicides de Los Angeles, il est appelé pour le meurtre d’un homme, Fred Deane. Celui-ci n’est pas facile a identifié car il a eu la face brulée et les deux mains également. Il serait tombé dans la cheminée ! Tout de suite les soupçons vont se porter sur Eden Lane, une chanteuse de cabaret qui avait semble-t-il une liaison avec ce Fred Deane. Ray va partir à sa recherche. Elle s’est réfugiée à la montagne, dans la Californie du nord. Il va la retrouver au milieu d’une tempête de neige. Il la ramènera cependant, elle sera jugée et condamnée à la peine capitale pour le meurtre. Mais Ray n’est pas très convaincu. En tous les cas il doit l’accompagner par le train à la prison d’Etat. Mais durant le voyage Eden croit reconnaitre Fred Deane. Après quelques moments de tergiversation, Ray décide de retrouver ce fameux Fred Deane. Il s’enfuit donc avec Eden en sautant du train en marche, et atterrit dans une petite ville. Ne sachant pas trop par quoi commencer, il tombe par hasard sur Patsy Flint la co-locataire d’Eden Lane. Il va la pister, et en fouillant sa chambre d’hôtel, il va trouver dans sa valise 5000 $. Il suit ensuite la piste d’un fabricant de céramique qui produit le même type de statue que celle qui est sensée avoir tué Fred Deane. En, visitant l’entreprise, il se fait agresser. Mais quand il revient au motel, Eden a disparu à nouveau. C’est à ce moment là que Bert arrive et le retrouve pour le mener en prison pour avoir aidé une prisonnière à s’échapper. Mais Ray va le convaincre de poursuivre l’enquête avec lui pour une journée seulement. Leur seule ressource est de suivre la louche Pasty Flint. Cependant celle-ci va être également assassinée. Les deux policiers vont se rapprocher d’un certain Abbott, le propriétaire de l’usine de céramique, qu’ils soupçonnent d’être Fred Deane. Ils cherchent donc un témoin qui pourrait confondre Abbott comme étant aussi Fred Deane. Mais Abbott et sa femme vont prendre le train, juste au moment où arrive madame Sparrow la logeuse d4eden qui reconnait formellement Abbott. Entre temps Eden s’est rendue à la police pensant que personne n’arriverait à faire la preuve de son innocence. Ray sera obligé de démissionner, mais il sera récompensé puisqu’il pourra épouser Eden !
Ray a poursuivi Eden Lane jusque dans un coin perdu de la montagne
C’est un scénario un peu bâclé qui ne craint pas les invraisemblances. On retrouve évidemment de nombreux tics du film noir classique : le policier solitaire qui tombe amoureux de la femme qui est sensée être coupable de meurtre, avec l’idée que l’amour est une preuve suffisante d’innocence. L’amitié entre deux flics qui sera mise à rude épreuve par la recherche de la vérité justement. Il y a tout de même cette idée selon laquelle la justice et la vérité sont deux choses très différentes, et que la police lorsqu’elle suit les règles n’arrive à rien. Le personnage principal, Ray Patrick en s’écartant de sa fonction de policier va travailler à la manière des détectives privés, et c’est d’ailleurs ce qu’il annonce qu’il deviendra à la fin du film. Il ne se soucie plus guère des mandats, de violer des serrures rétives, de cambrioler une entreprise parce que c’est la seule manière qu’il a de parvenir à la vérité. Il annonce le conflit qui deviendra récurrent dans les films policiers à venir : un policier efficace est celui qui ne s’embarrasse pas des règles. Les personnages sont peu approfondis, il aurait été plus intéressant me semble-t-il de faire du policier Ray un vrai dépressif, alors que cet état est à peine suggéré. Il est un peu étrange de le voir tomber si vite amoureux d’Eden, dans la mesure où elle a tout l’air d’une roulure qui couche avec le premier venu. Là non plus ça manque de profondeur. Que recherche Eden ? Pourquoi est-elle tombée dans le lit d’un homme riche, vieux et adultérin ? On comprend seulement que Ray se trouve dans le rôle du rédempteur mélancolique, il va racheter les péchés d’Eden quitte à y laisser sa peau.
Ray doit amener Eden à la prison où elle sera exécutée
C’est un film de série B, mais avec un tout petit budget, vraiment tout petit. Il n’y aura pas de scènes d’extérieur. On utilisera des transparences, ou des montages alternant des scènes avec les acteurs principaux et des trains, des avenues, des immeubles. Cette dissociation se voit au premier coup d’œil. Même les décors sensés figurer les bureaux de la police sont très pauvres, étroits où la caméra a du mal à se mouvoir. Les emprunts aux autres films noirs sont très nombreux, à commencer par le flash-back qui permet de faire avancer l’histoire à grande vitesse. Et puis il y a l‘emprunt u paysage de neige au film de Nicholas Ray, On dangerous ground. C’est ce que retiennent ceux qui ont vu ce film rare. Mais les films avec des décors enneigés font toujours leur petit effet. C’est une manière de décaler le genre. Par exemple Day of the outlaws est un western, mais en le situant dans les montagnes enneigées, André De Toth lui apporte une étrangeté qu’autrement il n’aurait pas. Ce n’est pas ce que j’ai apprécié le plus dans le film d’Ulmer. Je trouve que le rythme est très bon. Même si l’abondance des gros plans tente de masquer la misère des décors, Ulmer se rattrape avec un découpage nerveux. Le film était tellement fauché, qu’il n’y a même pas la scène traditionnelle du tribunal jugeant Eden. Mais ça passe et permet de se concentrer sur ce qui est essentiel, ce n’est pas bavard, juste ce qu’il faut, l’inverse de Tarantino en quelque sorte ! Il y a des belles ombres, et puis la première scène d’avant le flash-back, quand nous voyons Bert espionner son ami par la fenêtre vaut le détour. C’est une manière de dire qu’il va pénétrer dans le monde de Ray pour tenter de comprendre ce qu’il lui est arrivé.
Eden a disparu une nouvelle fois
La distribution elle aussi coûte quatre sous. Le rôle principal est tenu par Paul Langdon, un acteur assez pâle qui touche ici le rôle de sa vie au cinéma. Pourtant jeune encore, il a l’air vieux et usé, les traits d’un alcoolique. Mais comme il joue le rôle d’un flic un peu désabusé, ça passe. Et puis il y a notre Barbara Payton dans le rôle d’Eden. C’est son dernier film, manifestement elle ne savait pas trop où elle se trouvait. Elle est raide, empâtée, le regard par en dessous, c’est une déception. Mais son rôle est assez bref. Les interprètes sont tous un peu des has been, Robert Shayne incarne Bert, en tentant de laisser entendre qu’il peut encore marcher et courir comme un jeune alors que nous voyons dans la première scène, quand il retrouve Ray, qu’il a des problèmes avec ses vertèbres ! Il y a cependant quelques bons acteurs, d’abord Tracey Roberts qui incarne la fourbe Patsy Flint qui fait chanter tout le monde. Ou encore la vieille Kate McKenna dans le rôle de la logeuse. Dans l’ensemble ce sont tous des acteurs qui font très peu de cinéma, ils se tourneront vers la télévision. La scène où Ray interroge le pompiste interprété par Harry William Harvey, un acteur solide, habitué des seconds rôles, est aussi très bonne. Il est tout de même remarquable que le film ait pu être tourné avec si peu d’acteurs !
Ray et Bert vont prendre Patsy Flint en filature
Curieusement la musique est soignée, c’est du bon jazz d’époque. La copie qui circule en DVD, sans sous-titres, est recadré façon Wide Screen. C’est un peu gênant, parce que j’ai le souvenir d’un autre format 4 :3. Néanmoins si ça ne vaut pas Detour, c’est un film noir bien agréable à regarder. Compte tenu des circonstances, ce n’est pas un mauvais travail d’Ulmer. On peut donc le voir sans regret en se passant des avis trop négatifs sur cette pellicule.
Sur le quai de la gare ils attendent leur dernier témoin
Voilà ce que ça donne si on compare le format original et le wide screen. Voilà pourquoi il faut toujours respecter le format choisi par le réalisateur
[2] Tom Neal sera impliqué un peu plus tard dans le meurtre de sa femme, il n’évitera la chaise électrique que grâce à l’habileté de son avocat qui avait été payé par ses amis… dont Franchot Tone !. Tout ça pour dire que les acteurs des films noirs de série B sont aussi de drôles de lascars !
[3] http://alexandreclement.eklablog.com/le-fauve-en-liberte-kiss-tomorrow-goodbye-gordon-douglas-1950-a114844682
[5] Barbara Payton, I am not ashamed [1963], dernière édition augmentée, Spurl Editions, 2016.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 4 Octobre 2019 à 08:10
C’est un film d’espionnage anti-rouge bien évidemment, et très paranoïaque. Le scénario est quasiment inexistant, un peu comme si l’ensemble de l’équipe se moquait de l’intrigue, et donc l’absence histoire un peu crédible indique que son seul intérêt ne peut se trouver que dans sa réalisation. Parfois les films anti-rouges donnent naissance à de bizarres formes cinématographiques, par exemple The thief de Russel Rouse avait un caractère étrange parce qu’il n’avait aucun dialogue[1]. Un peu comme si le réalisateur ne voulait ajouter l’imbécilité des dialogues qu’on trouve dans ce genre de films à l’idiotie de l’intrigue. Et bien ici c’est un peu pareil, le film a pour originalité de se passer presqu’entièrement dans un décor unique, celui d’une cafétéria un peu isolée au bord de la route 101. Dans cet univers un petit groupe d’individus s’agite d’une manière absurde. Sans doute qu’en 1955 on commençait à douter de la nécessité de la propagande anticommuniste, et donc on commençait à la prendre comme un jeu. Mais est-ce que cela suffit à en faire un film culte ?
Kotty est amoureuse du professeur Bastion
George tient une cafétéria sur le bord de la 101, il a deux employés, La belle Kotty, la serveuse, et le rugueux Slob, le cuisinier. Les affaires marchent assez mal, la clientèle peu nombreuse. Parmi celle-ci il y a Bastion qui loge à l’étage au-dessus, et dont Kotty est amoureuse. Slob tente sa chance lui aussi, mais sans succès. Il échange cependant des mystérieux coquillages avec Bastion. On comprend qu’il s’agit de secrets nucléaires. Parmi la clientèle, il y a aussi les employés d’ACME qui sont très entreprenants avec Kotty. Bastion tente de rencontrer le mystérieux monsieur Gregory qu’il croit être le supérieur de Slob. Mais peu à peu l’étau se resserre, Kotty va surprendre les faux employés d’ACME, Art et Pepe, en train de perquisitionner la chambre de Slob. Slob a assassiné un collègue de Bastion qui posait trop de questions. Slob comprend que le FBI est à ses trousses, d’autant que son acolyte a aperçu Bastion en grande discussion avec Art et Pepe. Il va tenter de fuir, mais Bastion a compris que Slob était en réalité Monsieur Gregory. C’est l’ami de George, Eddie, qui va tuer Slob d’un coup d’harpon. Bastion pourra alors faire sa vie avec Kotty qu’il avait séduite pour son travail, mais qu’il a fini par aimer.
Les employés d’ACME sont un peu trop entreprenant auprès de Kotty
L’intrigue est tellement simple qu’elle frise la stupidité et n’a aucune vraisemblance. D’ailleurs on ne saura pas si Bastion est réellement un agent du FBI ou un vrai professeur, après tout il a eus a photo dans le journal en tant que chercheur de renom. Même en faisant un effort, on ne peut pas croire que les Russes soient aussi stupides que cela. Le film s’accompagne d’un petit discours de Kotty qui a compris grâce à son bon sens patriotique ce qui se passait, et qui crie à Slob de rester chez lui pour développer son propre pays au lieu de venir faire le jaloux chez les Américains. On suppose que ce discours était inclus dans le cahier des charges et que le FBI a mis la main à la poche pour financer cette absurdité. Evidemment Slob est une brute, il manque d’ailleurs de violer Kotty : on voit le parallèle les brutes soviétiques abusent de la féminité ou de la mollesse de l’Amérique. C’est évidemment quand on évoque la question du sexe que le film devient intéressant. Car si ce film accroche un peu l’œil tout de même, c’est parce qu’il se laisse aller à parler de sexe. D’abord Kotty, c’est la seule femme de cet univers très masculin et donc tout le monde lui court après. D’ailleurs elle ne fait strictement rien pour empêcher cela, se plaisant à exciter les faux employés d’ACME. Au contraire, alors qu’elle fait semblant de s’offusquer des avances très poussées de Slob, la voilà qui se rapproche de lui. Elle sait également que George est amoureux d’elle. Elle va le torturer en lui disant qu’elle ne l’aime pas, mais que pour lui faire plaisir, elle pourrait tout de même l’épouser ! Au fond si elle se dit amoureuse de Bastion, c’est parce qu’elle croit qu’il est un professeur de renom et donc qu’il est plus intelligent qu’elle. Mais ça va un peu plus loin encore, George et Slob vont se trouver dans la grande salle de la cafétéria en train de faire de la culture physique. Ils ont tombé le teeshirt, et les voilà qui se tâtent les pectoraux et les mollets. C’est une scène très gay. Et d’ailleurs quand Kotty les surprend dans cette pose ridicule, ils se cachent derrière le comptoir pour se rhabiller. De même les relations entre Eddie et George sont loin d’être claires. Ils sont d’anciens camarades de guerre. Mais ils vont se déguiser en plongeurs avec palmes, masque et tuba, et parcourir la cafétéria en représentation, comme s’ils voulaient se distinguer du reste du public et se manifester ainsi leur différence. C’est Kotty, la femme faible donc, qui résiste physiquement et efficacement à Slob. Les autres, y compris Bastion, apparaissent comme des incapables.
Bastion est sensé vendre des secrets nucléaires à Slob
Je suppose que c’est cet aspect très particulier qui rend le film curieux. Le réalisateur piège donc un certain nombre de personnages dans un lieu très réduit et filme leur affrontement rendu inévitable par l’exiguïté des lieux. Cette unicité des décors va induire Edward Dein à multiplier les angles de prise de vue, alternant le plan large et le gros plan, pour tenter d’éviter que cela ne ressemble à du théâtre filmé. C’est pourtant inévitable quand on sent les auteurs des dialogues – le scénario et les dialogues sont des époux Dein – cherchent le bon mot. La première partie hésite d’ailleurs assez entre comédie et drame, abusant parfois des formes grotesques, notamment des gros plans des acolytes de Slob qui déforment les visages et qui semblent sortis directement de chez Orson Welles. C’est un film anti-communiste tardif, et donc sa lumière va être un peu différente de celle des films noirs, Dein ne veut pas ou ne sait pas jouer avec les ombres. Fait de bric et de broc, on ne sait pas trop ce qui a intéressé Dein. C’est du reste un réalisateur des plus discrets : au début des années cinquante il a tourné quelques films au Mexique puis une poignée d’autre à Hollywood pour des petits budgets. Il ira rapidement rejoindre les bataillons des réalisateurs de télévision. Shack out on 101 est son film le plus connu, c’est tout dire. Ma photo de Floyd Crosby qui avait travaillé sur quelques films de Roger Corman est bonne. Mais enfin lui aussi était un habitué des petits budgets, donc des tournages rapides. Notez que l’utilisation d’un écran large lui donne un air un petit peu moderne qui l’éloigne des films noirs classiques dans sa facture. Il y a très peu d’extérieur, simplement la scène d’ouverture qui voit Kotty étalée sur la plage, léchée par les vagues du pacifique, comme rejetée par la mer, sous le regard scrutateur de Slob. Cette scène semble avoir été inspirée par From here to eternity, l’énorme succès de Fred Zinnemann qui date de 1953.
S’étant fâchée avec Bastion, Kotty se rapproche de Slob
Officiellement la star du film est Terry Moore qui interprète Kotty. Elle n’a pas eu une carrière très brillante malgré 77 films à son actif, son plus grand titre de gloire est d’avoir été secrètement la dernière épouse d’Howard Hughes[2], mais ici elle n’est pas mal et joue assez bien de sa petite taille par opposition aux mâles qu’elle domine malgré leurs épaules larges et leurs muscles avantageux. Son partenaire c’est Frank Lovejoy dans le rôle de Bastion. Il a l‘habitude, sans doute à cause de son physique de « bon américain » de traquer les rouges puisqu’il était le héros déjà de I was a communist for the FBI de Gordon Douglas[3]. Mais ici il a l’air complètement éteint et ne pas vraiment croire à son rôle. Et puis il y a Lee Marvin dans le rôle de Slob. C’est plutôt curieux de le voir dans un film anticommuniste, lui qui était plutôt un démocrate sur le plan politique. Mais à cette époque il était jeune et inconnu. Et à mon sens on peut voir le film rien que pour lui. Il est très présent et efface tout le monde. Cependant il ne joue pas comme il jouera plus tard. Ici il est plus volubile que dans tous les autres films qu’il tournera par la suite. Il fait un peu le clown et passe du rôle de la brute à celui d’espion rusé et malin avec une grande facilité. Il y a aussi Keenan Wynn que Lee Marvin retrouvera plus tard dans Point Blank, dans le rôle de George le mélancolique amoureux de Kotty.
Art et Pepe fouillent la chambre de Slob
Le film laisse ainsi une impression étrange d’inutilité totale et en même temps il attire l’œil. Ce n’est pas un chef d’œuvre, ni un filme culte, mais il y a un regard particulier qui est celui d’Edward Dein qui finit par intéresser, à condition qu’on se moque complètement de cette histoire saugrenue de trafic de documents. Ce film est ressorti en Blu ray par la grâce d’Olive films qui a beaucoup fait pour faire sortir de l’oubli des petits films noirs désargentés, dans une très belle copie. En vérité si ce film était parti dans les oubliettes cela venait de l’indigence de son intrigue. Mais maintenant on a appris à regarder ce type de produit au-delà de sa fonction officielle de propagande d’un système politique dont le but était d’éradiquer toute idée socialiste de la tête des gens.
Slob comprend que Bastion est un agent du FBI
Slob a blessé George et semble maîtriser la situation
[2] Des histoires curieuses comme seule Hollywood est capable d’en inventer circulent à ce propos. Elle a été mariée 6 fois et aurait été marié secrètement avec Howard Hughes alors qu’elle se maria durant ce temps encore deux fois ! Mais il faut croire qu’elle avait des preuves sérieuses de son mariage secret puisque la succession d’Howard Hughes accepta de lui payer une somme substancielle à la mort de celui-ci. votre commentaire
votre commentaire
-
Par alexandre clement le 30 Septembre 2019 à 08:09
C’est un film noir tardif, et comme tel il va bénéficier à la fois de l’évolution des mœurs, on parle ouvertement de la corruption des syndicats, mais aussi des avancées techniques puisqu’il sera tourné en noir et blanc. C’est un film qui parle de la mafia et de son infiltration dans les syndicats, mais il suppose cependant que c’est juste une petite partie du syndicalisme qui est pourrie. Le personnage de Little Joe, interprété par Mickey Rooney, est calqué sur Jimmy Hoffa. Celui-ci qui était à la tête du puissant syndicat des chauffeurs routiers, a mystérieusement disparu, sans doute assassiné par la mafia elle-même. Comme Little Joe, il était méchant et colérique. Il a été l’objet de plusieurs transpositions cinématographiques, dont la dernière est due à Martin Scorsese lui-même avec Al Pacino dans le rôle de Hoffa. Le film s’appellera The Irishman et sortira à l’automne 2019[1]. Mais le film de Charles F. Haas n’a pas grand-chose à voir avec la réalité, et au moins il ne le prétend pas. Il s’inspirera juste de la gestuelle de Hoffa devant la commission sénatoriale qui enquêtait à cette époque sur cette question des rapports entre le crime organisé et les syndicats. C’était plus novateur qu’il n’y parait parce que J. Edgar Hoover qui était totalement corrompu s’obstinait à nier l’existence de ce problème, faisant de la lutte contre le communiste la priorité absolue du FBI.
Bill Gibson croise devant le local syndical Joe Braun en compagnie du tueur Wetzel
Joe Braun, dit Little Joe, dirige une section du syndicat des métallos, mais une commission sénatoriale le soupçonne de malversations, de détournements de fonds et de racket pour son profit et celui de sa bande de nervis. Il a fait assassiner un témoin qui tentait d’apporter les preuves comptables de ces faits. Devant la commission il refuse de répondre en invoquant le 5ème amendement. Mais il laisse échapper qu’il connait le tueur Wetzel, prétendant ne pas l’avoir vu le jour où le meurtre du comptable a eu lieu. Bill Gibson qui se rend au local syndical des métallos en compagnie de Fred, les a vu ensemble. A l’usine cependant, les hommes de main de Braun imposent leur loi brutalement et décrètent la grève, sans demander leur avis aux ouvriers. Par ce moyen Little Joe tente de se procurer de l’argent, tout en améliorant les conditions de travail des syndiqués. Mais il a d’autres soucis. Braun qui sait que Bill et Fred l’ont vu en compagnie de Wetzel va tenter d’abord de les acheter en leur proposant un poste de bureaucrate bien payé au syndicat. Mais ils refusent. Face à une situation qui se dégrade rapidement Bill va rencontrer les instances dirigeantes du syndicat qui l’encouragent à témoigner contre Braun. Mais celui-ci qui fait espionner ses supérieurs est au courant, il décide, après avoir frappé et brûler Fred, donc d’enlever Bill et de le torturer pour que son témoignage devant la commission ne lui nuise pas. Ses hommes ont également enlevé son jeune fils. Ils vont libérer Bill et garder le jeune Timmy. Mais Bill après un moment d’hésitation laissant entendre qu’il va témoigner dans le sens de Braun, va décider de partir à la recherche de son fils, avec sa femme, son ami Fred et quelques membres du syndicat. La difficulté vient du fait qu’on lui avait bandé les yeux à l’aller comme au retour pour qu’il ne reconnaisse pas son chemin. Il va donc devoir se guider à son oreille et parvenir à retrouver la maison où il avait été séquestré. Ils vont investir les lieux tandis que sa femme va téléphoner à la police. Il s’ensuit une bataille mémorable. Bill délivrera son fils et la police arrêtera toute la bande, et Joe en plus pour kidnapping.
L’homme de main de Joe Braun vient donner ses ordres au délégué syndical
Même si l’intrigue est assez simple, le film est complexe. En effet, il ne tombe pas dans le piège où était tombé volontairement Kazan en tournant On the Waterfront, et qui condamnait toute forme de syndicalisme. Ici Joe Braun est une sorte d’hérésie par rapport au syndicat qui apparait globalement honnête. Le second aspect est de représenter le milieu ouvrier. Nous sommes à la fin des années cinquante, les ouvriers ne sont plus des très pauvres, mais au contraire, ils bénéficient d’une certaine aisance, Bill et Fred possèdent un petit pavillon confortable, la plupart des ouvriers ont aussi des voitures – on admirera au passage la Plymouth Plaza de 1958 que conduit Bill, certes ces engins n’étaient pas très écologiques, mais au moins avaient ils de l’allure. On remarquera aussi que l’usine où ils travaillent est propre et ne ressemble pas à un de ces anciens bagnes du capitalisme sauvage. Et donc d’un certain point de vue, c’est une ode au progrès économique, dont les bienfaits apparaissaient alors évidents. Mais le scénario met aussi en scène la solidarité ouvrière : on verra même les dirigeants du syndicat accepter de partir dans la chasse au gang dans la même voiture que Fred et Bill. Le film montre également comment le rusé Joe Braun tient son syndicat. Il est peut-être un gangster, mais il obtient des résultats pour ses membres. Les salaires sont augmentés de 15%, et ils auront un peu plus de congés payés. Il est populaire et balance des blagues qui font rire tout le monde, il a du charisme, même s’il s’appuie sur une bande de tueurs pour faire respecter sa loi. Il est donc ambigu. Il l’est aussi également quand du haut de sa petite taille, il affronte la commission sénatoriale ou même le solide Bill qui lui mange la soupe sur la tête.
Bill et Fred se rendent comptent qu’ils ont croisé Braun avec Wetzel, et donc qu’il ment
Dans ce film noir, tendance prolétarienne, il y aura une description précise, non pas du mode de vie des ouvriers, mais au moins de leurs rêves et de leurs aspirations. La famille Gibson suit le modèle traditionnel américain, le mari très viril travaille pour nourrir sa famille et donc élever leur fils, et la femme, très féminine, reste à la maison à préparer des bons petits plats, tenir le ménage et éventuellement aller chez le coiffeur pour se teindre en blonde platine. On comprend que contrairement à Braun ils ne sont pas intéressés par l’argent, ils veulent juste un foyer confortable, une famille unie et de bons copains. A côté d’eux, les truands apparaissent comme un vestige d’un ancien monde, aussi bien sur le plan historique – ils n’ont pas compris l’idéal de justice – que sur le plan moral. Ils sèment le désordre dans une société qui pourrait être harmonieuse et où chacun pourrait trouver sa place. Il y a évidemment un sens moral, mais il diffère assez de la morale bourgeoise et s’apparente plus à la morale portée longtemps par les organisations ouvrières. Bille dira à Little Joe qui lui propose de l’argent, qu’il veut vivre tranquille, s’occuper de sa femme, de sa famille et de ses amis, et que le travail ne le dérange pas, même s’il doit avoir de la graisse sous les ongles. Ce type de morale qu’on a trop hâtivement identifié à une morale bourgeoise est lié à une civilisation industrielle qui a sans doute atteint son apogée à la fin des années cinquante aux Etats-Unis et qui va disparaitre avec l’explosion de la tertiarisation de l’emploi. Il est assez amusant de constater que Bill et Fred sont habillés comme des prolétaires, et les truands sont fiers de leurs beaux costumes bien coupés.
Little Joe va tenter de soudoyer BIll
Sur le plan cinématographique il y a de belles trouvailles, à commencer par la scène du début qui voit les truands jeter le témoin dans une benne à ordures qui le broie et le fera disparaitre. Il semblerait que ce soit là que se trouve l’inspiration de Sergio Leone lorsque dans l’ennuyeux Once upon a time in America on verra James Woods disparaître dans une benne à ordures. L’autre idée qui consiste à fermer les yeux de Bill avec du sparadrap donne un côté étrange à la séance de torture, comme quand on fait passer Bill au détecteur de mensonge. Néanmoins le rythme est assez inégal. La première partie est plus nerveuse et plus intéressante que la seconde. Notamment parce qu’elle utilise habilement la diversité des décors, ceux de l’usine en particulier. C’est aussi dans cette partie que Little Joe peut faire son numéro, aussi bien face à la commission sénatoriale que face aux membres de son syndicat. Charles Haas utilise le Cinémascope d’une belle manière, donnant de la profondeur de champ. La deuxième partie se traîne un peu, et les scènes d’action ne sont pas très bonnes, la bagarre finale n’est pas très bien filmée. Mais dans l’ensemble on ne s’ennuie pas. La photo est excellente. Charles Haas aime à filmer les objets de la civilisation industrielle, que ce soit les automobiles, ou les instruments qui équipent l’usine où travaillent Bille et Fred. J’aime bien aussi la façon dont est filmé l’affrontement entre Little Joe et Bill ou entre lui et la commission, pour mieux faire apparaitre la différence de taille, et donc finalement tout le mérite que Little Joe a de se battre comme il le fait il utilise la contre-plongée.
Les hommes de Braun ont déclenché la grève
C’est un film au budget moyen, très moyen même, mais ce n’est pas un film de série B. Il faut le voir pour une interprétation splendide. Il y a d’abord Mickey Rooney dans le rôle de Little Joe, comme toujours il est excellent dans les films noirs[2], lorsqu’il manifeste de la colère, une sorte de révolte contre la nature qui l’a fait si petit – il faisait 1m57 ce qui ne l’a pas empêcher d’épouser Ava Gardner ! Ensuite il y a Steve Cochran dans le rôle de Bill Gibson. On ne sait pas trop pourquoi cet acteur n’a pas fait une plus grande carrière, peut-être n’était-il pas assez carriériste pour Hollywood[3]. En tous les cas il faut le considérer comme un pilier du film noir. Ici il est très convaincant, quoiqu’il le soit un peu moins dans la seconde partie. Mais le reste de la distribution vaut le détour, Mamie Van Doren en ménagère ! Son rôle est étroit, mais elle est très bien, surtout par la forme idéalisée du rêve féminin. Certains ont critiqué cette représentation de la femme au foyer, mais c’est qu’ils sont très mal documentés. Les truands sont de première classe. Ray Danton dans le rôle du tueur Wetzel, Leo Gordon, dans celui de Sacanzi. Et puis il y a Mel Tormé le grand chanteur de jazz qui a tenté de faire une carrière au cinéma. Dans le rôle de Fred il est très bon. On reconnaîtra aussi au passage Jim Backus, un autre habitué du film noir, ou encore Jackie Coogan dans le rôle du représentant syndical qui couvre les turpitudes de Little Joe. La plupart de ces acteurs sont aujourd’hui un peu oubliés, et Mamie Van Doren reste plus connue comme symbole sexuel et ses photos de nue, que pour ses talents d’actrice. Mais en bien fouillant le catalogue du film noir, ils ont une place importante dans ce genre. Ray Danton connaîtra son heure de gloire avec le film de Budd Boetticher, The rise and the fall of Legs Diamond, l’essentiel de sa carrière se fera à la télévision.
Braun veut que Bill ne témoigne pas contre lui
C’est globalement la même équipe que Charles Haas avait déjà dirigée la même année pour The beat generation, un autre film noir introuvable aujourd’hui, sauf dans une version italienne du DVD hors de prix. La musique de The big operator est très bon, c’est du bon jazz d’époque, à une date où cette musique commençait à être prise enfin au sérieux. Le film, sans être un bide, a eu un accueil mitigé, peut-être le public américain était saturé des histoires de commission sénatoriale qui envahissaient les écrans télévisés qui sont ridiculement petit dans le film. Mais selon moi, il vaut un peu plus que le détour, aussi bien comme témoignage d’une époque révolue – sur le plan économique comme sur le plan artistique – que dans l’expression d’une équipe d’acteurs extrêmement solide.
Bill retrouve son fils dans les mains de Joe
[1] Le film de Scorsese est basé sur le livre de Charles Brandt, I heard you paint houses, qui se présente comme une longue interview de Frank Sheeran, l’homme qui aurait tué Hoffa. Mais cette version est très contestée.
[2] http://alexandreclement.eklablog.com/sables-mouvants-quicksand-irving-pichel-1950-a114844628 et aussi http://alexandreclement.eklablog.com/le-destin-est-au-tournant-drive-a-crooked-road-richard-quine-1954-a114844730
[3] Il mourut très jeune sur son yacht entouré de trois très jeunes mexicaines. Il était connu comme un fornicateur impénitent qui montait sur tout ce qui portait un jupon. Il fut aussi l’amant de Mamie Van Doren qui raconte ses frasques dans PLaying in the field : my story, Putnam 1987.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique